VI- Les cultural studies PDF

| Title | VI- Les cultural studies |
|---|---|
| Course | Introduction aux Sciences de l'Information et de la Communication |
| Institution | Université Lumière-Lyon-II |
| Pages | 9 |
| File Size | 174.3 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 73 |
| Total Views | 132 |
Summary
Sixième et dernier chapitre du cours d'introduction à la communication du semestre 1 (portail médias culture et société + langage et communication)
Les notes sont divisées par chapitre et s'organisent par points qui recensent les idées principales...
Description
VI- Les courants critiques : Les cultural studies
Introduction : - Le courant théorique des années 60 qui suit le structuralisme, face aux polémiques aux USA autour de la culture de masse MAIS : o Intérêt pour le discours médiatique (contenu) et ses effets o Replace le sujet au cœur de sa réflexion o LA MEDIATION est pensée en rapport étroit avec le sujet, l’acteur et l’audience -
-
-
Contexte d’apparition : o Construites autour de polémiques très fortes aux USA autour de la culture de masse o Série de phénomènes médiatiques populaires particulièrement marqués aux USA o Etudient ces objets populaires (dont se méfient Francfort et le structuralisme) 3 caractéristiques principales pour ces phénomènes populaires : o Les contenus médiatiques diffusés à des publics nouvellement constitués (plus de temps de loisir, meilleure condition salariale) dans l’après-guerre o La diffusion de masse suppose la mise en place d’industrie d’un nouveau genre o Les critères esthétiques évoluent face à cette production de masse vers une standardisation La culture de masse est entrée dans la vie quotidienne des citoyens (cf. Morin, presse populaire, radio, TV, cinéma…) Certaines craintes subsistent face à ce phénomène : destruction des valeurs esthétiques, perte d’originalité des messages Ils observent que cette culture de masse détruit progressivement le lien social car la masse serait bcp plus encline à consommer une culture facile et distrayante Naissance par la critique d’un courant élitiste et méfiant (structuralisme)
Interview d’Eric aigret qui met en avant que : - Les cultural studies sont éminemment moins ancrées dans le marxisme - Malgré cela, elle en garde une approche critique, mais la focale est différente : pas de superstructure ou de grands ensembles mais intérêt pour les microcosmes populaires, subculture
Les auteurs d’origine : - Le précurseur : Franck Raymond Leavis (30’) o S’est interrogé sur le développement du capitalisme et ses effets sur la culture o Mass Civilisation and Minority Culture dans lequel il explique qu’il faut utiliser l’école pour propager la connaissance de valeurs littéraires qui donnent aux élèves les outils d’appropriation de la culture o Approche éducative, basée sur la recherche de sens et de valeurs socio-éducatives o Ces valeurs éducatives doivent permettre aux élèves de survivre dans une société de soap-opéra/ roman-savon, du travail de masse, des pubs abrutissantes…
-
L’emblématique : Richard Hoggart (50’) s’intéresse à la working class et à son rapport à la culture o The Uses of Literacy (1957) approche ethnographique réalisée dans les milieux socialement défavorisés o Intérêt pour la façon dont la classe ouvrière s’approprie la culture o Décrit les changements dans la classe ouvrière (développement des loisirs par ex) hommage à la résistance populaire face à la culture de masse et en émet une critique o Réfute Adorno qui mettait en avant la confusion entre monde réel et monde représenté dans les cultures de masse : il met en avant le fait que le public de la culture de masse a conscience qu’un film reste une fiction o Discours des médias reçus et immédiatement réinterprétés par ces publics populaires o Forme d’indifférence par rapport aux conseils des journalistes sur la politique alors que l’idée à l’époque la question de l’appropriation du grand public posait problème : impression qu’il n’était pas en capacité de s’approprier/comprendre cette culture de masse o Il montre comment les nouvelles formes de communication s’intègrent à la vie quotidienne de la classe populaire (magazine, tabloïds, littérature de gare… qui forment une culture populaire) o Il reste méfiant face à l’industrialisation de la culture car elle apparaît comme une culture sans visage qui menace d’engloutir cette culture populaire (point négatif dans cette vision positiviste) o Il observe une forme de défiance des couches populaires face à l’industrialisation de la culture : la culture populaire serait une défense contre cette culture de masse sans visage o Il déplace la réflexion du conditionnement des masses vers la question de l’adhésion éclipse, de l’attention oblique qui sont des pratiques de réception que les classes populaires mettent en œuvre pour résister au monde dominant o Adhésion éclipse, attention oblique : classe populaires seraient partiellement sauvegardée de la culture de masse par leur ancrage très fort dans leur culture de communauté, qui ne leur laisse qu’une attention partielle de cette culture de masse qui évite la manipulation totale o Démonstration que la culture de masse peut exprimer un fort ethnocentrisme de masse : rend hommage à la classe dominante o La seule réserve face à Hoggart : ne permet pas de saisir les effets à long de terme des médias de masse (et surtout TV) et de la culture de masse sur la culture (en général et surtout populaire)
-
Une autre référence : Raymond Williams (50’) o Pour qui la culture ne peut être dissociée de l’évolution de la société o Culture and Society (1958) et The Long Revolution (1965) o Il définit dans Culture and Society : La culture comme un processus global à travers lequel les significations sont socialement et historiquement construites La culture se construit à partir d’une interaction et l’histoire se construit à partir d’une interaction entre culture et économie
o
The Long Revolution : Ouvrage fondateur du Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) Rupture avec le « marxisme réducteur » développé par Althusser Propose une « marxisme complexe », permettant d’étudier le rapport entre la culture et les autres pratiques sociales : Tout n’est pas déterminé par la superstructure économique (gestion du sociale et du politique participe à la production d’un ordre social, mais activités ne sont pas superstructurelles et ne déterminent pas l’ensemble des idées d’une société) Ces activités sont des activités de la classe gouvernante historiquement ancrées Critique le déterminisme idéologique et technologique et étudie davantage les formes historiques des institutions médiatiques Questionne l’idée même de masse qui recouvre uniquement l’univers social, culturel et politique des classes laborieuses issues de l’industrialisation La culture de masse n’est pas inférieure jugement de valeur d’affirmer le contraire, jugement qui provient d’une minorité Dualité culturelle observée (culture d’élite/ culture de masse) : reflète domination sociale et structurelle exercée par une minorité qui contrôle les appareils de diffusion de la culture et reproduit son pouvoir sur une majorité
Rappel : (selon Marx) - Structure : composée des conditions de production, des forces productives et des rapports de productions - Superstructures : productions non-matérielles, ensemble des idées d’une société, renvoie à la religion, la philosophie, la pensée, l’art, la politique, la conscience de soi… - Entre les 2 : rapport de détermination
En résumé, les origines… - La maturation des courants de pensée des Cultural Studies s’achève avec l’ouvrage The Popular Arts de S. Hall et P. Whannel (1964) : s’intéresse + spécifiquement au cinéma - La période des origines regroupe des travaux qui réfléchissent à l’interaction sociale de la culture de masse - Nécessité pour ces chercheurs d’étudier les cultures vivantes - Fondation du CCCS qui permet de développer et d’approfondir ces théories
Le Centre of Contemporary Cultural Studies (CCCS) : - Fondé en 1964 à Birmingham et fermé en 2002 - Centre d’études sur les formes, les pratiques et les institutions culturelles et travaille leur rapport à la société - Premier directeur : Hoggart (jusqu’en 1968), puis Stuart Hall (jusqu’en 79) - Travail sur une définition élargie de la communication, englobant une grande variété d’expressions culturelles : o Thèmes divers : culture populaire, subculture, études médiatiques, queer studies…
o o
Approches théoriques interdisciplinaires : marxisme, post-structuralisme, féminisme, théorie critique raciale… Méthodes variées : sociologie, ethnographie, théories du langage, littérature
Les subcultures : - Forme de négociation depuis sa position (ici classe ouvrière) avec l’hégémonie culturelle - Mélange de structures culturelles, hybridation entre plusieurs typologies de cultures - A ne pas confondre avec les contre-cultures - Certains chercheurs se sont intéressés aux cultures juvéniles (Phil Cohen, Paul Wilis et Dick Hebdige) refus du conformisme, anti système social et école, autres modalités (musicales, artistiques, mode…), se réapproprient les codes d’une autre culture en mélangeant à ceux d’une culture parentale - Le style des subcultures : bricolage consistant à transformer les objets marchands, les adapter et se les réapproprier pour produire une identité propre à un groupe - Ex de subcultures : les Teddy Boys, les Mods, les Skinheads… - A ne pas confondre avec les contre-cultures qui interviennent à l’intérieur même d’une classe moyenne, + rupture qu’adaptation, le refus ne se fait pas par une position en marge mais depuis l’intérieur de la culture dominante
L’influence de Gramsci : - Les chercheurs du CCCS influencés par différents auteurs : R. Williams, L. Althusser, A. Gramsci - Influence d’Antonio Gramsci fournit au CCCS la notion d’ hégémonie : o Capacité d’un groupe social à exercer une direction intellectuelle et morale sur la société o Dépasse la notion de « classe dominante » et remplace celle d’« idéologie » (ramène la question du conflit entre les acteurs et pas que entre les idées) o Introduit dans l’analyse du pouvoir la nécessité de considérer les négociations, les compromis et les médiations (ce que ne met pas en avant Marx) - A partir de cette notion, on glisse vers celle d’hégémonie culturelle : o Décrit la domination culturelle d’un groupe/une classe sur un autre groupe ou une société o Se caractérise par le rôle des pratiques quotidiennes des individus dans ce système de domination - Se détache de Marx o Schéma prédictif (révolution) n’a pas eu lieu, se questionne : pourquoi ? : échec de révolution par la working class dû à un phénomène d’emprise exercé par la culture hégémonique instaurée par la bourgeoisie au pouvoir o Emprise + forte des représentations culturelles que prévu par Marx - Adopte une stratégie en 2 temps : o Guerre de position : guerre culturelle contre la bourgeoisie et les valeurs véhiculées. Nécessite des soldats sur le terrain (ici culturel) : essayer de se faire embaucher dans les institutions médiatiques de masse (médias, écoles…) infiltration progressive
Guerre de mouvement : après l’installation des idées marxistes à l’aide de la guerre de position, commencement de la guerre contre le capitalisme avec le support des médias de masse et de la population Refus d’aligner mécaniquement les productions culturelles et idéologiques sur celles de classe et de base économique (comme pouvait le faire Marx) Question mise en avant : la société civile est distincte de l’Etat, et son action là où il n’y que domination, cette action c’est la stratégie en 2 temps ci-dessus là où sévit le plus l’hégémonie C’est Stuart Hall qui sera le principal « traducteur » de la pensée de Gramsci o
-
Gramsci selon Hall : - La culture est pensée comme un ferment révolutionnaire - Apport majeur donc avec le concept d’hégémonie, deux significations principales : o Processus de formation du consentement par lequel une classe accède au pouvoir o Mode d’exercice du pouvoir existant à travers un équilibre en « société politique » et « société civile » o Pour Gramsci, pour que la classe prolétaire se constitue en classe hégémonique, il y a une nécessité de maintenir une lutte idéologique - A partir de là, Hall développe une théorie de la culture « comme un espace de conflictualité idéologique selon laquelle le discours constituerait le moyen d’un affrontement visant le contrôle de la signification » (Cervulle et Quemener, 2017)
Les recherches : - Question de la société civile distincte (notamment dans son discours) de l’Etat mise en avant - Au début, recherches largement centrées sur des objets jugés « illégitimes » (issus de la culture pop comme soap-opéra, roman de gare…) avec cette étude, on arrive à des théories de la communication jamais travaillées auparavant - Mais analysés avec des outils universitaires ! - Réflexion autour d’un espace public « populaire » - De nombreux questionnements autour des rapports de pouvoir (notamment résistance de la classe pop), des mécanismes via la culture… Les questions posées recouvrent une problématique nouvelle : o Comment les classes populaires se dotent-elles de systèmes de valeurs et d’univers de sens ? (Qu’est-ce qui les construit comme public par rapport à la culture qu’elle consomme ?) o Quelle est l’autonomie de ces systèmes ? (En quoi et pourquoi autonome à la culture main stream ?) o Quelle est leur contribution à la constitution d’une identité collective ? o Comment s’articulent dans les identités collectives des groupes dominés les dimensions de la résistance et d’une acceptation de cette subordination ? (part de résistance et de soumission à cette culture de masse dans les cultures pop) - Appréhender les contenus idéologiques d’une culture et ses enjeux dans la société - Pour y répondre, développement de l’attention portée aux médias audiovisuels - Un exemple d’étude des cultural studies : o Les médias studies : intérêt pour la réception des émissions (notamment télévisuelles) et la manière dont les publics de ces médias décodent les contenus audiovisuels
o Concepts clef : médias, audience, rapport des institutions - Grand mixage de différentes influences (comme école de Chicago par exemple) Stuart Hall, vers les études de la réception : - Hall travaille sur le rôle idéologique des médias et leur nature (pas si éloigné de Barthes) - Un texte fondateur : Encoding-decoding Il s’oppose à la théorie qui dit que les effets idéologiques des médias pourraient être directement déduits de l’analyse des messages diffusés, pour lui c’est plus complexe. - Il confronte le texte (message), l’institution qui le produit et l’histoire sociale des récepteurs - Volonté d’ouvrir la « boîte noire » de la réception, Hall dégage moments dans ce processus de communication télévisuelle : o La production partie codage o La circulation médiation, forme discursive de l’idéologie (écrite ou orale) o La distribution décodage pour les publics, façon d’interpréter le discours et le transformer dans les cadres d’interprétation qui lui sont propres o La reproduction audience qui fait monter ou baisser la popularité de l’émission - Le produit de ce processus de reproduction communicationnel circule sous une forme discursive - Le discours correspond à une articulation du langage sur des rapports et des conditions réelles de production et de réception de ce discours. Cette articulation nécessite un code, sinon pas de lien entre circulation et distribution.
-
Echange communicationnel possible que par le biais du discours Entre codage et décodage : 2 structures de sens (celle du producteur et celle du récepteur) Cadres de connaissance : culture mobilisée de part et d’autre (similaires) Rapport de production : renvoient aux relations de force asymétriques entre producteur et audience - Infrastructures techniques : l’audiovisuel des 2 cotés qui permet la transmission du discours Cheminement du discours Parfois, rapport codage/décodage ne sont pas symétriques, pb de communication quand asymétrie des structures de sens (par exemple un film qui fait un flop car ne vise pas bien son public) - Hall explique ensuite que ces codes ont des effets idéologiques, masqués par l’apparence naturelle de la pratique du codage (cf. Barthes et caractère naturalisation des objets de la communication de masse)
-
Pour Hall, le code dominant n’est pas un processus unilatéral MAIS un cadrage interprétatif par rapport à l’horizon supposé du récepteur Il y aurait un certain degré de réciprocité entre codage et décodage afin de permettre une communication Prise en compte des attentes de l’audience implique le codage va se faire en fonction du décodage anticipé du public Décodage par l’audience effectué selon 3 modes : o Le code social dominant (point de vue hégémonique, naturel) o Un code négocié (s’accorde globalement au code hégémonique de la réalité mais dans une logique de situation qui les remet partiellement en cause = mélange d’éléments d’opposition et d’adaptation qui souscrit en partie aux valeurs dominantes mais aussi d’une expérience perso qui permet de réfuter) o Un code oppositionnel (retraduit dans une logique propre, s’approprier la totalité du message, correspond à l’interprétation d’un autre code de référence)
A travers le thème de l’identité : - Les Black cultural studies o Emergence dans les 80’ dans les universités américaines de débats violents autour de l’ethnocentrisme scientifique blanc o 2 courants naissent de ces débats : Etudes sur les identités raciales Etudes postcoloniales o Les black studies US étudient les mécanismes de reproduction de l’idéologie raciste (blanche), par exemple dans les médias et travaillent les formes de résistance o Plusieurs auteurs US majeurs : Bell Hooks (modalité de racialisation dans la culture pop américaine à travers 2 axes : marchandisation de l’identité noire + fétichisation du corps des femmes noires) Jacquiline Bobo o Influence des CCS à travers 2 ouvrages collectifs : analyses critiques des dimensions matérielles du racisme dans les 70’ et 80’ Policing the Crisis (1978) The Empire strikes Back (1982) Le travail de Hall sur ces questions : « la race est la modalité par laquelle la classe est vécue » « le racisme serait un effet de la structure sociale capitaliste et un levier de sa reproduction » o Naissance du sous-courant Black British Cultural Studies (courant UK) -
Les queer and gender studies o Apparition dans les 90’ et création du terme « queer theories » ((gender studies, woman studies et queer studies) De Lauretis, 1990), inspiré de mouvements féministes o Réflexion autour de la triple thématique race/classe/genre o Se démarquer des théories LGBT qui stigmatisent et unifient trop superficiellement les différentes identités
o o
o
o
o
Filiation avec les cultural studies analyse des médias et de la pop culture comme lieu des « reconfiguration des normes de genre et de sexe » Essayer de comprendre « la place des formations culturelles lesbiennes et gays dans le changement social », comment ça émerge, pourquoi à ce moment-là, comment perdure ? Plusieurs ouvrages publiés simultanément en 1990 : Judith Butler, Trouble dans le genre Eve Sedgwick, Epistémologie du placard Catégories de sexes répondent à des normes sociales (on le sait depuis De Beauvoir) mais ici concerne aussi le biologique qui détermine la vision des attributs physiques et des comportements selon le sexe Seconde vague théorique qui va élargir la problématique aux rapports entretenus par le genre et la sexualité avec le capitalisme, le racisme et les imaginaires nationaux et la mondialisation approche intersectionnelle qui envisage les inégalités à travers différents champs
Stuart Hall, en conclusion : - Hall rompt avec l’idée de médias manipulateurs, exerçant un contrôle idéologiques absolu sur les audiences - Contribue à déplacer les recherches de l’attention au produit culturel vers celui qui le reçoit (récepteur) (du message vers son audience) - Préfigurant ainsi les études contemporaines en réception, notamment sur l’influence des médias - Réfutation de l’idée de culture de masse et nécessité d’une analyse centrée sur la distribution différentielle des produits culturels (produit culturel reçu de manière différente) - Ces codes qui apparaissent naturels sont souvent le fait de représentation empreinte d’idéologie Les courants critiques, conclusion : - 3 grands courants (Ecole de Francfort, Structuralisme, Cultural Studies) s’interrogent tous sur les conséquences du développement des nouveaux moyens de production et de tr...
Similar Free PDFs

VI- Les cultural studies
- 9 Pages

CULTURAL STUDIES
- 7 Pages

Cultural Studies Task 2
- 3 Pages

212812840-Cultural-Studies
- 153 Pages

Cultural Studies complete PDF
- 44 Pages
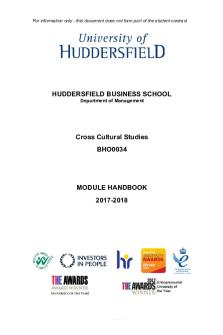
Cross Cultural Studies
- 9 Pages

Cultural studies notes
- 2 Pages

Cultural studies social theory
- 23 Pages

I Cultural Studies
- 6 Pages

Cultural Studies So Se 2021
- 30 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu





