Sociologie-politique sujet examen L1 PDF

| Title | Sociologie-politique sujet examen L1 |
|---|---|
| Course | Sociologie Politique |
| Institution | Université Toulouse I Capitole |
| Pages | 122 |
| File Size | 3.3 MB |
| File Type | |
| Total Downloads | 59 |
| Total Views | 130 |
Summary
Sujet de l'examen de sociologie de L1 2019-2020 Toulouse. Questions de cours...
Description
SED 2018 - 2019
Semestre Impair
Sociologie politique
Université Toulouse Jean Jaurès – Service d’Enseignement à Distance 5 allées Antonio Machado 31058 Toulouse cedex 9 Tél : +33 (0)5 61 50 37 99 – Mail [email protected] – Site : sed.univ-tlse2.fr
Reproduction et diffusion interdites sans l’autorisation de l’auteur-e
Sommaire
Sociologie politique Enseignants : Christelle Manifet, Vincent Simoulin
Reproduction et diffusion interdites sans l’autorisation de l’auteur
SOCIOLOGIE POLITIQUE UE DE SPECIALITE DE L’ANNEE DE L3 SEMESTRE 5 CODE UE : SOB0503V ENSEIGNANT.E.S AUTEUR.E.S : CHRISTELLE MANIFET (CM) & VINCENT SIMOULIN (VS) Courriels: [email protected] [email protected]
3
INTRODUCTION GENERALE (l’introduction a été rédigée par Vincent SIMOULIN)
1. Les objectifs du cours. Ce cours est un cours d’option qui a par nature à la fois pour objectif d’approfondir un domaine spécialisé, de préparer une spécialisation personnelle et de contribuer à votre connaissance de la sociologie générale en fournissant des éléments plus précis sur un domaine de la vie sociale. Comme d’autres, par exemple la sociologie du genre, la sociologie politique a en effet un caractère transversal puisqu’elle désigne fondamentalement l’ensemble des mécanismes qui permettent aux êtres humains de prendre des décisions collectives. Étymologiquement, le terme « politique » désigne tout ce qui touche aux affaires de la cité, la « polis ». A ce titre, la sociologie politique a un objet non seulement très large mais qui est également abordé depuis longtemps et par de multiples disciplines (histoire, philosophie, etc). Le premier objectif de ce cours est de définir la sociologie politique. La façon a priori la moins contestable de le faire consiste à la réduire à l’étude des objets et des faits politiques (élections, parlements, etc). Mais certains contesteront justement la modestie excessive de cette approche et soutiendront que la sociologie politique a vocation à étudier tout ce qui consiste à « organiser et diriger la vie en société » 1. En fait, le problème est surtout de savoir si l’on insiste sur « sociologie » ou sur « politique ». Si l’on insiste sur « politique », on peut alors considérer que l’objet de la sociologie politique est les modes de gouvernement des hommes et il n’y a plus alors de limites ni en termes de date (la sociologie politique a toujours existé) ni en termes d’ambition (la sociologie politique peut quasiment tout étudier et se présente comme une rivale plus ou moins déclarée de toutes les autres sciences sociales). Si l’on insiste sur la sociologie, on se limite à la période qui suit la révolution industrielle et plutôt aux objets spécifiquement politiques. Le second objectif est de fournir des éléments sur les principales théories qui ont abordé la sociologie politique, ce qui permettra à la fois de s’appuyer sur les cours d’histoire de la pensée et des théories sociologiques, et de les revoir partiellement. En voyant ici Worms et Grémion par exemple, on ne voit en effet pas seulement des analyses qui prétendent restituer la vérité d’une époque (ici celle de la France de l’après seconde guerre mondiale), mais aussi des modèles de la façon dont il faut aborder un terrain et des théories qui s’appuient sur un courant sociologique plus général (ici la sociologie de l’acteur). Le troisième objectif est de fournir des éléments théoriques et méthodologiques sur des points précis tels que la mise sur agenda ou les modalités de l’européanisation. Il s’agit ici à la
1
Jacques Lagroye. Sociologie politique. Paris : Presses de la FNSP, 1991, p 25.
2
4
fois de comprendre notre réalité contemporaine mais aussi de fournir aux étudiants les moyens pour aborder eux-mêmes leurs terrains qui, tous, sont traversés par ces logiques. 2. Plan du cours. Pour atteindre ces objectifs, on adoptera un plan en 5 parties : Introduction générale 1) Introduction à la sociologie politique 2) Panorama des institutions politiques 3) Le pouvoir 4) Le problème du changement politique 5) L’européanisation des politiques publiques 3. Modalités d’évaluation. En ce qui concerne l’examen, les sujets (il y en aura 1 seul par session) ne seront pas de simples questions de cours, même si le cours sera bien entendu absolument nécessaire pour les traiter. Ce seront des questions transversales qui réclameront non seulement de connecter des parties séparées du cours, de construire une argumentation mais aussi d’avoir procédé à quelques lectures au sein au moins des auteurs présentés en cours, et même dans l’idéal un peu plus loin. La forme sera très importante, avec bien sûr des points qui seront retirés en fonction des fautes de langue. Le hors-sujet est le critère qui disqualifie le plus grand nombre de copies. 4. Bibliographie et sources d’information. En ce qui concerne la bibliographie, elle est réduite mais de qualité. Elle indique pour l’essentiel des manuels ou outils de travail que vous avez intérêt à regarder, à connaître et à consulter régulièrement. D’autres ouvrages ou articles plus spécifiques seront signalés au fur et à mesure des cours. Les ouvrages ou articles présents dans cette bibliographie seront simplement signalés par le nom de l’auteur (ou des auteurs) et la date entre parenthèses dans la suite de ce cours.
3
5
MANUELS BAUDOUIN J. (1998), Introduction à la sociologie politique, Le Seuil, Collection Points, Paris. BOUSSAGUET L., JACQUOT S., RAVINET P. (dir) (2004) Dictionnaire des politiques publiques, Presses de Science Po. GAUDIN J.P. (1993), Les nouvelles politiques urbaines, PUF, Que sais-je ?, n° 2839, Paris. GRAWITZ M., LECA J. (dir) (1985) Traité de Science Politique, 4 Tomes, PUF, Paris. LAGROYE J. (1993), Sociologie politique, Presses de la Fondation nationale de Sciences politiques & Dalloz, Paris. LASCOUMES P., LE GALES P. (2007), Sociologie de l’action publique, Coll 128, A. Colin. MOREAU DEFARGES P. (2003), La gouvernance, Que sais-je ?, PUF, Paris. MASSARDIER G. (2003), Politiques et action publiques, A Colin, Paris. MENY Y., THOENIG J.C. (1989), Politiques publiques, Thémis, PUF, Paris. MULLER P. (1990), Les politiques publiques. Que sais-je ? PUF, Paris. MULLER P., SUREL Y. (1998), L’analyse des politiques publiques. Ed. Montchrestien. Coll. Clefs/Politique. Paris. OUVRAGES DE REFERENCE BEZES P. (2009), Réinventer l’Etat. Les réformes de l’administration française. Paris : PUF. CHEVALLIER J. (2003), L’Etat post-moderne, LGDJ. LASCOUMES P., LE GALES P. (dir) (2004), Gouverner par les instruments, Presses de Sciences Po. BLONDIAUX L. (2008), Le nouvel esprit de la démocratie, Seuil, Paris. COBB R., ELDER C. (1975), Participation in American Politics : the Dynamics of agenda building, Baltimore, John Hopkins University Press. CROZIER M. (1963), Le Phénomène bureaucratique. Paris : Seuil. CROZIER M., FRIEDBERG E. (1977), L'acteur et le système, Le Seuil, Paris. DUBOIS V. (1999), La vie au guichet. Relation administrative et traitement de la misère, Economica, Paris. DUPUY F, THOENIG JC (1985), L'administration en miettes, Fayard, Paris. DUPUY F., THOENIG J.C. (1983), Sociologie de l’administration française, A COLIN, Paris. DURAN P. (1999), Penser l’action publique, LGDJ, Paris. ELIAS N. (1991), La dynamique de l’Occident, Paris, Calmann-Lévy. FRIEDBERG E. (1993), Le pouvoir et la règle, Le Seuil, Paris.
4
6
GAUDIN J. P. (1999), Gouverner par contrat. L'action publique en question, Paris, Presses de la Sciences Po. GAUDIN J. P. (2014), Critique de la gouvernance. Une nouvelle morale politique ?, La Tour d’Aigues, Editions de L’Aube. GREMION P. (1976), Le pouvoir périphérique, Le Seuil. HALPERN C., LASCOUMES P., LE GALES P. (dir) (2014), L’instrumentation de l’action publique. Paris, Presses de Sciences Po. HIRSCHMANN A. O. (1991), Deux siècles de rhétorique réactionnaire. Paris, Fayard. JOBERT B., MULLER P. (1987) L’Etat en action, Paris, P.U.F. JOBERT B. (1994), Le Tournant néo-libéral en Europe. Idées et recettes dans les pratiques gouvernementales. Paris : L'Harmattan. KINGDON J. W. (1984), Agendas, Alternatives and Public Policies, Boston, Little, Brown and Company. LIPSKY M. (1980), Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services, New-York, Russell Sage Foundation. POWELL W. W., DiMAGGIO P. J. (dir) (1991), The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago, University of Chicago Press. SELZNICK P. (1949), TVA and the Grass Roots. A Study in the Sociology of Formal Organization, Berkeley, University of California Press. THELEN K., STREECK W. (2007), Beyond Continuity. Institutional Change in Advanced Political Economies, Oxford, Oxford University Press. WARIN P. (1991), Les usagers dans l'évaluation des politiques publiques : étude des relations de services, Paris, L'Harmattan. WARIN P. (1997), Quelle modernisation des services publics ? Les usagers au cœur des réformes, Paris, La Découverte. WEBER M. (1919), Le savant et le politique, Paris, Plon. WEBER M. (1921), Economie et société, 2 tomes, Paris, Plon. WELLER J. M. (1999), L'État au guichet. Sociologie cognitive du travail et modernisation administrative des services publics, Paris, Desclée de Brouwer. ARTICLES DE REFERENCE BAJOIT G. (1988), « Exit, voice, loyalty… and apathy, les réactions individuelles au mécontentement », Revue Française de Sociologie, XXIX, pp. 325-345. COHEN M., MARCH J., OLSEN J., (1972) "A Garbage Can Model of Organizational Choice". Administrative Science Quarterly. Vol 17, Mars, pp. 1-25. CROZIER M., THOENIG J.C. (1976), « La régulation des systèmes organisés complexes. Le cas du système de décision politico-administratif local en France », Revue Française de Sociologie, 16/1, janvier-mars, pp. .
5
7
DiMAGGIO P. J., POWELL W.W. (1991), "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields". In (pp 63-82) : Walter W. POWELL, Paul J. DiMAGGIO. The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago : University of Chicago Press, 1991, 478 p. DURAN P., THOENIG J. C. (1996), « L’Etat et la gestion publique territoriale », Revue Française de Science Politique, vol 46, n°4, pp. 580-623. EPSTEIN R. (2005) « Gouverner à distance. Quand l’Etat se retire des territoires », novembre, pp. 96-111.
ESPRIT,
GARRAUD P. (1990), « Politiques nationales. Elaboration de l’agenda », L’Année sociologique, Vol. 40, pp. 17-41. GAUDIN J.P. (1995), « Politiques urbaines et négociations territoriales », Revue Française de Science Politique, vol 45-n°1, février 1995, pp. 31-55. HALL P. A. (1993), « Policy Paradigms, Social learning, and the State. The Case of Economic Policymaking in Britain. », Comparative Politics, Vol 25, n° 3, pp. 275-296. HALL P. A., TAYLOR R. (1997), « La science politique et les trois néoinstitutionnalismes », Revue française de science politique, Vol. 47, n° 3-4, pp. 469-496. HANNAN M. T., FREEMAN J. H. (1977), "The Population Ecology of Organizations". American Journal of Sociology, 82, pp. 929-964. HANNAN M. T., FREEMAN J. H. (1984), "Structural Inertia and Organizational Change". American Sociological Review, 49, pp. 149-164. LE GALES P. (1992), « Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine », Revue Française de Science Politique, vol42, n°2, avril 1992, pp57-95. LORRAIN D. (1993), « Après la décentralisation, l’action publique flexible », Sociologie du Travail, 3, pp. 285-307. LORRAIN D. (1998), « Administrer, gouverner, réguler », Les Annales de la Recherche Urbaine, 80-81, Paris, pp. 85-92. PALIER B., SUREL Y. (2005), « Les trois « I » et l’analyse de l’Etat en action », Revue française de science politique, Vol. 55, n° 1, pp. 7-32. PIERSON P. (2000), « Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics ! », American Political Science Review, 94 (2), pp. 251-267. SIMOULIN V. (2003), « La gouvernance et l’action publique : le succès d’une forme simmélienne », Droit et société, 54, pp. 307-328. STONE C. N. (1993), « Urban regimes and the capacity to govern : a political economy approach », Journal of urban affairs, vol 15, n° 1, pp. 1-28. WORMS J.-P., (1966), « Le préfet et ses notables », Sociologie du travail, n° 3/66, pp. 249269. REVUES DE REFERENCE American Journal of Political Science American Journal of Sociology
6
8
American Sociological Review British Journal of Political Science British Journal of Sociology Droit et Société Gouvernement et action publique L’Année sociologique Politique européenne Politiques et Management Public Politix Pouvoirs locaux Revue Française d’Administration politique Revue Française de Science Politique Revue Française de Sociologie Sociologie du Travail Sciences de la Société Sociétés contemporaines Sociologies Pratiques
… 9
7
10
INTRODUCTION A LA SOCIOLOGIE POLITIQUE (Cette partie a été rédigée par Vincent SIMOULIN) Il faut commencer par présenter les approches qui se sont succédées historiquement car dans une discipline qui consiste à orienter les choix collectifs, les mots sont importants. Ce n'est par exemple pas du tout la même chose de parler d'administration publique et d’action publique. De ce point de vue, on peut sans doute dire que les regards portés sur la sociologie politique ont schématiquement été de quatre ordres et ont plus ou moins persisté, même si, historiquement, on est clairement passé d
1.1 L’Antiquité et l’invention de la science politique. Comme on l’a évoqué en introduction, on peut tout d’abord se demander si la sociologie politique peut aborder toutes les collectivités humaines ou si c’est une approche qu’on doit réserver aux sociétés contemporaines. Parler de « sociologie politique », c’est affirmer la scientificité de la discipline, rompre avec la logique d’Aristote et de Montesquieu qui insistaient sur les conditions, le milieu, le climat. C’est mettre au premier plan des objets différents et plus modernes comme les partis, les élections, le fonctionnement des administrations modernes et somme toute de cette forme moderne du gouvernement des hommes qu’est l’État-nation, aujourd’hui remise en cause par la mondialisation. C’est donc une définition qui est intimement liée à la façon dont la sociologie s’impose au cours du XIXème siècle comme science visant à l’observation et à la réforme des sociétés modernes, c’est-à-dire dotées d’une écriture, d’une histoire et d’institutions démocratiques. Ce n’est pas seulement un progrès car cette constitution a partie liée avec le « grand partage » entre sociologie et anthropologie qui attribue à cette dernière le reste du monde, c’est-à-dire en gros les sociétés sans écriture, sans histoire et sans institutions. On a d’ailleurs aujourd’hui une anthropologie politique très développée, dont Marc Abélés et Yves Pourcher sont par exemple des représentants importants en France, qui étudie des objets aussi « modernes » que le Parlement européen, des conseils généraux ou des carrières d’hommes politiques en prenant en compte leur rapport au corps ou aux symboles, le discours et le symbolique étant bien évidemment des éléments particulièrement importants de l’activité politique. Pour autant, même si ne sera pas l’optique de ce cours et si l’on n’insistera donc pas ssur cette première approche ici, on peut aussi insister sur “politique” plus que “sociologie”, et on doit noter alors que, selon nombre de commentateurs 2, l’Antiquité marque une rupture et on ne peut pas considérer exactement de la même façon les peuples qui la suivent et ceux qui en sont tenus à l’écart. C’est à ce moment historique que se serait mise en branle une séparation 2
Dominique Colas. Sociologie politique. Paris : PUF, 1994.
8
11
entre ce que Pierre Clastres 3 appelle les sociétés sans État (celles où il n’y aurait pas de gouvernant susceptible de contraindre par le verbe ou par les armes les autres membres) et les « sociétés avec État » (celles où il y aurait un pouvoir coercitif). Dans cette perspective, la science politique est réellement apparue chez les Grecs et notamment avec Socrate (469-399 av JC), Platon (422-347 av JC) et Aristote (384-322 av JC) qui dit de l’homme qu’il est « un animal politique ». Il signifie par là que c’est un membre de la « polis », de la cité, c’est-à-dire concrètement Athènes au cinquième siècle avant JésusChrist. Il est le membre d’une communauté politique organisée. Cette première approche, la philosophie politique, dit que la politique est un art et non une technique. Elle requiert un tour de main, un discernement, et son objectif est de permettre à l’homme d’accomplir aussi complètement que possible sa nature humaine 4. La question fondamentale posée par ces penseurs antiques est de se demander quel est le meilleur régime (mode d’organisation et d’exercice du pouvoir politique), ce qui signifie que les aspects descriptifs et normatifs se mêlent totalement pour les philosophes grecs. Une analyse détachée et objective, qui n’aurait pas eu pour but d’identifier le meilleur type de gouvernement des hommes, celui qui serait le plus conforme à la raison, ou de définir les hommes les plus qualifiés pour diriger la cité, n’aurait eu aucun sens pour eux. On est clairement dans une approche morale et aristocratique. Pour tous les philosophes grecs, et encore dans une certaine mesure pour Montesquieu qui est, près de deux mille ans plus tard, encore un représentant de cette approche, l’essentiel est que les gouvernants soient de qualité, bien formés et tournés vers le bien de la cité et de ses habitants. On est dans une logique de philosophie politique, une approche qui a longtemps été la seule et a eu tellement d'importance historique qu'il faut l'évoquer si on veut comprendre certains des problèmes qui se posent et se poseront toujours car l'action publique aura toujours une composante normative. 1.2 La recherche de l’État rationnel. Avec la constitution des Etats modernes au cours du Moyen-âge, l’envergure des territoires change complètement par rapport à une philosophie grecque qui pensait le pouvoir à l’échelle de la cité. On entre dans une logique de droit et de science politique, où l’objectif (principal) n’est plus de réfléchir à la qualité des gouvernants, mais au maintien de l’unité territoriale. Les questions dominantes deviennent celles de la souveraineté et de la permamence de l’Etat. Machiavel (1469-1527) est celui qui incarne le plus totalement cette approche. Dans Le Prince (1513), il conseille au souverain de cajoler, d’user de la crainte et de la cruauté, bref d’utiliser les moyens adaptés à la conquête et à l’exercice du pouvoir. Il rompt ainsi avec la tradition morale des Grecs et justifie le mal au nom de la nécessité car les hommes ne sont pas naturellement bons mais méchants. Hobbes (1588-1679) poursuit dans cette voie dans Le Léviathan (1651) en analysant les hommes comme « des loups pour l’homme ». La solution est le contrat social où chacun sacrifie une part de sa liberté pour fonder un État qui garantira les conditions de sa sécurité. 3 4
Pierre Clastres. La société contre l’État. Paris : Minuit, 1974. Philippe Bénéton. Introduction à la politique. Paris : PUF, 1997.
9
12
a) La découverte de l'État moderne. Dans cette logique, illustrée par toute une série de juristes (pour qui la question centrale est celle de la défense de la souveraineté nationale et de l'unité territoriale) puis par Hegel (17701831 ; Principes de la philosophie du droit ou droit naturel et science de l'État en abrégé, 1821), Marx (1818-1883 ; Critique du droit politique hégélien, 1843) et Weber (1864-1920), la question dominante est celle de l'État. Il est analysé comme le principal fruit et vecteur du , comme une forme historique nouvelle de régulation de la société. Cela a des avantages et une certaine efficacité. voit même . Dans la perspective de
, c'est bien sûr différent car
. La démocratie n’apparaît plus que comme « formelle » et non « réelle » (Critique du droit politique hégélien, 1843) en ce qu’elle cache et a ...
Similar Free PDFs

Sociologie-politique sujet examen L1
- 122 Pages

Sujet examen texte RSE
- 10 Pages

Sujet 1 - examen HCI - DV
- 3 Pages

Tp-6-sujet - Tp-6-sujet
- 5 Pages

Td2 sujet
- 2 Pages

Sujet 04
- 3 Pages

L1
- 9 Pages

Programme L1
- 14 Pages

Sujet d expression ecrite
- 45 Pages

Sujet CT janvier
- 3 Pages

DM-Revision - Sujet DM
- 1 Pages
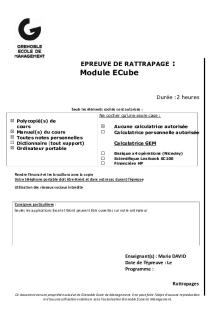
Charlotte Bimet Sujet Individuel
- 9 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu



