ECG 2020 - ECG - LE TOURNEAU PDF

| Title | ECG 2020 - ECG - LE TOURNEAU |
|---|---|
| Author | Noémie Boughelilba |
| Course | Physiologie vasculaire |
| Institution | Université de Nantes |
| Pages | 7 |
| File Size | 506 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 22 |
| Total Views | 188 |
Summary
ECG - LE TOURNEAU ...
Description
ECG – LE TOURNEAU – Physiologie I.
Introduction
L’ECG (électrocardiogramme) enregistre les variations de potentiels électriques qui résultent de la dépolarisation et de la repolarisation de l’ensemble des cellules cardiaques, en fonction du temps . IL analyse l’activité électrique de l’ensemble des cardiomyocytes. Les variations de potentiel sont transmises par les tissus et recueillies par des électrodes (ou ECG invasif mais + rare). ECG standard (normal) : 12 dérivations = 2 séries de dérivations : 6 frontales (D1, D2, D3, aVL, aVR, aVF) et 6 précordiales (V1 – V6). En pratique, on place 10 électrodes : 4 au niveau des membres et 6 au niveau thoracique.
II.
Electrophysiologie
1. Potentiel d’action Au niveau cellulaire, on retrouve le PA. L’ECG traduit sur papier les variations de potentiel cellulaire. On a une onde (déflexion) enregistrée sur le papier de l’ECG que si on a une variation de potentiel. Ce sont les variations de potentiel des cellules myocardiques contractiles que l’on enregistre. On analyse aussi, mais indirectement, les variations du tissu nodal (trop peu de cellules).
ECG de surface : En phase 0, lorsqu’on a une dépolarisation (courant électrique positif) : variation de potentiel = onde R En phase 3, lorsqu’on a une repolarisation (courant électrique négatif) : variation de potentiel = onde T Pendant la phase de plateau, phase 2, on n’a pas de variation de potentiel = pas d’onde sur l’ECG : ligne plate isoélectrique
2. Dipôle électrique
Au repos, la cellule cardiaque est polarisée, avec une prédominance de charges négatives au niveau de la membrane cellulaire interne et une prédominance de charges positives au niveau de la membrane cellulaire externe = état d’équilibre entre les charges – intra et les charges + extracellulaires. L’activation cellulaire provoque une dépolarisation, on va avoir une inversion du potentiel membranaire = inversion de l’équilibre électrique, qui part d’une cellule et se propage à toutes les autres cellules. Théorie du dipôle d’Einthoven : à l’étage cellulaire, la cellule commence à se dépolariser à une extrémité, et la dépolarisation se propage à l’autre extrémité = création d’un dipôle. On peut étendre cette théorie à l’ensemble du myocarde, on a une partie dépolarisée et une partie pas encore dépolarisée. On a donc un dipôle électrique, avec un pôle négatif au niveau de la partie déjà dépolarisée et un pôle positif au niveau de la partie qui n’est pas encore dépolarisée. Dipôle électrique : les cellules ne se dépolarisent pas toutes en même temps création d’un pôle négatif et d’un pôle positif = théorie de Einthoven. « La différence de polarité entre les cellules dépolarisées et celles encore au repos créée ce dipôle. » Le courant dépolarisant est un courant à charge positive. Le courant repolarisant est un courant à charge négative mais avec un courant électrique opposé à la dépolarisation (mais attention : la repolarisation nait au même endroit que l’endroit où est née la dépolarisation : même sens de propagation).
Les électrodes cutanées sont disposées à différents endroits du corps, par rapport au cœur, par rapport à la direction de la dépolarisation. Si l’électrode cutanée est située juste en face du courant dépolarisant, on va avoir sur l’ECG une déflexion positive (arrivée d’un courant dépolarisant = charge positives). SI l’électrode cutanée est située sur la zone opposée au courant dépolarisant, on va voir fuir un courant dépolarisant, on va avoir sur l’ECG une onde négative. Suivant les dérivations, on peut avoir un aspect différents des même ondes suivant la place de l’électrode. Dans l’axe du courant, l’amplitude est maximale. L’électrode peut ne pas être située dans l’axe du courant dépolarisant, dans ce cas-là, l’amplitude va être diminuée. Au maximum, si la zone de propagation du courant dépolarisant est très courte, et que l’électrode est située perpendiculairement à l’axe de propagation, on n’enregistre rien sur l’ECG, car cos(90) = 0.
Pour un courant dépolarisant (+), la déflexion sur l’ECG est positive ou négative suivant la position de l’électrode de surface par rapport au sens du courant : - Si on se place à 90° du sens de dépolarisation, application d’un cos(90) = 0 - Amplitude max : il faut être dans l’axe du vecteur - Un peu angulé par rapport à l’axe : on enregistre une valeur un peu moindre - Positive si on voit arriver la dépolarisation - Négative si on voit fuir la dépolarisation
III.
Voies de conduction : propagation de la dépolarisation
La dépolarisation part du nœud sinusal, se propage dans l’OD puis dans l’OG , avec une vitesse de 1 m/s dans le myocarde atrial. C’est une propagation unidirectionnelle période réfractaire. Ensuite, ce courant dépolarisant arrive au niveau du nœud atrioventriculaire, a ce niveau, on a un ralentissement de la vitesse de propagation de la dépolarisation = 0,05 m/s. Ce ralentissement permet la synchronisation de l’activité atrioventriculaire, ca donne le temps au myocarde atrial de se contracter pour remplir correctement le VG avant que le courant dépolarisant se propage dans le tissu ventriculaire. Ensuite, la dépolarisation est conduite beaucoup plus rapidement dans le faisceau de His = 3-5 m/s, puis dans le réseau de Purkinje (zone sous-endocardique, délivre le courant dépolarisant au myocarde contractile) afin de propager dans le myocarde ventriculaire. Ceci permet une contraction homogène et simultanée de l’ensemble des parois ventriculaires = efficacité éjectionnelle.
IV.
Dépolarisation-repolarisation
1. Myocarde atrial La dépolarisation nait du nœud sinusal et elle se propage vers le bas et vers la gauche dans le tissu myocardique atrial (le nœud sinusal se trouvant dans la partie postéro-supérieure de l’oreillette droite, la dépolarisation se propage d’abord dans l’OD puis dans l’OG). La dépolarisation des oreillettes se traduit sur l’ECG par l’onde P. Elle traduit la variation de potentiel du myocarde atrial, mais en réalité elle résulte de la dépolarisation du nœud sinusal mais sur l’ECG on voit la dépolarisation de l’ensemble du myocarde atrial, elle signifie donc que le nœud sinusal fonctionne (analyse indirecte). Cette dépolarisation permet de fournir l’énergie mécanique par le couplage excitation-contraction. La repolarisation des oreillettes n’est pas visible sur l’ECG de surface, car elle survient en même temps que le QRS qui correspond à la dépolarisation ventriculaire. La dépolarisation des ventricules se traduit sur l’ECG par le complexe QRS.
2. Nœud atrio-ventriculaire Au niveau du nœud atrio-ventriculaire (ralentissement de la conduction), on n’enregistre plus de variation de potentiel sur l’ECG = ligne isoélectrique PR ou PQ : permet le respect de la séquence atrioventriculaire. La durée de cet espace traduit la fonctionnalité du nœud AV. Ce délai entre la dépolarisation des oreillettes et la dépolarisation des ventricules permet le bon couplage entre la contraction atriale (remplissage du ventricule) et la contraction du ventricule = respect de la séquence de contraction atrioventriculaire.
3. Ventricule La dépolarisation du ventricule se traduit par le complexe QRS sur l’ECG avec des ondes positives et des ondes négatives (ne dépend que de la position des électrodes par rapport à l’axe du courant dépolarisant). Ce QRS initie la contraction ventriculaire et donc l’éjection simultanée des deux ventricules.
La dépolarisation ventriculaire nait sur le bord gauche du septum interventriculaire. Elle se propage initialement de gauche à droite dans l’épaisseur du septum interventriculaire. Ensuite, cette dépolarisation se propage vers l’apex, les parois latérales puis la base des ventricules en partant du sousendocarde (réseau de Purkinje) vers le sous-épicarde. La durée de dépolarisation est relativement faible = 0,06 – 0,10 secondes (60 – 100 ms).
Au niveau des ventricules, l’activité électrique (dépolarisation ventriculaire) est orientée en bas et à gauche du fait de : -
Position anatomique du cœur dans le thorax Sens de propagation de la dépolarisation : part du septum interventriculaire vers l’apex Principale explication de l’axe électrique du cœur (des ventricules) : le VG a une paroi beaucoup + épaisse que la paroi du VD car le travail généré par le VG est bcp + important que celui du VD (donc + de cardiomyocytes dans la paroi) : différence de pression (pression systolique générée par le VG est entre 4 et 6 fois + importante que celle générée par le VD)
La repolarisation ventriculaire se traduit sur l’ECG par l’onde T. Cette repolarisation ventriculaire se fait du sous-épicarde vers le sous-endocarde (durée de PA plus courte dans le sous-épicarde que dans le sous-endocarde). La repolarisation arrive plus rapidement dans le sous-épicarde que dans le sous-endocarde. La repolarisation suit le même chemin que la dépolarisation : du septum vers les parois ventriculaires. L’onde T devrait être négative, car elle correspond à un courant repolarisant. Mais la repolarisation chemine dans le myocarde du sous-épicarde vers le sous-endocarde. Donc au final, elle est représentée par une déflexion positive sur l’ECG car elle fuit l’électrode de surface.
V.
ECG normal
1. Généralités L’ECG se fait sur un patient couché sur le dos, immobile et détendu (pour ne pas avoir d’ondes parasites). On utilise des électrodes avec un gel conductif ou humidifiées pour améliorer la transmission du signal (ou pinces en métal humidifiées avec de l’eau ou de l’alcool mais beaucoup + rustique). On enregistre l’ECG sur du papier millimétré : -
Carrés de 5x5 mm, subdivisés en 1x1 mm Vitesse de déroulement = 25 mm/s 1 mm = 0,04 s (40 ms) = 1 petit carré En ordonnée : amplitude = 10 mm/mV
On place 4 électrodes au niveau des membres (cheville et poignet) : enregistrement des 6 dérivations frontales de l’ECG.
Les dérivations frontales sont au nombre de 6 et explorent le cœur dans le plan frontal. Les dérivations précordiales sont également au nombre de 6 et explorent le cœur dans le plan transversal.
2. Dérivations frontales Les dérivations frontales se subdivisent en : -
Dérivations bipolaires (3) : DI, DII, DIII Dérivation unipolaires (3) : aVR, aVL, aVF
Les dérivations bipolaires (DI, DII, DIII) sont construites à partir des électrodes au niveau des extrémités des membres (poignets, cheville G (+ cheville D = terre)). Elles enregistrent comme si elles étaient à la racines des membres. DI : électrode au poignet D (polarité négative) et électrode au poignet G (polarité positive) : on enregistre une dépolarisation de droite à gauche ; étude horizontale du corps à 0° (pris comme base pour les autres dérivations) DII : électrode au poignet D (polarité négative) et électrode à la cheville G (polarité positive) ; axe de l’exploration vers le bas et la gauche à + 60° DIII : électrode au poignet G (polarité négative) et électrode à la cheville G (polarité positive) ; axe de l’exploration vers le bas et la droite à +120°
Les dérivations unipolaires (VR, VL et VF) : 2 points ou électrodes : électrode sur un membre, le second correspond à un point électriquement neutre (potentiel 0) obtenu par la réunion des 3 dérivations = borne centrale de Wilson Point de référence : borne centrale de Wilson (0) : point électriquement neutre (activité électrique nulle), au centre des électrodes. Dans ces dérivations, on enregistre l’activité électrique entre cette borne centrale et la racine des membres. VR (right) : entre la borne électriquement neutre et la racine du membre supérieur droit ; axe de l’exploration orienté en haut et à droite à - 150° VL (left) : entre la borne électriquement neutre et la racine du membre supérieur gauche ; axe de l’exploration orienté en haut et à gauche à - 30° VF (foot) : entre la borne électriquement neutre et la racine du membre inférieur gauche ; axe de l’exploration orienté verticalement vers le bas à + 90°
Enregistrement de l’activité du cœur selon 6 axes : permet d’explorer pour chaque dérivation telle ou telle zone du cœur et des ventricules
3. Dérivations précordiales Les dérivations précordiales explorent le cœur dans le plan transversal. Elles sont situées sur le thorax en avant du cœur. On a 6 dérivations précordiales de V I à V VI (V1 – V6) : V I : située dans le 4ème EIC sur le bord droit du sternum V II : située dans le 4ème EIC sur le bord gauche du sternum V IV : située dans le 5ème EIC, à peu près sous le mamelon (référence : à l’aplomb du changement de courbure de la clavicule) V III : située dans le 5ème EIC, à équidistance entre V II et V IV sur une ligne V V : située dans le 5ème EIC, à l’aplomb de la ligne axillaire antérieure V VI : située dans le 5ème EIC, à l’aplomb de la ligne axillaire moyenne
Borne de référence : de Wilson Dérivations complémentaires : V7 : située dans le 5ème EIC, à l’aplomb de la ligne axillaire postérieure V8 : verticale de la pointe de l’omoplate V9 : bord gauche du rachis V3r à V6r : symétriques droites de V3 à V6 Précordiales droites : explorent le ventricule droit
ECG normal (12 dérivations)...
Similar Free PDFs

ECG 2020 - ECG - LE TOURNEAU
- 7 Pages

ECG - ECG notes
- 3 Pages

Basic ECG - ECG
- 14 Pages

ECG 1 - Atividades ECG- cardiologia
- 12 Pages

Informe ECG
- 22 Pages

ECG - electrocardiograma
- 5 Pages

ECG pléthysmographie
- 2 Pages

ECG taller
- 11 Pages

Cardiologia - ECG
- 59 Pages

ECG simulation
- 13 Pages

Electrocardiograma (ECG)
- 4 Pages
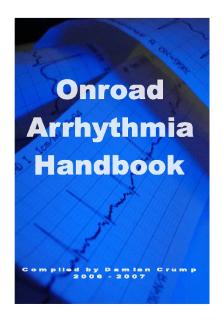
ECG PDF Edition
- 59 Pages

ECG for Emergency Physician
- 172 Pages

Pocket guide ECG interpretation
- 21 Pages

Sobrecarga Atrial - ECG
- 2 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu
