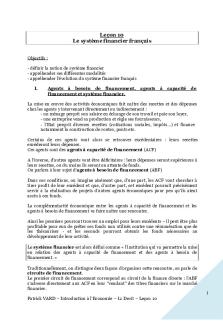Le systeme d\'information comptable 1 PDF

| Title | Le systeme d\'information comptable 1 |
|---|---|
| Author | amine tabri |
| Course | Comptabilité |
| Institution | Université Clermont-Auvergne |
| Pages | 47 |
| File Size | 2 MB |
| File Type | |
| Total Downloads | 43 |
| Total Views | 170 |
Summary
Download Le systeme d'information comptable 1 PDF
Description
Le système d’information comptable Introduction : Qu’est-ce qu’un système d’information comptable ? La comptabilité se situe au carrefour de plusieurs domaines d’études (droit, économie, gestion) Elle représente un élément central des informations à fournir à ses utilisateurs.
Partie 1 : le fonctionnement du système d’information comptable : Chapitre 1 : La normalisation et la réglementation comptable : « La comptabilité est un système d’organisation de l’information financière permettant de saisir et de classer les données financières d’une entreprise » Technique de collecte d’informations
Renseignements juridiques et Économiques sur l’entreprise
Renseignement internes, Aide de la gestion
A- La comptabilité : système d’informations juridiques et économiques - Elle a pour but de fournir des informations chiffrées pour rendre compte la gestion et la situation financière de l’entreprise auprès des principaux acteurs internes et externes. Rendre des comptes ; Suivre l’évolution dans le temps d’entreprise ; Situer l’entreprise sur son marché. - Ces informations intéressent les actionnaires, les prêteurs, les clients, les salariés, l’Etat, L’administration fiscale, …. - Donner des informations sincères et fiables sur la situation de l’entreprise et notamment sur la rentabilité de son activité. - Pour être compréhensible et transparent, l’enregistrement des données est réglementé. - Elle doit renforcer la confiance entre les différents partenaires. - Elle permet aux utilisateurs de l’information financière de prendre des décisions sur la base de documents normalises qui traduisent la performance et la situation financière de l’organisation. B- La comptabilité ; instrument de gestion conduisant à la prise de décisions : - La comptabilité est aussi un outil d’aide à la décision pour la gestion interne. - Elle fournit des informations de basse utiles à la gestion courante de l’entreprise : gestion des clients, des fournisseurs, de la trésorerie… - C’est une ressource essentielle pour réaliser des calculs de couts (cout de production, cout de revient) D’où 2 branches de la comptabilité : 1- La comptabilité légale, obligatoire Mission : rendre des comptes Comptabilité financière Domaines d’intervention : Comptabilité générale :
Travaux à effectuer
1
Saisie, contrôle et enregistrement des informations. Elaboration des documents de suspense (Bilan, compte de résultat et annexe) Contrôle des comptes
Comptabilité auxiliaire
Enregistrement, suivie et contrôle des opérations en lien avec les clients, les établissements financiers des clients
2- La comptabilité de gestion : Mission : aide à la décision interne Non obligatoire-prédictive Comptabilités de gestion Fonctions
Comptabilité analytique
Gestion financière
Comptabilité budgétaire
Analyse des charges d’exploitation Calcul des couts pour secteur d’activité, par produit, par marché… Analyse des processus de production Appréciation des résultats de la comptabilité financière Détermination et analyse des besoins de l’organisation en matière de financement Contrôle de l’affectation et de l’utilisation des fonds Diagnostic et analyse de la santé de l’entreprisse Organisation des prévisions en matière de cout et de recette
C- La comptabilité au service du droit : 1 : La détermination du patrimoine : - Le patrimoine d’une personne physique ou morale est juridiquement défini comme étant l’ensemble de ses droits et obligations (patrimoine = les avoirs moins les dettes) -
Tout évènement modifiant la valeur ou la composition du patrimoine, provoque une formation comptable. On parlera du BILAN 2 : La comptabilité, moyen de preuve en droit commercial :
-
Une comptabilité contrôlée peut servir de preuve en matière de droit commercial.
-
Cette utilisation de la comptabilité suppose que les documents et les pièces justificatives soient conservés durant toute la période de prescription de l’activité commerciale.
Section 2 : l’entreprise, agent économique :
2
-
Comptabilité cherche à décrire les activités économiques de l’entreprise.
- Elle distingue les opérations d’investissement des opérations d’exploitation. A- Les opérations d’investissement Engagement à long terme-caractère exceptionnel ; Augmentent la valeur du patrimoine de l’entreprise ; Analyse des modes de financement des investissements. B- Les opérations d’exploitation : Elles caractérisent l’activité de l’entreprise Elles sont courantes et le plus souvent cycliques Stades Ex :
Michelin
Créance d’exploitation
Dettes d’exploitation
Ex client
Ex : fournisseur
Disponibilité Cycle d’exploitation 1- Les achats (marchandises, fourniture,) 2- Les ventes 3- Les paiements
Emplois Investissements
Ressources Moyens de financement : apports des actionnaires, Autofinancement (le béninises de l’entreprises), Dettes à long terme (Bancaire)
Stocks, Créances client, Disponibilités
Dettes d’exploitation (dettes vis-à-vis des fournisseurs)
Conclusion : A- Les informations d’entrée et de sortie : L’ensemble des opérations vont être enregistré et
3
présentées sous formes monétaires. Exhaustive : toute information utile doit être repérée et traitée Pertinent : seules les informations utiles sont traitées. Compréhensible : les informations doivent être traités de telle sorte, qu’elles puissent satisfaire les besoins de leur utilisateur.
B- Les caractéristiques d’un SIC :
Les documents produits par les comptabilités sont destinés à plusieurs utilisateurs - Soit par obligation légale, - Soit pour des besoins de gestion et de contrôle, -
Soit dans un souci de communication.
Chapitre 1 : La normalisation et la réglementation comptable Pourquoi la normalisation ? Quelles sont les ressources de la normalisation ? I.
4
Définition, objectifs et limites :
La normalisation est un processus d’élaboration des normes comptables qui définit des principes et règles, applicables à toutes les organisations soumises à l’obligation d’établir des comptes. Plusieurs organismes interviennent Processus long Espace national, régional, mondial. Objectifs : Améliorer la transparence et la fiabilité des états comptables ; Pertinence de l’information fournie par rapport aux besoins ; Confiance entre les acteurs économiques ; Comparabilité nationale mais aussi internationale. La normalisation conduit à la définition des normes comptables : - Obligations, plus ou moins contraignantes imposées au pratique comptable. - Règles et principes concernant l’enregistrement comptable, la présentation, le contenue des documents comptables - En France, les normes comptables sont définies dans le PLAN COMPTABLE GENERALE (PCG) Les limites d’une information fiables : - Toutes les informations ne sont pas enregistrées par l’outil comptable ; - Des interprétations différentes des normes comptables (favoriser la présentation des comptes de l’entreprise- comptabilité créative) - Des innovations (produits financiers) qui nécessitent de nouvelles normes. - Des adaptations selon la taille de l’entreprise, son secteur d’activité, … II.
Les sources de la réglementation comptable : 1996 : Processus de convergence vers des normes comptables internationales.
La France a choisi d’adopter les normes internationales de maniérer progressive. Types d’entités Comptes consolidés Comptes individuels Sociétés cotées en bourse IFRS obligatoires (2005)
Normes françaises obligatoires D’autres entreprise
Les choix entrent : IFRS et norme françaises
Harmonisation des pratiques comptables des Etats membres ; Forte influence anglo-saxonne. La réglementation française : Un droit comptable plus évolutifs, convergeant vers les normes internationales : o Fortes pressions internationales (ex : fonds de pension) o Une comptabilité patrimoniale plus qu’économiques o Des contraintes fiscales lourdes. Des réformes en cours : 5
o o o
2009 : Créations de l’autorité des normes comptables Nov. 2014 : Réalisation par ANC d’un recueil des normes comptables Vers un plan comptables général évolutif
Chapitre 2 : L’enregistrement des flux économiques et le principe de partie double Le système d’information comptable enregistre toutes les opérations quantifiables monétairement La plupart des opérations ne se traduisent par des flux (monétaires ou des flux réels) entre l’entreprise et ses différents partenaires. Comment le système comptable enregistre-t-ils ces opérations ?
6
1- Les cycles de l’entreprise : L’activité d’une entreprise peut être décrite à partir des cycles qui la composent Cycle : ensemble d’opérations qui se renouvellent selon une périodicité (court terme- long terme) Les 2 cycles :
Le cycle d’exploitation Le cycle des investissements La durée du cycle dépend : o Du temps de stockage des matières premières et des produits finis ; o De la longueur de processus de fabrication ; o De la durée des crédits accordés aux clients et des dettes fournisseurs. Plus le cycle d’exploitation est long et le plus il nécessite des ressources financières. 2- Le cycle des investissements : L’investissement est l’acquisition par l’entreprise de biens durables (matériels ou immatériels) L’investissement suit un cycle long qui va de l’acquisition de l’immobilisation à son renouvellement après plusieurs années de fonctionnement. L’usage (la consommation) de l’immobilisation va procurer des avantages économiques que l’on pourra chiffrer. Exemple : o Investissement dans une machine d’une valeur d’acquisition de 1000. Durée prévue : 5 ans. o Cout d’utilisation annuel (évaluation des avantages économiques procurés annuellement par la machine) : 1000/5 = 200. o Hypo : L’entreprise a un usage constant de l’immobilisation dans le temps. On peut ainsi répartir le cout d’acquisition de l’immobilisation sur sa durée en fonction de son usage. I.
L’entreprise et les flux économiques :
On peut considérer que l’entreprise est au centre de nombreuses transparente A – l’analyse des flux économiques :
7
Le système comptable va permettre de prendre en compte un flux et sa contrepartie cométaire ou un flux et une reconnaissance de dette ou de créance si la contrepartie n’est pas immédiate. C- Les types de flux : Des flux financiers : Des paiements (recettes-dépenses) Des reconnaissances de dette (ex : vis-à-vis des fournisseurs, de l’Etat) Des reconnaissances de créance de la part des clients Des flux réels : o Ils correspondent à des mouvements de biens ou de service. On constate, dans nos exemples, deux flux de sens opposées : Un flux réel sortant ou entrant ; Un flux monétaire de sens opposés c'est-à-dire entrant ou sortant. Dans le cas d’un paiement au comptant, ces deux flux sont simultanés. o o o
3- Le principe de partie double : A- Principe : Toutes les opérations vont se traduire par une double inscription comptable, une inscription dans un compte intervenant en ressources (origine du flux) et une inscription dans un compte intervenant en emploi (destination du flux). 8
Ex : achat de 2 ordinateurs (450 euro chacun) - paiement au comptant. Flux réels : 2 ordinateurs
Entreprise
Fournisseur
Flux monétaires : paiement
Coopérative
Banque
Matière première
BAYARD
Dette Dette LT
EDF
Paiement Dette
Machine : Investisse
(Emprunt) Argent Client Casino Entreprise
Produit finis Paiement
Argent
Créance Services Impôt
Etat
9
Transport Produit finis
Client cuisine centrale gent
Transport Josselin
B- Le compte : Un compte est une unité de base qui détaille les mouvements affectant l’entreprise. Le compte permet de classer les flux selon leur nature. Présentation schématique d’un compte. Débit
Nom des comptes
Crédit
Ex : achat de 2 ordinateurs (450 euro chacun) - paiement au comptant.
Entreprise
Flux réels : 2 ordinateurs
Fournisseur
Flux monétaires : paiement
Immobilisations : Matériels
10
Disponibilités : banque
Informatiques Flux entrant emploie
Flux sortant ressources
Flux entrant emplois
Flux sortant ressource
900
900
C’est par convention qu’un compte récapitule : les emplois dans la partie gauche. On appelle DEBIT ; Les ressources dans la partie droite. On appelle CREDIT : Présentation simplifiée d’un compte INTITULE DU COMPTE Débit
Crédit
Emploie (flux entrant)
Ressources (flux sortant)
1- L’entreprise Faure achète une nouvelle machine d’une valeur de 10 000euro. Elle paye par chaque. D
Immobilisations Machine C
D
Disponibilités banque
C
10000 10000 2- L’entreprise vend pour 500 euro de marchandises. Le client paie en espèces. Dispo Produits D
Caisse
C
D
Vente de marchandises
500
C
500
3- A la fin de la journée, le commerçant compte sa caisse, il vire 2000 euro sur son compte bancaire.
D
Dispo caisse C 2000
Dispo D Banque C 2000
L’enregistrement dans les comptes respecte le principe de partie double. Toute opération est enregistrée au moins dans la 2 comptes avec : Total flux débit = Total flux crédit Cas des opérations à crédit : 11
Il est relativement rare d’avoir des opérations au comptant. Le plus souvent, l’entreprise accorde des délais de paiement à ses clients et bénéficie de délais de paiement de la part de ses fournisseurs. Ces facilités de paiement sont gratuites et les délais de paiement sont courts (≤1 ans). Ces crédits entrainent un décalage dans le temps entre le flux réel (réception de la facture) et le flux monétaire (réception du chèque). Ces opérations vont donc être enregistrées en deux étapes : Cas d’un achat à crédit : 1 ère étapes : Enregistrements du flux réel avec pour contrepartie la reconnaissance d’une dette. 2 -ème étapes : enregistrement du flux monétaire avec pour contrepartie l’annulation de la dette. Ex : Achat à crédit de 2 ordinateurs (450 euro chacun) - paiement dans 1 moins Flux réels : 2 ordinateurs
Entreprise
Fournisseur
Reconnaissance de dette le fournisseur A fait crédit à l’entreprise 1 mois après, l’entreprise paie son fournisseur. Annulations de la dette
Entreprise
Fournisseur Paiement par cheque
1- L’achat-réception de la facture : D matériel info C
D
fournisseur C
900
900
En contrepartie de l’achat : reconnaissance de dette vis-à-vis du fournisseur. 2- Le paiement (30 jours après)
D
Banque
C 900
Annulation de la dette. Vente à crédit : March 1000euro- paiement à 30 jours. 1- La vente-envoie de la facture : D
12
Vente de marchandises C
D
Client
C
1000
1000
1000 En contrepartie reconnaissance de créance du client. Le client est un débiteur de l’entreprise. 2- Le paiement (30 jours après) D
Banque
C
1000
Annulations de la dette. Les comptes clients et fournisseurs sont des comptes écran. Ils durent le temps du crédit. Attention : il faut bien distinguer les 2 étapes d’une opération à crédit. IV.
Les opérations de comptes selon les types de flux (première présentation) : A- Les comptes de flux monétaires : les disponibilités. Flux monétaires en espèces : compte caisse. Flux monétaires sous forme virements, de CB, chèques : compte banque. B- Les comptes de flux réels : 1- Les flux réels sortants d’exploitations : Flux sortant liés à l’activité de l’entreprise. Ex : compte ventes Catégorie des comptes de produits : opérations qui génèrent un enrichissement de l’entreprise. 2- Les flux réels entrants : Flux réels entrant liées à l’activité de l’entreprise : les achats-les consommationscatégorie des comptes de charges. Appauvrissement de l’entreprise. Flux réels d’investissement : catégorie des comptes d’immobilisations. C- Les comptes de flux de créances et de dettes (court terme)
-
Les comptes de tiers Les dettes à CT : fournisseurs, Etat, organismes sociaux ……
Débit
Nom du partenaire
Crédit
Création de la dette Annulations de la dette Les comptes de tiers Débit
Nom du partenaire
Crédit
Créations de la créance Annulations de la créance
13
Actif Créance Ce que possède l’entreprise Débit
Passif Dette Ce que doit l’entreprise Crédit
Les comptes d’immobilisation : ils enregistrent les flux réels entrants de biens devant
durablement dans l’entreprise (les investissements). Utilisation sur plusieurs années. Les comptes des tiers : ils enregistrent l’ensemble des dettes à court terme et des créances à court terme de l’entreprise. Convention :
Flux réels ou monétaires Flux de crédit
A gauche : Débit Entrants Les créances de l’entreprise
A droite : Crédit Sortant Les dettes de l’entreprise
Les informations sont enregistrées dès lors que l’entreprise dispose d’une pièce comptable justificative, que l’opération réelle soit payée ou non. C’est comptabilité d’engagement.
Chapitre 3 : Le bilan et le compte de résultat 14
Introduction : CDC (code du commerce) 123-12 : Les comptes annules comprennent le bilan, le compte des résultats et une annexe qui forment un tout indissociable.
Le bilan est un tableau qui reflète le patrimoine de l’entreprise à un moment donné.
Alors que le compte de résultat traduit son activité sur une période donné. Annexe : ensemble d’informations complémentaires.
Le passif du bilan représente les ressources à la disposition de l’entreprise et l’actif de l’emploie de ces ressources. Le compte de résultat mesure l’activité de l’entreprise. Dépense
Recette
Liées à l’activité.
Non liées à l’activité.
Compte de résultat Décaissables
Bilan Encaissables
Exemple :
Exemple :
Immobilisations Charges
Emprunt
Produits Emploie
Non
Ressources
Non
Décaissable Encaissable
Opérations particulières que nous n’illustrons pas la suite. o
1er
Les charges et les produits :
cas : les flux (dépenses ou recette) est réel, on parle de produit encaissable et de charges décaissable (paiement immédiat ou différé)
2e cas : que nous verrons plus tard ; le comptable peut créer des produits ou des charges qui ne correspondent pas à des flux. On parle alors de produits fictifs, charges calculées, de charges non décaissables.
15
I.
Le compte de résultat :
A- Définition : Le compte de résultat est utilisé pour analyser la rentabilité de l’entreprise. Il va permettre de déterminer si l’activité de l’entrep...
Similar Free PDFs

allemand le systeme verbal
- 21 Pages

Systeme respiratoire (1) pdf
- 14 Pages

CAx-Systeme
- 6 Pages

Vergleich politischer Systeme
- 27 Pages

Probeklausur Verteilte Systeme
- 17 Pages

Cours anatomie systeme nerveux
- 9 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu