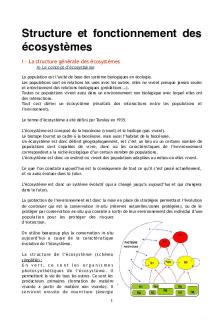Structure et fonctionnement des écosystèmes PDF

| Title | Structure et fonctionnement des écosystèmes |
|---|---|
| Course | Biologie |
| Institution | Université Catholique de Lille |
| Pages | 21 |
| File Size | 1.3 MB |
| File Type | |
| Total Downloads | 86 |
| Total Views | 147 |
Summary
Cours de Licence physiologie, biologie et écologie....
Description
Structure et fonctionnement des écosystèmes I - La structure générale des écosystèmes A) Le concept d’écosystsème La population est l’unité de base des système biologiques en écologie. Les populations sont en relations les unes avec les autres, elles ne vivent presque jamais seules et entretiennent des relations biologiques (prédations …). Toutes ce populations vivent aussi dans un environnement non biologique avec lequel elles ont des interactions. Tout ceci défini un écosystème (résultats des interactions entre les populations et l’environnent). Le terme d’écosystème a été défini par Tansley en 1935. L’écosystème est composé de la biocénose (vivant) et le biotope (pas vivant). Le biotope fournit un cadre a la biocénose, mais aussi l’habitat de la biocénose. Un écosystème est donc définit géographiquement, est c’est un lieu où un certains nombre de populations sont capables de vivre, donc où les caractéristiques de l’environnement correspondent a la niche écologique d’un certain nombre de populations. L’écosystème est donc un endroit où vivent des populations adaptées au milieu où elles vivent. Ce que l’on constate aujourd’hui est la conséquence de tout ce qu’il s’est passé actuellement, et va aussi évoluer dans le futur. L’écosystème est donc un système évolutif (qui a changé jusqu’a aujourd’hui et qui changera dans le futur). La protection de l’environnement est donc la mise en place de stratégies permettant l’évolution de continuer qui est la conservation in-situ (réserves naturelles/zones protégées), ou de le protéger par conservation ex-situ qui consiste a sortir de leur environnement des individus d’une population pour les protéger des risques d’extinction. On utilise beaucoup plus la conservation in-situ aujourd’hui a cause de la caractéristique évolutive de l’écosystème. La structure de l’écosystème (schéma simplifié) : En vert, ce sont les organismes photosynthétiques de l’écosystème. Il permettent la vie de tous les autres. Ce sont les producteurs primaires (formation de matière vivante a partir de matière non vivante). Il serviront ensuite de nourriture (énergie
1
nécéssaire pour vivre). Tout être vivant, ou ensemble d’êtres vivants, constitue un système qui a besoin d’énergie pour fonctionner (a tous le niveaux de la vie : cellule/individu). L’énergie des producteurs primaires pourra être utilisée directement par les herbivores (jaune), qui formeront de la matière vivante animale avec de la matière végétale. Cette matière animale pourra être utilisée par des prédateurs (carnivores = rouge) qui vont la consommer (matière organique animale). Ce sont donc des relations qui font circuler l’énergie. Ce sont des relations verticales : les transferts d’enraie entre les niveaux trophiques (alimentaires). Au sein d’un même niveau trophique, on pourra avoir des relations entre les populations : compétition pour la même ressource. Ce sont des relations horizontales : se développent entre des populations de même niveau trophique. Dans une même population, on aura des relations entre les individus : ce sont des relations internes a la population (processus intrinsèques). La biocénose a aussi des interactions avec le biotope. Un écosystème est donc un réseau fonctionnel d’interactions, un système hiérarchisé. Tout système peut être étudié par la systémique, qui étudie les caractéristiques de ce système. En systémique, un système sera donc : • un ensemble d’éléments en interactions les uns avec les autres, dépendants les uns des autres (fonctionnement, évolution …). Ces interactions peuvent perte fortes ou faibles, mais toujours présentes. • il en résulte l’émergence de propriétés globales : les propriétés d’un écosystème sont plus que la somme des propriétés de chacun des éléments. Deux populations qui vivent séparément auront des propriétés différents et plus nombreuses que deux populations qui vient ensemble (souri/chats). Ce sont les interactions qui enrichissent l’ensemble des relations. • l’ensemble agit sur les différentes parties. Les propriétés d’une population (niche écologique) ne seront les mêmes en fonction des environnements. Depuis la molécule jusqu’a la biosphère, tout est organisé en système avec des interactions. Ce systèmes font apparaitre de nouvelle propriétés : des propriétés émergentes (conséquences de la relations entre deux éléments du système). Pour comprendre comment vit une population ou un organisme, il faut observer ses interactions naturelles dans son écosystème. La biosphère étant un système, on trouve des interactions entre les éléments qui la constitue. On trouva par exemple les écosystème excédentaires en énergie (produisent plus qu’ils ne sont utilisés) qui pourront exporter vers des systèmes déficitaires en énergie.
2
Ex : phytoplancton = photosynthèse en surface = excédent d’énergie ; déficit en énergie dans le fond des océans = utilisation de l’excédent de surface grâce a la sédimentation de la matière organique de surface (neige océanique) = minéralisation ; la matière minérale remonte en surface (ex : zone d’upwelling). Sur des échelles de temps restreintes, un écosystème aura tendance a évoluer en climax (Clements, 40’s). On trouvera un succession écologique (d’abord espèce pionnières, supplantées par de espèces a durée de vie plus longue qui utilisent mieux les ressources). Le stade où les espèces de type K supplantent totalement les espèces de type r sera donc le climax. Le climax sera donc le stade ultime des successions écologiques dans un environnement stable (plutôt théorique, car écosystème non stable, visibles dans les forêts primaires). Pour étudier les écosystèmes, on utilise la description des éléments des écosystème (approche descriptive : espèces, hiérarchie, structure trophique), mais aussi l’approche fonctionnelle (comprendre comment les éléments interagissent). Un écosystème pourra être divisé en unités fonctionnelle (végétaux, herbivores, prédateurs …). On pourra les décrire et les comprendre. Entre ces unités fonctionnelles, il y aura besoin d’énergie. Pour décrire un système, il faudra décrire les unités fonctionnelles et les quantités d’énergie qui circulent entre elles. Un écosystème étant très compliqué, il faut savoir hiérarchiser les fonctions. La première fonction d’un écosystème sera toujours la production de matière vivante avec de la matière non vivante (production primaire, matériel détritique …). Ces études auront pour but de répondre a la curiosité humaine, obtenir la connaissance fondamentale (savoir) et la recherche appliquée (utiliser ce qu’on sait).
B) La structure spatiale des écosystèmes La structure des écosystèmes est définie en priorité par le climat (pluviométrie, température). Le deuxième facteur essentiel est la qualité du sol définie par les éléments géologiques. C’est un élément dynamique, qui évolue en fonction de l’environnement, selon le cycle Erosion-TransportSédimentation. Par exemple, sur des montagnes déboisées (Madagascar), la pluie entraine des éléments, qui sera entérinée par l’eau et qui va sédimenter. La roche va former la fraction minérale du sol, et les organismes vont constituer la fraction organique du sol. Cette dernière ne sera pas stable mais progressivement décomposée en sels nutritifs, utilisés par les végétaux pour reformer de la matière organique (sol terrestre ou benthos de la mer). La structure des écosystème est donc définir par les facteurs biotiques et les facteurs abiotiques.
3
Facteurs abiotiques : Dans un lac, il y a une grosse différence entre les différentes profondeurs en fonction de la température. On obtient donc une courbe de température grâce a une sonde. On trouvera une température relativement élevée en surface, qui va ensuite diminuer très rapidement vers 10m de profondeur. Au delà de 10m de profondeur, la température reste constante aux alentours de 4°C. On trouvera donc une stratification de la température en fonction de la profondeur dans le lac. Cela va déterminer la structure de l’écosystème (de la vie en fonction des profondeurs). On trouvera la thermocline, qui est la fraction de profondeur où la température varie rapidement (même chose avec la salinité : halocline). On trouve aussi une zone superficielle, l’épilimnion, où a température est relativement constante et élevée (20°C). On trouvera alors la couche profonde, l’hypoimnion, où la température est relativement constante et basse (4°C). A cause de la température, la structuration de la biocénose se fera en fonction des espèces qui supportent plus ou moins le foire ou le chaud. Il existe aussi des écosystèmes qui sont structuré par des organismes ou des groupes d’organismes. Facteurs biotiques : Toutes le populations n’auront pas un rôle équivalent dans la biocénose. certaines auront un rôle plus important que d’autres, jusqu’a déterminer la structure de l’écosystème. Ces espèces qui détermine la structure d’un écosystème sont des espèces-clé de voute. On pourra parler d’espèce clé d’un écosystème, qui aura un rôle disproportionné (souvent) par rapport a son abondance. Certaines de ces espèces clé vont modifier la structure d’un écosystème : espèces-clé structurelles / «! espèces ingénieurs! ». Dans ce cas, on trouve les récifs coralliens, qui sont formé par la calcification des madrépores et d’algues calcifiantes. L’ensemble des squelettes de toutes les époques des récifs coralliens forment une structure très solide (Grande barrière d’Australie = 2000km ; Nouvelle-Calédonie = 1600km). Cela aura de grandes conséquences sur l’environnement. D’autres espèces clé seront des espèces-clé fonctionnelles, qui auront un rôle sur le fonctionnement des écosystèmes. Par exemple, d’un point de vie écologique, les requins sont des top-prédateurs (prédateurs très efficaces, capable de manger d’autres prédateurs : consomment des mérous qui mangent des poissons herbivores). Ils régulent les populations (si il y a plus de mérous, donc moins de poissons herbivores, donc plus d’algues nuisibles sur les récifs
4
coralliens). Il y aura donc des conséquences sur les producteurs primaires. Echelle : La notion d’échelle est très importante en écologie. Les échelles peuvent se définir a deux niveau : spatial et temporel. Il y a, au niveau temporel, des phénomènes sur des périodes brèves (heure : physiologie, interactions, comportement, compétition …) ou plus longues (jour de l’année : phénomènes cycliques liés aux saisons comme la croissance de végétation). La saison est une échelle de temps typique en écologie (cycles de développement, reproduction, croissance, variation des facteurs abiotiques comme la température ou la pluviosité …). Les phénomènes de spéciation se développent sur des périodes très longues (apparition d’espèce sous l’influence du milieu = durées très longues de plusieurs millénaires a des centaines de milliers d’années). Les échelles sont donc hiérarchisées. Il y a une hiérarchie temporelle des fonctionnent des écosystème, et les mêmes phénomènes ne seront pas considérés aux différentes échelles de temps. Il faut donc toujours bien préciser l’échelle de temps considérée pour un phénomène. D’autres facteurs puent déterminer la structure des écosystèmes.
C) Structure trophique Trophique = rapport a l’alimentation. L’étude de la structure trophique décrit comment la matière vivante (matière organique = énergie stockée) se répartit au sein d’une biocénose. L’énergie arrive sous forme de rayonnement solaire. Les organismes chlorophylliens peuvent, grâce a cette énergie, produire de la matière organique, ce sont les producteurs primaires, des organismes autotrophes. Cette matière vivante sera stockée dans le corps de ces végétaux, forment de la biomasse. Une partie de cette énergie stockée sera utilisée par les végétaux pour vivre par la respiration (casse les molécules de matière organique pour donner de la matière minérale). Le reste de cette énergie va soit continuer a vivre et agrandir le nombre d’individus végétaux, soit consommés par des herbivores, qui seront des consommateurs primaires. Ces herbivores vont pouvoir former de la matière animale. Les consommateurs primaires (premiers a consommer) seront donc des producteurs secondaires, qui seront les second a produire de la matière vivante. Ces consommateurs primaires seront consommés par des prédateurs qui sont donc des consommateurs secondaires/tertiaires qui
5
constitueront des producteurs tertiaires/quaternaires. Ce système trophique, dépendant du rayonnement solaire sur la surface du sol constitue le système «!herbivore!» épigée. A la mort des prédateurs, on trouvera de la matière organique morte, qui sera recyclée. Elle sera utilisée par les décomposeurs, qui peuvent extraire de l’énergie de la matière organique morte. Cette matière organique sera donc minéralisée, donc transformée en matière minérale. Cette matière minéralisée permettra aux producteurs primaires de produire de la nouvelle matière organique. Les décomposeurs formés de matière organique, seront consommées par des consommateurs secondaire/tertiaires. Cela se déroule principalement vers l’intérieur du sol, on parlera donc de système «!saprophage!» endogée (même si la décomposition se fait partout). Ce système reposera donc sur les relations alimentaires, formant la structure trophique, même si ce schéma n’est pas représentatif de la réalité. On parlera donc de réseau trophique car l’alimentation n’est pas linéaire (pas une chaine mais des relations entre les différentes niveaux). Cette structuration pourra refléter la bonne santé d’un écosystème. En général, plus y a de niveau dans le réseau trophique, plus il y aura d’espèces de type K, et pus il fonctionnera correctement en s’approchant du stade climax (ou perturbé si principalement des espèces de type r). Le réseau trophique complexe sera aussi la preuve d’un écosystème mature t non jeune. Si on perturbe un écosystème mature, il perd des niveaux de sa structure (ex : pêche des requins). Ces relations sont très simplifiée car on ne parlera pas des associations symbiotiques ou parasitaires.
D) Productivité primaire, diversité, stabilité et résilience La productivité primaire est la productivité des autotrophes, donc la quantité de matière organique qui est produite par les autotrophes par unité de temps. C’est la base énergétique des écosystème. Cette productivité primaire va dépendre du type de formation végétale. Par exemple, en milieu terrestre, des formation végétales sont beaucoup plus productives que d’autres (mangroves, forêts équatoriales …), sous l’influence du climat, et donc de la qualité du sol. La diversité biologique ou biodiversité est la richesse spécifique, donc le nombre d’espèces présentes dans un milieu considéré. D’autres facteurs détermineront cette diversité. La stabilité sera composée de deux parties : • stabilité au sens large : la capacité d’un écosystème à rester inchangé sur une période déterminée = stabilité statique (ex : forêts primaires). Cela désigne donc la constance d’un écosystème de par sa structure t son fonctionnement. • la résilience ou homéostasie : capacité a revenir dans un état initial d’un d’écosystème après une perturbation.
6
La perturbation sur un écosystème va entrainer une perte d’abondance, puis une augmentation relativement rapide, et enfin une phase de retour a la situation initiale. Sous l’influence de la perturbation, un certain nombre d’organisme a disparu, libérant de l’espace, entrainent un phase de réactivité avec l’apparition d’un très grand nombre d’espèces opportunistes (type r) qui vont disposer des ressources et se developper de manière importante, et enfin, les espèces a stratégie K vont se réinstaller, en augmentant la compétition et en faisant donc diminuer le nombre d’espèces opportunistes jusqu’a se stabiliser. Un écosystème avec ce type de capacités possède une forte résilience. Pour que cela puisse se manifester, il faut une perturbation temporaire, qui n’empêchera pas le retour a l’état initial. Connaitre la résilience des écosystèmes permet de limiter les perturbations sur les écosystèmes peu résiliant incapable de revenir a l’état initial.
II - Les biocénoses A) L’organisation des biocénoses : les interactions entre les organismes Les êtres vivants interagissent avec leur environnement mais aussi entre eux. Mutualisme et symbiose : Le mutualisme ou la symbiose se définit par le fait que deux populations tirent un bénéfice réciproque a vivre ensembles. Par exemple, le lichen est un mutualisme entre une algue et un champignon. Le champignon apport gun substrat, de l’humidité et des sels minéraux a l’algue. L’algue va former de la matière vivante gare au rayons lumineux, dont profitera le champignon pour se developper. Dans ce cas, l’association est obligatoire pour le champignon (symbiose) et non pour l’algue (mutualisme). Autre exemple, le mutualisme entre les légumineuses et les bactéries Rhizobium sp. est une association de bactéries avec les racines des plantes (dans les nodules). Les bactéries profitent de la production primaire, et ont propriété de pouvoir fixer l’azote atmosphérique et de la transférer aux végétaux. La plante aura donc les sels nutritifs nécessaires a sa croissance. Commensalisme : Lorsque deux organismes vivent ensemble, l’un en tire bénéfice et l’autre y est indifférent = commensalisme. On trouve aussi le mutualisme l’antilope qui se fait débarrasser se ses parasites par le piqueboeuf.
7
Il y a également l’hippopotame et les sangsues (annélides parasitaires). Ces denrées vont aux endroit où a peau est fine (fosses nasales, anus …). Autres exemple, les crustacés cirripèdes (balanes) Chelonia testudinaria et une tortue : le crustacé se fixe sur la carapace de la tortue et qui filtre l’eau pendant qu’il est transporté par la tortue. Antibiose : L’antibiose est une interaction négative. Louis Pasteur ou Alexander Flemming (1940) ont utilisé ce principe (ex : pénicilline = émet une substance qui tue des bactéries). Par exemple, les noyers émettent la juglone qui est toxique (empehce la croissance d’autres végétaux) et qui va tomber au niveau sol avec la pluie, empêchant la croissance d’autre végétaux et donc évitant la compétition. On parle d’allélopathie (subsatence qui empêche la croissance). Amensalisme : C’est une relation négative : lors de la relation entre deux organisme, l’un est indifférent alors que l’autre est perturbé. Par exemple, les oyats, qui sont fréquents sur les dunes littorales, sont soumis au piétinement des humains. Parasitisme : Un parasite est un animal ou végétal qui vit au dépend de son hôte. Le parasite tire un bénéfice au détriment de l’hôte. Par exemple, on trouve le gui (Viscum album) qui est un parasite végétal. On le trouve perché en boule dans les arbres. Il s’y accroche en formant un crampons qui va s’enfoncer dans l’arbre au fur et a mesure de la croissance du gui. Le crampon rentre au niveau de l’aubier, détournant de la sève brute que l’arbre aura récupéré dans le sol, lui permettant de se developper en plus de sa propre photosynthèse (c’est donc un hémiparasite car il ne prélève pas son énergie directement dans l’hôte mais seulement des substances pour former de la matière vivante). On trouve des parasites chez tous les groupes zoologiques. Par exemple, chez le saumon/poisson, on trouve des lamproies, qui sont également des poissons. Les lamproies se nourrissent du sang des autres poissons en se fixant avec leurs dents. Les lamproies vivent en mer et se reproduisent en eau douce (anadrome), permettant aux humains de les manger (prédation). Ce sont des parasites externes car ils se trouvent a l’extérieur de l’hôte. Autres exemple, le ténia, qui est un parasite interne, est un cestode, qui passe par plusieurs hôtes (pour le parasite de l’espèce humaine : intermédiaires = porc ; final = humain). Ils vivent dans le tube digestif.
8
Prédation : La prédation est le fait que des organismes hétérotrophes prélèvent de l’énergie sur d’autres organismes, sans faire durer la vie de sa proie (différent du parasitisme). Le prédateur consomme sa proie en la chassant en général. Il va donc developper un gamme de comportement de chasse en fonction de la proie qu’il convoite. On trouve également des plantes carnivores, qui sont des végétaux prédateurs ...
Similar Free PDFs

FM - Des ratios et des communes
- 2 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu