Chine - résumé de cours PDF

| Title | Chine - résumé de cours |
|---|---|
| Course | Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques |
| Institution | Lycée Général |
| Pages | 11 |
| File Size | 483.7 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 4 |
| Total Views | 192 |
Summary
Download Chine - résumé de cours PDF
Description
2° année ECS
-
Lycée Masséna
-
B. CINQ
La Chine dans le programme de 1° année : développement et puissance - La proclamation de la République populaire de Chine ( RPC) - le traité d’amitié et de coopération avec l’URSS - Le « Grand bond en avant » - La révolution culturelle - La mort de Mao - La prise du pouvoir par Deng Xiaoping - Les manifestations de la place Tien an men
¤ Savoir dater : - La première guerre de l’opium / Le traité de Nankin - La deuxième guerre de l’opium / Le traité de Pékin - La guerre russo-japonaise autour de la Mandchourie - La chute de l’empire Qing et la mise en place de la République - La première guerre civile - L’occupation japonaise et la résistance à cette occupation - La deuxième guerre civile
¤ Savoir définir : - Un « traité inégal » - Les « trois principes du peuple » de Sun Yat Sen - Le « Grand bond en avant » - La révolution culturelle - Le socialisme de marché - Les 4 modernisations - Une ZES / Une zone franche ¤ Savoir expliquer : - Le temps de l’impérialisme occidentale et Japonais en Chine - La révolution de 1911/1912 et ses conséquences ( nouveau ) - La première guerre civile ( nouveau ) - L’occupation japonaise et la résistance à cette occupation - L’adoption et l’éloignement du modèle soviétique par la Chine - Le Grand Bond en avant et la révolution culturelle - La politique des 4 modernisations et l’ouverture de la Chine ¤ -
Commencer à réfléchir à des sujets : La Chine et l’Occident depuis le XIX° siècle La dépendance de la Chine Un modèle chinois de développement ? Une renaissance de la puissance chinoise au XX° siècle ?
1
I / Une Chine soumise aux Occidentaux et en proie aux divisions internes. 1- Le temps de l’impérialisme occidental ( du XIX° siècle à 1924 ) ¤ Au XIX° siècle, la Chine est objet de convoitises des puissances impérialistes sans toutefois provoquer la constitution de colonies en Chine. Toutes les grandes puissances coloniales installées en Asie, auxquelles il convient d’ajouter la Russie et l’Allemagne, s’entendent plus ou moins pour se partager des concessions et des zones d’influence à la suite de traités, qualifiés en Chine de « traités inégaux ». Le premier traité inégal est le traité de Nankin signé en 1842 à l’issue de la première guerre de l’opium ( 1839-1842), déclenchée par l’interdiction de Pékin d’importer cette drogue dont la culture est diffusée par les Anglais en Inde. La Chine se voit imposer la cession de Hong Kong, la limitation des tarifs douaniers et l’ouverture de ports au commerce européen. Le report du commerce de Canton ( Guangzhou) vers Shanghai ruine les provinces méridionales de la Chine. La consommation d’opium se généralise et touche 10 % de la population chinoise en 1910. En 1860, le traité de Pékin met fin à la deuxième guerre de l’opium (1856- 1860), de nouveaux ports sont ouverts et l’empire est contraint de nouer des relations diplomatiques avec les Occidentaux. Les Russes obtiennent en 1869 les provinces maritimes de l’est où ils fondent Vladivostok (port libre de glaces). Les rivalités entre la Russie et le Japon à propos de la Mandchourie et de la Corée déclenchent un conflit armé en 1904-1905, remporté par les Japonais, marquant ainsi la fin du mythe de la toute puissance occidentale sur les Asiatiques.
¤ Les traités signés à l'issue de défaites militaires ont des clauses unilatérales qui visent à imposer à la Chine une « ouverture » qu'elle refusait. C’est pourquoi ils sont qualifiés d’inégaux : ils sont entièrement pensés en fonction des intérêts des Occidentaux : - ils reçoivent des enclaves territoriales pour y établir des comptoirs sous leurs propres législations. - ils peuvent importer et exporter librement en Chine. - ils peuvent développés librement des séjours missionnaires - ils obtiennent un droit de navigation intérieure. - ils peuvent installer des travailleurs étrangers - ils ont le privilège de l’extraterritorialité. 2- Le temps du rejet de l’Occident et la guerre civile. ¤ Les années 1911/1912 marquent la chute de l’empire Qing et mise en place de la République. Plusieurs facteurs expliquent la fin de l’empire : * Le déclin de l’empire chinois au cours du XIX° siècle. Ce dernier ne parvient pas à empêcher la domination de puissances étrangères ( Etats-Unis, Européens, Russie, Japon ….). Les grandes puissances se sont constitués des zones d’influence en Chine. * La dynastie Qing ne parvient pas à se maintenir au pouvoir. Elle succède au milieu du XVII° siècle à la dynastie Ming ( 1644) ; Les Qing sont des Mandchous. Les Mandchous ne constituent pas la majorité de la population. La majorité de la population est constituée de Hans. * La révolution commence en octobre 1911 et aboutit à la proclamation de la république de Chine en janvier 1912. De 1912 à 1927, la Chine connait deux pouvoirs. - Au nord, le gouvernement des seigneurs de la guerre : des factions militaires qui se disputent le pouvoir. - Au Sud : la République de Chine du Guomindang et
ses alliés L’homme fort de la République de Chine est Sun Yat Sen est l'un des fondateurs du Guomindang, a été le premier président de la République de Chine en 1912 et,entre 1917 et 1925, dirigea plusieurs gouvernements basés dans le sud de la Chine, qui visaient à réunifier le pays alors en proie à la domination des seigneurs de la guerre. Il a développé une philosophie politique connue sous le nom des Trois principes d U p EUPle (nationalisme, démocratie et bien-être du peuple) ¤ 1927-1935 : La première guerre civile : elle oppose les communistes et les nationalistes du Guomindang. - Dans un premier temps, les communistes aident le Guomindang à lutter contre les seigneurs de la guerre. Le parti communiste chinois fondé en 1921 à Shanghai, est poussé par la Troisième internationale à collaborer avec le Guomindang, dont l’armée est dirigée par Tchang Kaï Chek. En 1926, les troupes du Guomindang, aidée par les communistes, attaquent les seigneurs de la guerre. En septembre 1926 elles s'emparent de Hangzhou, puis de Shanghaï en avril 1927 et enfin de Nanjing en mars 1927, qui devient la capitale de la République. - En 1927, Tchang-Kaï-Chek se retourne contre les communistes et entrent en opposition contre ces derniers. Tchang Kaï-chek craint l'implantation systématique des communistes dans les villes libérées. En avril 1927 il fait massacrer les communistes de Shanghaï puis en novembre 1927 ceux de Wuhan. Le chef communiste Mao Zedong décide alors de tourner l'action de son parti en direction des paysans. Débarrassé provisoirement des communistes Tchang Kai Chek reprend l'offensive contre les seigneurs de la guerre et reprend Beijing (Pékin) en juin
4
1928. La Chine est désormais réunifiée. Le Guomindang modernise la Chine. De gros efforts sont faits pour développer l'enseignement, le réseau routier et celui de chemin de fer. Mais la plus grande partie de l'industrie reste aux mains des étrangers (90% de la métallurgie, 80% du textile, 70% de la houille). Dans les campagnes où vivent les trois quarts des Chinois règne la misère. Les paysans qui sont surtout des fermiers versent plus de la moitié de leurs productions aux grands propriétaires. Dans certaines régions du sud les communistes s'implantent. Zhou Enlai organise une armée communiste. Les grands domaines sont confisqués, morcelés et les terres distribuées aux petits paysans. Les dettes et l'usure, plaies traditionnelles des campagnes chinoises sont annulées. Un impôt unique fondé sur la richesse est créé. En 1931, la république soviétique du Jiangxi est fondée avec Mao Zedong comme président. En octobre 1934, Tchang Kaï-chek attaque les communistes du Jiangxi. Ces derniers doivent partir et après une longue marche de 12 000 km parviennent dans le Shaanxi où ils s'installent. 3- Occupation japonaise et reprise de la guerre civile. ¤ Le Japon profite du chaos qui règne en Chine dans les années 1920 pour envahir la Mandchourie dès 1931. La conquête japonaise est très rapide et très violente. Cette menace stimule dans un premier temps l’union entre nationalistes et communistes dans un front uni, ce qui n’empêche pas les tensions ( attaque des communistes du Jiangxi par Tchang Kaï-chek ) ¤ Après la capitulation du Japon en 1945, la lutte reprend entre nationalistes et communistes. Cette guerre civile aboutit à la victoire des communistes de Mao Zedong qui proclame en 1949 la République populaire de Chine. II / La Chine de Mao : une puissance communiste, asiatique et mondiale en construction 1- L’adoption du modèle soviétique ¤ Dans les années 1950, la RPC noue des relations privilégiées avec l’URSS qui expliquent les choix opérés par Mao Zedong en Chine et dans le monde. Cette relation sino-soviétique est tout d’abord officialisée par la signature d’un traité d’amitié, d’alliance et d’assistance mutuelle. Le 16 décembre 1949, Mao se rend à Moscou où il rencontre Staline. Des négociations aboutissent à la signature en février 1950 du traité valable trente ans. ¤ L’URSS accorde un prêt modeste de 300 millions de dollars à la Chine et envoie
des conseillers techniques et militaires en Chine. Ces relations sino-soviétiques déterminent les choix de d’organisation politique et économique opérés par les Chinois. Très rapidement, Mao dote la Chine d’un régime politique inspiré par celui mis en place par Staline en URSS. Le parti communiste chinois (PCC) devient le parti unique d’un régime autoritaire qui utilise abondamment la propagande et n’hésite pas à recourir à la terreur, les opposants au régime étant enfermés dans des laogaï, des camps de travail pouvant être comparés au goulag. Sur le plan économique, la Chine s’engage dans une réforme agraire suivie d’une collectivisation des terres et adopte un plan quinquennal qui donne priorité à l’industrie lourde. 2- La mise à distance du modèle soviétique par Mao ¤ Mao veut faire de la Chine le centre d’une « révolution communiste véritable ». Il propose donc un modèle original et spécifique d’un pays du tiers-monde qui ne peut pas s’appuyer sur un prolétariat urbain ouvrier encore très minoritaire dans la population mais sur une vaste paysannerie en mettant en œuvre une collectivisation accélérée. « marcher sur les deux jambes » est le nouveau mot d’ordre : il faut s’appuyer sur l’agriculture et sur l’industrie. ¤ De vastes communes populaires sont créées en 1958 ; elles remplacent les coopératives de productions agricoles mises en place à partir des années 1950. On supprime toute trace de propriété privée ; la vie collective est organisée pour détruire la cellule familiale et la vie privée. Ce sont à la fois des lieux de production agricole et industrielle. La politique du « Grand Bond en Avant » tourne à la catastrophe tant elle désorganise les campagnes à force de vouloir les restructurer, avec plus de vingt millions de personnes tuées par la famine. ¤ Mao est obligé de s’éclipser. Il s’efface derrière Zhou Enlaï qui prône la « supériorité de l’expert sur le rouge ». Il en termine avec l’industrialisation des communes populaires et il décide la restitution des lopins de terres aux familles. 3- Les difficultés de l’économie chinoise La croissance de la population est importante. La production industrielle et agricole est insuffisante au regard de la croissance de la population. Le contexte de révolution permanente développé par Mao a freiné la production mais elle a préparé la Chine à une autre révolution celle du marché sous contrôle communiste.
III / La Chine de Deng Xiaoping : la Chine de l’ouverture. 1- Un changement de politique économique ¤ Après la mort de Mao en 1976, les réformateurs arrivent au pouvoir en 1978. Mesurant le dynamisme économique des autre Chines (Hong-Kong et Taïwan) et, plus généralement, de l’Asie maritime, ils entreprennent une politique d’ouverture visant à insérer la Chine dans la mondialisation libérale tout en conservant le cadre politique autoritaire du parti. ¤ Deng Xiaoping relance l’idée des 4 modernisations de Zhou Enlaï définies en 1975. La Chine doit se moderniser dans 4 domaines afin de redevenir une grande puissance : - l’agriculture - l’industrie - les sciences et technologies - la défense nationale. ¤ Deng Xiaoping accompagne cette politique des 4 modernisations par une doctrine économique qui revient partiellement sur les fondements marxistes- léninistes du socialisme économique marxiste-léniniste tel qu’il a été mis en place par en URSS. La nouvelle doctrine est le socialisme de marché : système qui combine l’économie de marché capitaliste et les principes fondamentaux du marxisme. L’Etat conserve le contrôle de l’économie mais permet la création d’entreprises privées et l’accès des Chinois à la propriété privée. ¤ Trois phases de réformes ont permis ont permis à la Chine d’être une économie socialiste de marché. La reconnaissance historique de la coexistence de la planification centralisée de l’économie de marché par le comité central du PCC amène l’ Etat à créer un environnement favorable : - Dans le domaine agricole, si la terre demeure la propriété, les paysans obtiennent le droit de la cultiver, ce qui permet l’accroissement de la production et l’approvisionnement des marchés urbains. - Le système bancaire est modifié pour s’aligner sur les normes internationales. - La réforme des entreprises commence par une autonomie de gestion donnée aux firmes d’Etat, puis à partir de 1990, la Chine s’engage dans un vaste mouvement de privatisation.
2- La nécessité de définir de nouvelles relations avec l’Occident ¤ La politique des 4 modernisations passe notamment pour Deng Xiaoping par une ouverture de l’économie chinoise aux autres pays. Le but est d’assurer le transfert de technologie nécessaire pour assurer le développement économique de la Chine. L’ouverture de l’économie chinoise se manifeste par la possibilité pour les grandes firmes transnationales étrangères de venir s’installer en Chine. Les étapes de l’ouverture chinoise : - Dans un premier temps, l’ouverture du territoire aux FTN étrangères se limite à quelques quartiers spéciaux isolés du reste de la ville, avant de s’étendre au reste de la ville, dans des territoires transformés en ZES Les ZES sont des zones proposant aux entreprises étrangères des conditions préférentielles : droits de douane faibles, libre rapatriement des investissements et des bénéfices, pas d’impôts pendant plusieurs années puis impôts très bas, statut d’extra-territorialité pour les cadres qui viennent travailler... Quatre zones économiques spéciales chinoises ont été créées * A Shanghaï: Pudong District 1 * Dans le Guangdong : Shantou 2 Shenzhen en 1980, à la frontière de Hong Kong 4 Zhuhai, en 1980, à la frontière de Macao 5 * Dans le Fujian : Xiamen, en 1980, à la frontière de la République de Chine (Taïwan) 2 * La province de Hainan, qui forme également une île. D'autre part, certains territoires n'ont pas le nom de ZES, mais bénéficient également de dispositions juridiques particulières
Ces zones vont rencontrer un succès remarquable à la fin des années 1990, s’élargir aux régions proches du littoral, et accueillir plus de 150 000 entreprises étrangères attirées par le faible coût de la main-d’œuvre et l’énormité d’un marché chinois en croissance. Les ZES ont pu étendre le territoire d'application de la législation spéciale, et d'autres ZES ont été créées. 3) Les conséquences des réformes ¤ En 25 ans, la Chine a multiplié son PIB par 7 et connu en 2006 une croissance record de 10,7 %. Le commerce international produit cette richesse. En 2015, La Chine représente désormais 12 % des exportations mondiales et a accumulé plus de 600 milliards de dollars de réserve de change. ¤ Mais la Chine continue à refuser de la 5° modernisation, la démocratie. En 1989, les manifestations de la place Tian an men font l’objet d’une répression entre 400 et plusieurs milliers de morts.
2° année ECS
-
Lycée Masséna
Mao : Homme politique chinois, un des fondateurs du PC chinois ainsi que le créateur de la République populaire de Chine en 1949, dont il fut le président jusqu'en 1959 et a continué d'en être l'un des plus hauts dirigeants jusqu’à sa mort en 1976. Il s’impose comme le chef des communistes chinois dans la guerre civile qui les oppose aux nationalistes. En 1937, pour lutter contre l'invasion japonaise de la Chine, Mao s'allie aux nationalistes du Guomindang. En 1947, la guerre civile reprend entre les nationalistes et les communistes. Ces er
derniers triomphent et le 1 octobre 1949, à Pékin, Mao Zedong proclame la République populaire chinoise. Il adopte dans un premier temps le modèle soviétique. Puis il lance le Grand bond en avant en 1958 dans l’espoir que la mobilisation à grande échelle du travail des Chinois puisse remplacer le capital financier, qui fait défaut, pour développer l'économie. Par ailleurs, il pousse à la suppression de la vie privée et à la promotion de la vie en collectivité. Mais les résultats sont extrêmement décevants ; les campagnes sont désorganisées et une famine fait une vingtaine de millions de morts. Mao est critiqué et écarté du pouvoir. Aussi celui-ci pour le reconquérir, lance en 1966, la Révolution culturelle. En donnant carte blanche aux jeunes Gardes rouges communistes ceux-ci peuvent attaquer les cadres du parti communiste aux idées jugées conservatrices. Mao ne peut s'opposer au retour au pouvoir des communistes gestionnaires, notamment Deng Xiaoping soutenu par le premier ministre Zhou Enlai. Deng Xiaoping : Fils d'un riche propriétaire foncier du Sichuan, Deng Xiaoping part pour la France comme ouvrier-étudiant dans les années 1920 où il adhère à la branche européenne du Parti Communiste chinois et noue une amitié avec le jeune Zhou Enlai. Après un détour par Moscou, il rentre en Chine en 1926 et rejoint Mao Zedong dans la guerre civile qui l’oppose aux nationalistes. Nommé en 1945 au comité central du PCC, il en monte rapidement les échelons, après l'établissement du régime communiste en
-
B. CINQ
1949. En 1958, il se montre critique à propos du « Grand Bond en avant » . Il incarne dès lors le pragmatisme économique résumé par la formule de 1961 « Peu importe que le chat soit noir ou blanc pourvu qu'il attrape les souris ! ». Il soutient la politique de Zhou Enlaï dans les années 1960 et participe à l’élaboration du programme des « Quatre modernisations » en 1964. Mao, souhaitant revenir au centre de la scène lance la « révolution culturelle » dont Deng Xiaoping est victime dès 1966. Il est évincé de la scène politique et, à 65 ans, doit se soumettre à une rééducation forcée. Son fils est arrêté et torturé jusqu'à perdre l'usage de ses jambes. Mais le pays s'enfonce dans le chaos ; Mao, désemparé, accepte en 1973 de le réhabiliter à la demande de Zhou Enlai. Il lui confie les postes de vice-premier ministre et chef d'état-major avec mission de rétablir l'ordre. L'ancien réprouvé apparaît désormais comme le dauphin du vieux chef. Après la mort de Zhou Enlai et de Mao Zedong en 1976, Deng Xiaoping est brièvement démis de ses fonctions mais réhabilité dès l'année suivante. Fort de sa popularité, Deng modernise le pays à marche forcée. Il allège la pression de l'État sur les entreprises et fait entrer la Chine au FMI et à la Banque Mondiale. Fervent partisan de la propriété privée et de la libre entreprise, Deng Xiaoping crée quatre Zones ÉconomiqUE s Spéciales (Shenzhen, Zhuhai et Shantou dans le Guangdong et Xiamen dans le Fujian) afin de drainer des capitaux étrangers. Ces ZES ou zones franches sont à les espaces à l’origine du développement économique de la Chine. Cependant, le programme des « Q UAtre Modernisations » (industrie, agriculture, recherche, défense) ne comprend pas de libéralisation du système politique. Deng Xiaoping quitte la direction du Parti en 1987 mais il continue à être influent. En 1992, il se replace en revanche dans la dynamique de l'ouverture au capitalisme en lançant la doctrine de « l'économie socialiste de marché » . Il installe à la présidence de la République Jiang Zemin et se retire progressivement des affaires, avant de disparaître en 1997.
2° année ECS
-
Lycée Masséna
-
B. CINQ...
Similar Free PDFs

Chine - résumé de cours
- 11 Pages

Histoire de la Chine 1
- 14 Pages

Résumer 1er empereur de Chine
- 3 Pages

GÉO Japon- Chine - géographie
- 5 Pages

Dissertation sur la Chine
- 12 Pages
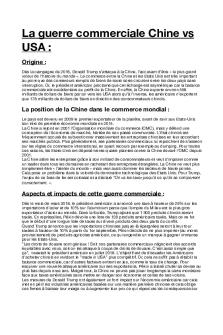
Guerre Commerciale Chine/USA
- 2 Pages

Cours 11 notes de cours
- 8 Pages

Anova 2 - Notes de cours cours 5
- 24 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu







