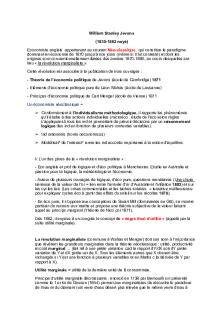Macro Cours 1 PDF

| Title | Macro Cours 1 |
|---|---|
| Course | Licence Economie-Gestion - Première année |
| Institution | Université Paris-Saclay |
| Pages | 57 |
| File Size | 2.4 MB |
| File Type | |
| Total Downloads | 1 |
| Total Views | 162 |
Summary
Macroéconomie L1 Economie-Gestion...
Description
L1 ÉCONOMIE-GESTION
MACROÉCONOMIE ¾
Bibliographie ֜ Macroéconomie, Gregory N. Mankiw – De Boeck ֜ Macroéconomie, Olivier Blanchard & Daniel Cohen – Pearson
¾
Qu’est-ce que la macroéconomie ? ֜ Analyse des variables économiques agrégées (à l’échelle d’un pays ou d’un groupe de pays et de leurs relations). ֜ Quelques exemples d’agrégats : PIB, chômage, inflation, consommation, épargne, exportation, etc. ֜ « Analyse » : Étude des facteurs à l’origine des fluctuations ou des évolutions de ces agrégats.
¾
Macroéconomie vs. Microéconomie ֜ Macroéconomie : étude de variables agrégées. ֜ Microéconomie : étude des comportements individuels des agents économiques (un ménage, une entreprise, etc.)… ֜ et donc de variables individuelles : revenu d’un ménage, vente d’une entreprise, etc. ֜ Mais la somme des comportements individuels : origine des agrégats économiques.
¾
Fondements microéconomiques de la macroéconomie ֜ Par exemple, la somme des choix individuels d’épargne des habitants d’un pays = le niveau total d’épargne d’un pays. ֜ Autre exemple, décision de consommation d’un ménage = maximisation de son utilité en fonction du budget disponible. (cf. cours de microéconomie) ֜ Alors, consommation d’un pays = la somme de ces optimisations. ֜ En macroéconomie : pas de traitement explicite des comportements d’optimisation des choix individuels (ie. pas de calculs de maximisation). ֜ Comportements d’optimisation des agents considérés comme implicites : intégrés ou inclus « implicitement » dans les équations de comportement. ֜ On parle ainsi des fondements microéconomiques de la macroéconomie. Principales variables économiques ֜ Trois principaux agrégats étudiés par la macroéconomie. ֜ PIB (Produit Intérieur Brut) = Richesse ou bien-être d’une économie. (rapport Stiglite) Evolution du PIB en valeur et en volume 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0
PIB en valeur
-1-
PIB en volume
08
06
20
02 04
20
20
20
98
00
20
94 96
19
19
19
90 92 19
19
86 88 19
19
82 84 19
19
76
78 80 19
19
74
19
72
19
70
19
68
19
19
64
66
19
62
19
19
60
0,0 -2,0
19
¾
MACROÉCONOMIE
L1 ÉCONOMIE-GESTION
֜ Taux d’inflation = variation dans le temps du niveau des prix. Évolution du taux d’inflation (1960- 2009)
֜ Taux de chômage = part de la population active sans emploi. Taux de chômage français (1976- 2009)
¾
Les agents de la macroéconomie ֜ Quatre types d’agents : entreprises : production des biens et services, investissement et distribution de revenus. ménages : consommation, épargne et réception de revenus. État : impôt, dépense et épargne publiques. l’extérieur ou le reste du monde : entreprises, consommateurs et États étrangers (vs. domestiques). ֜ Dans ce cours, pas d’influence de l’extérieur ou du reste du monde : uniquement des modèles en économie « fermée ».
¾
Les modèles macroéconomiques ֜ Choix ou décision des différents agents représentés par des variables économiques : consommation, investissement, épargne, etc. ֜ Interactions entre les différents agents : représentées à l’aide d’équations dans des modèles. ֜ Deux types de variables dans les modèles : exogène : variable déterminée en dehors du modèle (ie. donnée). endogène : déterminée par les interactions des agents dans le modèle.
-2-
MACROÉCONOMIE
L1 ÉCONOMIE-GESTION
֜ Pré-requis en mathématiques par la résolution des modèles : manipuler et résoudre des systèmes d’équations. ֜ Exemple : Demande et offre de beignets dans un pays peuvent être modélisées comme ceci : Soient Y le PIB du pays = 10 et p = le prix du beignet. Demande des ménages : DY , p 60 10 p 3
Offre des entreprises : OY , p
À l’équilibre : D Y , P
Calculer à l’équilibre (cf. ci-dessous) : p, O et D.
20 5p Y
OY , p D
60 10p 3Y 60 10 p 3 u 10 90 30
15 p
60
15 p
p
O
20 5 p Y 20 5 p 10
60 15
4
O = 50 ; D = 50 ¾
L’utilité des modèles ֜ Des représentations simplifiées de phénomènes plus complexes en réalité, mais : Passage obligé en économie : pas de possibilité de tests réels ou « grandeurs natures » sur les politiques économiques (vs. chimie, physique, etc.). Font l’objet de tests empiriques (ie. sur les chiffres observés) afin d’évaluer leur validité. ֜ Au final, utilisation des modèles : Synthèse des relations vérifiées en général entre les variables économiques d’intérêt de la macroéconomie (PIB, chômage, épargne, etc.). ֜ Inconvénients : Nombre restreint de variables = approche simplifiée. Difficile prise en compte de facteurs non « économiques » (historique, sociologique, etc.). ֜ Avantages : Cadre explicatif (pédagogique) du fonctionnement de l’économie. Peuvent être utilisés pour déduire les impacts des politiques économiques et donc leur efficacité. ֜ Évaluation de l’efficacité des politiques économiques : un des principaux objectifs de la macroéconomie.
¾
Macroéconomie et politiques économiques ֜ Objectifs des politiques économiques = influences l’offre et/ou la demande de biens et services. ֜ Pour stimuler la demande de biens et services (ie. les dépenses des agents économiques), l’État a deux principaux leviers : Politiques budgétaires : modifier les niveaux des dépenses publiques (investissement, prestations sociales, etc.) et/ou des impôts (fiscalité). Politiques monétaires : modifier les niveaux des taux d’intérêt et/ou de la masse monétaire. ֜ Pour influencer l’offre de biens et services (ie. le niveau de production), l’État peut : Modifier la règlementation du travail : durée du temps de travail, flexibilité des contrats, indemnisation du chômage, etc. Influencer la productivité du travail : formations, investissements en infrastructure, etc. Politiques technologiques ou industrielles : soutien à l’innovation, crédit d’impôt pour la R&D (Recherche & Développement), création des pôles de compétitivité. ֜ Dans ce cours : focus surtout sur les politiques visant à influencer la demande. -3-
MACROÉCONOMIE
¾
L1 ÉCONOMIE-GESTION
Le temps dans les modèles macroéconomiques ֜ Trois types de modèles en fonction de leur temporalité : court, moyen ou long terme. ֜ Court terme : les variables d’ajustement des modèles (prix et salaires) ֜ rigides, ie. pas d’évolution continue mais séquentielle. ֜ Variables d’ajustement : flexibles avec l’allongement du terme du modèle, ie. dans le long terme flexibilité de toutes les variables. ֜ Dans ce cours : focus sur les modèles de court et moyen termes.
¾
Quel intérêt à l’étude de la macroéconomie ? ֜ Macroéconomie : intérêt particulier pour le PIB, le taux de chômage et l’inflation. ֜ Mais également : taux d’intérêt, épargne, consommation, investissement, budget de l’État, etc. ֜ Or, répercussions plus ou moins directes de tous ces agrégats économiques sur la vie quotidienne des agents (ménages, entreprises, État) d’une économie. ֜ Ménages (consommateur, épargnant et salarié) : Évolution du PIB et du chômage : perspectives d’emploi, d’évolution des salaires, etc. Taux d’inflation : évolution du pouvoir d’achat, de la valeur des patrimoines (immobilier), etc. Taux d’intérêt : Coût des emprunts (achat immobilier, voiture , etc.), rendement des placements (épargne, action, etc.), etc. ֜ Pour l’État (contribuable et citoyen) : Évolution du PIB et du chômage : dépenses publiques contra-cycliques (prestations sociales) et rentrées fiscales pro-cycliques (TVA, impôt bénéfice et revenu). ֜ Pour les entreprises (salariés et économistes) : Évolution du PIB : perspective de vente, anticipation du niveau de production, opportunités de développement, etc. Évolution du chômage : difficulté à recruter, évolution des salariés, de la demande, etc. Taux d’intérêt : coût des investissements, rendement des placements et des prêts, etc. ֜ Au final, macroéconomie : mieux comprendre et anticiper le contexte économique général d’un pays (utile en tant que citoyen et économiste).
¾
Les questions de la macroéconomie ֜ Des exemples de problèmes récurrents : Comment vont évoluer le taux de chômage, le taux de croissance du PIB ou le taux d’inflation ? Comment vont évoluer les taux d’intérêt, la consommation ou l’épargne ? ֜ Des exemples de problèmes conjoncturels ou d’actualité : « Zone Euro : l’inflation au plus haut depuis 2 ans », Les Échos (5 janvier 2011).
¾
Objectifs du cours ֜ ֜ ֜ ֜
Présenter les principaux agrégats économiques (définition, mode de calcul, limite, etc.). Fournir un cadre explicatif (modèle) des évolutions et interaction de ces agrégats. Mettre en évidence à l’aide de données ou d’exemples récents le degré de validité de ces modèles. Objectif : meilleures compréhension et anticipation du contexte économique global d’une économie.
-4-
MACROÉCONOMIE
L1 ÉCONOMIE-GESTION
Les principaux agrégats de la macroéconomie (1) : le PIB ֜ PIB = Somme des valeurs ajoutées crées par les unités résidentes d’un pays. ֜ Même si beaucoup de critiques (rapport Stiglite) : indicateur couramment utilisé pour mesurer la santé et le dynamisme d’une économie. ֜ PNB (Produit National Brut) = Somme des valeurs ajoutées par les résidents d’un pays. ֜ Le PNB intègre les valeurs ajoutées des entreprises françaises à l’étranger et ne prend pas en compte les valeurs ajoutées des entreprises « étrangères » situées en France. ¾
Les calculs du PIB ֜ Trois formes de calculs équivalents : Point de vue de la production : somme des valeurs créées dans l’économie. Point de vue des revenus : somme des revenus distribués dans l’économie. Point de vue de la demande : valeur totale des biens et services finals produis et achetés dans l’économie. ֜ Produit final : produit consommé en l’état. ֜ Ne pas confondre avec produit intermédiaire : intégré et « détruit » au cours du processus de production (consommation intermédiaire). ֜ Valeur ajoutée = Différences entre production (ou chiffre d’affaires) et les consommations intermédiaires (CI). ֜ Par exemple, soit une économie composée de deux entreprises : Entreprise ᬅ : fabrique de l’acier, emploie des salariés et utilise des équipements (80 €) et vend sa production pour 100 €. Entreprise ᬆ : fabrique des voitures, emploie des salariés et utilise des équipements (70 €), de l’acier (100 €) et vend sa production pour 210 €. Fabrication d’acier
Fabrication de voitures
80
70
Consommations intermédiaires
-
100
Production ou chiffre d’affaires
100
210
Valeur ajoutée
100
110
20
40
Dépenses (non CI)
Profit
֜ PIB comme somme des valeurs ajoutées : Valeur ajoutée Entreprise ᬅ : CA – CI = 100 – 0 = 100 €. Valeur ajoutée Entreprise ᬆ : CA – CI = 210 – 100 = 110 €. PIB = 100 + 110 = 210 €. ֜ PIB comme somme des biens finals achetés : un seul bien final (les voitures) pour 210 € (= PIB). ֜ PIB comme somme des revenus distribués : Salarié et achat d’équipement (revenus du travail) = 80 + 70 = 150 €. Profit (revenus du capital) = 20 + 40 = 60 €. PIB = 150 + 60 = 210 €. ¾
PIB nominal et PIB réel ֜ Distinction de 2 types de PIB. ֜ PIB nominal ou prix courants ou en valeur : somme des quantités des biens et services finals produits durant l’année t (qt) multipliée par leurs prix courants (pt) (ie. prix durant l’année t). ֜ Autrement dit : PIBnominal = 6q t u pt -5-
MACROÉCONOMIE
L1 ÉCONOMIE-GESTION
֜ PIB réel ou à prix constants ou en volume : somme des quantités de biens et services finals produits durant l’année t (qt) multipliée par leurs prix constants (pc). ֜ Prix constants (pc) : prix des biens au cours d’une année antérieure à l’année t et choisie comme « année de base » ou « de référence ». ֜ Autrement dit : PIBréel = 6 q t u pc ֜ Distinction variable réelle et variable nominale : très courante en macroéconomie. ֜ Pas seulement pour le PIB : aussi pour le taux d’intérêt, les salaires, etc. ֜ Important de bien saisir la différence, pour cela : un exemple numérique. Année
Quantité
Prix
2008
10
100 €
2009
12
120 €
2010
13
110 €
֜ Calculer les PIB nominaux 2008, 2009, 2010, et leurs taux de croissance (2009 et 2010). ֜ Calculer les PIB réels (base 2008) 2008, 2009 et 2010, et leurs taux de croissance (2009 et 2010). ֜ PIB nominaux : 2008 = 1 000 € ; 2009 = 1 440 € ; 2010 = 1 430 €. Taux de croissance : 2009 = 44% et 2010 = 0,7%. ֜ PIB réels : 2008 = 1 000 € ; 2009 = 1 200 € ; 2010 = 1 300 €. Taux de croissance : 2009 = 20% et 2010 = 8,3%. ֜ PIB nominal : changement si variation de la quantité produite et/ou des prix des biens. ֜ PIB réel : variation seulement en cas d’une hausse de la production ĺ meilleur indicateur de croissance de la production de biens et services.
Les principaux agrégats de la macroéconomie (2) : le taux de chômage ֜ Taux de chômage (u) : nombre de chômeurs (U) rapporté à la population active (L). U soit u L ֜ Population active : somme des travailleurs ayant une activité rémunérée et des chômeurs (ie. personnes cherchant une activité rémunérée). ֜ Le taux de chômage dépend : des caractéristiques du marché du travail (flexibilité, rigidité, syndicat, etc.). du dynamisme économique du pays (PIB). ¾
Les coûts du chômage ֜ En macroéconomie : chômage = indicateur de la « santé » d’une économie, mais également à l’origine de nombreux coûts ». ֜ Les coûts économiques : Moins de revenus et donc de consommation. État : plus de dépenses publiques (allocations chômage, logement, etc.) et moins de rentrée fiscale (TVA, impôt sur le revenu, etc.). ֜ Les coûts sociaux : Accroissement de la pauvreté. Perte de compétence, stress, démotivation, etc.
-6-
MACROÉCONOMIE
¾
L1 ÉCONOMIE-GESTION
Les différents taux de chômage ֜ Les différentes catégories de chômeurs : Catégorie A : sans emploi cherchant un emploi à plein temps en CDI. Catégorie B : sans emploi mais ayant une activité réduite courte (moins de 78 heures dans le mois) et cherchant en temps partiel en CDI. Catégorie C : sans emploi mais ayant eu une activité réduite longue (plus de 78 heures dans le mois), cherchant un CDD, un emploi temporaire ou saisonnier. Catégorie D et E : sans emploi et non tenus à en chercher un (stage, formation… pour les D). ֜ En général : taux de chômage officiel calculé à partir de la catégorie A. ֜ France métropolitaine Décembre 2010 (DARES). Catégorie
Nombre (en milliers)
Population active (en %)
A
2 725,2
9,6%
B
0 544,1
1,9%
C
0 782,4
2,7%
Total ABC
4 051,7
14,2%
D
0 246,9
0,9%
E
0 352,1
1,2%
Total ABCDE
4 309,5
15,1%
Les principaux agrégats de la macroéconomie (3) : le taux d’inflation ֜ Taux d’inflation : mesure de la variation du niveau des prix dans une économie. ֜ Nombreuses répercussions économiques de l’inflation sur : le pouvoir d’achat ; l’évolution des revenus indexés (RMI, SMIC, etc.) ; les taux d’intérêt réels et nominaux, taux de rémunération du Livret A, etc. ֜ Mais aussi d’autres coûts – directs ou connus. ֜ Coûts « en chaussure » : Fort taux d’inflation ĺ taux d’intérêt élevé : augmentation du coût d’opportunité de détention de la monnaie (en liquide) vs compte bancaire. Aller-retour au guichet pour retirer du liquide et laisser « travailler » l’argent au maximum. ֜ Incertitude sur les rendements des placements à taux fixe (exemple : obligations) : arbitrage consommation/épargne plus difficile (retraite). ֜ Distinctions fiscales : Propriétaire de maison dans des zones très recherchées (exemple : Île de Ré) : forte inflation des prix. Forte baisse du patrimoine évalué au prix du marché : paiement de l’Impôt sur la fortune (ISF). Autres exemples : tranche d’impôt fixes mais revenu augmentant au rythme de l’inflation. ֜ Illusion monétaire : difficulté des agents à prendre en compte correctement l’inflation dans leurs décisions économiques. ֜ Achat d’un collier en or par 3 copines en Espagne pour 1 000 € et revente au bout d’un an.
-7-
MACROÉCONOMIE
L1 ÉCONOMIE-GESTION
Prénom
Pays
Inflation annuelle
Croissance du PIB
Taux de chômage
Prix de revente
Variation du prix d’achat
Angela
Allemagne
+ 5%
+ 3%
7%
1 000 €
-
Rebecca
Angleterre
5%
– 1%
9%
0 950 €
50
Olivia
Italie
+ 10%
+ 4%
9%
1 090 €
+ 90
֜ Qui a fait la meilleure affaire lors de la revente ? ֜ C’est Rebecca : pas de perte de pouvoir d’achat, puis Olivia (perte d’environ 1%) et Angela (perte de 5%). ֜ L’inflation est mesurée à partir de l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC). ֜ Indice des prix à la consommation : prix d’un panier de biens et services considéré comme représentatif des achats et dépenses des ménages français. ֜ Prix de l’IPC calculé par l’INSEE pour l’ensemble des ménages français, mais aussi pour des catégories plus fines. Ménages ouvriers, d’employés, cadres supérieurs, etc. Jeune coupe avec ou sans enfant, etc. ¾
Indice des prix à la consommation et taux d’inflation ֜ Méthode de calcul de l’IPC Composé de plus de 1 000 variétés de biens (alimentaire, vêtement, équipement, électroménager, etc.)… … et de tarifs (médecin, ticket de transport, électricité, eau, cinéma, etc.). Prix de ces biens et services mesurées chaque mois. Dans plus de 25 000 points de ventes (magasins, petite, moyenne ou grande surface, etc.)… … situés dans 106 communes de plus de 2 000 habitants (et de taille diverse) dans différentes zones.
¾
IPC et taux d’inflation : les calculs ֜ L’IPC est utilisé pour calculer plusieurs indices d’évolutions des prix : taux d’inflation, déflateur du PIB et un indice base 100. ֜ L’indice base 100 (année de base actuellement pour l’INSEE : 1998). IPC t u 100 ֜ IPCtbase 98 = IPC1998 ֜ Évolution IPCbase 98 : évolution des prix sur moyen ou long terme. Évolution de l’IPC (base 100=1998)
-8-
MACROÉCONOMIE
L1 ÉCONOMIE-GESTION
֜ IPC utilisé pour le calcul du taux d’inflation de l’économie : taux de croissance annuel de l’IPC. IPC t IPC t 1 ֜ Taux d’inflationt = IPCt 1 ֜ Taux d’inflation annuel = évolution à court terme de niveau général des prix d’un pays. ֜ Calcul traditionnel = de janvier à décembre, mais aussi en glissement annuel (exemple : de mars 2009 à mars 2010) pour des mesures ...
Similar Free PDFs

Macro Cours 1
- 57 Pages

Practica 1 Macro 1
- 11 Pages

CM Macro - Notes de cours Complet
- 63 Pages

Aplicatii macro seminar 1
- 13 Pages

Macro quiz #1
- 3 Pages

Cours Météorologie cours 1
- 33 Pages

Macro Economics 1 FISCAL POLICY
- 14 Pages

Macro
- 5 Pages

Macro
- 2 Pages

Cours 1
- 19 Pages

Cours 1
- 2 Pages

Cours-1 - Notes de cours 1
- 10 Pages

Resumen Macro - .................
- 63 Pages

Macro 95ex4
- 18 Pages

Macro Econ, Chapter 1 - Notes
- 5 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu