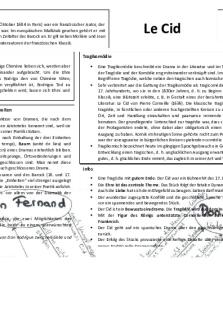Fiche - Corneille, Le Cid, Acte III PDF

| Title | Fiche - Corneille, Le Cid, Acte III |
|---|---|
| Author | Thomas Dumats |
| Course | Littérature |
| Institution | Université de Reims Champagne-Ardenne |
| Pages | 2 |
| File Size | 88.2 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 70 |
| Total Views | 142 |
Summary
Download Fiche - Corneille, Le Cid, Acte III PDF
Description
Le Cid de Corneille Acte III, 6 L’héroïsme est une valeur qui doit être mise au crible de l’autre. Cette scène montre bien le dilemme entre l’issue du héros et l’histoire qu’il incarne. Ces 2 éléments sont préparés par les scènes précédentes. Au delà de la vue déchirante d’une épée sanglante, le meurtre semble conciliable avec l’amour dans les scènes 3-4 : « RODRIGUE : Je te le dis encore, et, quoi que j’en soupire Jusqu’au dernier soupir je veux bien le redire : Je t’ai fait une offense et j’ai dû m’y porter Pour effacer ma honte, et pour te mériter ; ». CHIMENE répond : « Tu t’es, en m’offensant, montré digne de moi ; Je me dois, par ta mort, montrer digne de toi. » Comme le dit BENICHOU dans Morales du grand siècle, « le héros couronne tous les sacrifices que l’amour inspire, par les sacrifices de l’amour lui-même ». Le héros l’était dans sa façon de venger l’offense mais le combat pour la cité prépare une autre dimension du Cid qu’il révèlera dans le récit de son combat contre les Maures. Ce qu’introduit cette scène c’est la figure du père, essentielle pour comprendre l’identité du héros. Don Diègue dit son désarroi de ne pas retrouver son fils qu’il désigne comme « ce vainqueur ». Le Cid compense le peu de vigueur du père : « Ce que peut mes vieux ans ont laissé de vigueur se consument sans fruit à chercher ce vainqueur » Le personnage est encore en gésine et uniquement question de la plénitude du contentement de la gloire. Rodrigue n’emboite pas la parole à son père. Tout partait de ce dernier mais à l’acte III,6, Rodrigue va se désolidariser de la signification que son père lui prête. Le héros va presque renier un exploit qui l’a déjà rendu célèbre « le trépas que je cherche est ma plus douce peine ». Don Diègue se fait alors le relais des valeurs de la cité et non plus de l’honneur, donnant un nouveau sens, historique, à la bravoure de son fils. Don Diègue auréole l’acte de Rodrigue d’une signification qui le dépossède de son moi et lui donne une dimension épique au dépend de sa dimension tragique. Don Diègue s’approprie le destin de son fils et sa volonté d’exclure l’expression du tragique. Le « Hélas ! » est renvoyé en rang de sensiblerie (« soupirs »). Il adoube en Rodrigue, un fils digne de lui, comme le montre la succession d’impératifs. L’exploit du fils devient louange d’autosatisfaction. Le fils est louée en fonction du père. Toutes les fins des vers font un écho à sa renommée ou à l’honneur. On peut retenir de cette éloge trop outré, un rappelle du grand nombre d’exploits de Don Diègue face à l’unique du fils (« ton/tous les miens »). L’individu n’a de valeur que par le reflet de ses ancêtres. Le père es l’incarnation de valeur qu’il faut défendre : la joue dit que le corps du père est le seul qui vaille. Le corps humiliée va rester comme témoin de l’affront. Tension entre l’ordre et l’immobilité de l’acteur qui joue (l’embrasse-til ? »). Il lui répond froidement : forme impersonnelle et réplique au seul de l’honneur, faisant écho à son père. Le moi opère un mouvement de retrait affectif. Le mot « âme » exprime une dissociation du moi. Il reçoit la joie de la victoire comme un simple retour du bonheur paternel. La périphrase « à qui je dois la vie » rend l’amour paternel objectif. « plaise » à l’hémistiche, semble amoindrir la joie de Don Diègue. Rodrigue restreint la portée de son exploit et ne sont qu’un proligomène à une colère contenue. Le « mais » fait entendre les impératifs du fils après ceux du père. Ce duel se dit aussi par le vocabulaire privatif : « ravi » ne veut plus dire la joie de « ravie », comme s’il exhibait la doublure de l’acte. Rime perdu/rendu souligne les conséquences inéluctables de cette victoire. « Ne me dites plus rien », montre que le discours est insupportable : l’ennemi n’est plus le conte mais l’amour. Le héros est dissocié en profondeur : la diérèse « glorieux » le souligne ironiquement. L’énoncé du devoir sonne le glas de la valeur qu’on y accordait et que Rodrigue ne peut plus reconnaître A la scène précédente, il pensait que l’amour se continuait par son sacrifice même « à ta générosité vient répondre la mienne ». Devant le père, le brio du langage qui exaltait la grandeur d’âme est renié. Chimène n’est nommée que par de simples périphrases, comme pour dire qu’elle disparaît déjà un peu. Don Diègue réplique par une surévaluation de l’acte : l’idéalisation de l’honneur en fait une 2nd vie « plus
chère que le jour ». Justification du sacrifice demandé par le pronom « nous », opposé à la pluralité de personnes. La forme impersonnelle de l’univers impose un idéal comme détaché de l’action. La réponse « Ah ! que me dites-vous ? » ne pose aucune question mais exprime l’horreur. Ces valeurs que doit avoir Rodrigue ne sont pas celle de Corneille et en montre ses limites. L’honneur est montré et accepté comme la valeur suprême, mais est en contradiction avec les ordres royaux et la société de Louis XIII. La valeur de l’honneur détruit la noblesse : il s’agit de lui redonner ses lettres de noblesse ! C’est l’opposition « amour, honneur, cité » qui est contesté et non l’une d’elle. Rodrigue est celui qui les unit. Les mots sont à la césur eou à la rime « le guerrier sans courage et le perfide amant » est un chiasme, réponse à l’ordre imposé par les valeurs. Le lexique de la promesse rassemble les 2 et « liens », par la diérèse, montre qu’on ne peut scinder amour/honneur. Bernard DORT dans Corneille, dramaturge « Pour les pères, la féodalité est vérité de s’imposer. Pour les enfants, elle est épreuve de soi, façon de s’exalter et d’exalter son amour en se niant soi-même, épreuve d’une liberté absolue et découverte du néant. ». Paul BENICHOU dans Morales du Grand Siècle « La vertu cornélienne est au point où le cri naturel de l’orgueil rencontre le sublime de la liberté. La grande âme est justement celle en qui cette rencontre s’opère ». Chez les 2 auteurs, Ivresse de la liberté dans la mort, seule solution au dilemme exprimée par Rodrigue « le trépas que je cherche est ma plus douce peine », le nom de Chimène est enfin prononcé. Puis Don Diègue fait fusionner les valeurs civiques avec la force guerrière (« ton prince et ton pays » impersonnel et identité de « ton bras »). Corneille montre dans cette longue tirade, son art de la persuasion. Pour endiguer la force de mort, il la met au service d’une purification politique et sociale du moi. Il commence donc par un tableau qui suggère habilement au Cid d’agir. Le rejet du verbe « croire » signal la prétention de l’ennemi et peut faire réagir un héros. Le futur proche, le présent d’énonciation de « la cours est en désordre et le peuple en alarmes », disent l’urgence de mener une bataille. Le tableau de la panique exprime le besoin d’un chef. DOUBROVSKY dans Corneille et la dialectique du héros « il va s’agir pour Rodrigue de jouer a nouveau son rôel de male, non plus à l’échelle d’une femme mais d’une collectivité ». Les mots malheur/bonheur qui s’opposent, font finir par s’articuler. On peut passer de la transgression des lois (le duel), à la défense de la cité qui les fait respecter. L’honneur individuel est montré comme source de patriotisme. Ces valeurs de mort sont converties dans la défense de la cité : « Si tu l’aimes, apprend que revenir vainqueur/ C’est encore le moyen de regagner son cœur ». Il nie la personne de Chimène pour l’intégrer au devoir. Elle devient le prix à conquérir et le dilemme est levé par celle qui en était la source. La scène s’achève sur un certain mutisme du personnage. Sa personne est comme dépassée par la perspective d’un nouveau combat et DOUBROVSKY commente « Rodrigue se voit assigné un rôle qui vient à lui de l’extérieur ». Héros engloutit dans une situation qui le dépasse, où autrui est une multiplicité d’autres. Le récit qui va suivre presque immédiatement est celui par lequel le Cid devient le Cid. La rime entre « toi/moi » souligne bien que Rodrigue va prendre le pouvoir et l’acquiert symboliquement par le récit qu’il fait....
Similar Free PDFs

Le Cid - Corneille
- 15 Pages

Fiche Suréna Corneille
- 2 Pages

Le Cid - Résumé
- 5 Pages

Fiche - Le Front Populaire
- 18 Pages

Fiche 3 - Le TES
- 4 Pages

philosophie le temps FICHE
- 6 Pages

Fiche sur le conflit
- 1 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu