Le prix dans le contrat d\'entreprise PDF

| Title | Le prix dans le contrat d\'entreprise |
|---|---|
| Author | Enzo NINA |
| Course | Droit des contrats |
| Institution | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
| Pages | 6 |
| File Size | 107.1 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 18 |
| Total Views | 168 |
Summary
Download Le prix dans le contrat d'entreprise PDF
Description
Dissertation – Le prix dans le contrat d’entreprise
Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une personne s’oblige contre une rémunération à exécuter pour l’autre partie un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante. En pratique, il revêt des situations variées. L'obligation de faire peut porter sur des choses matérielles, qu’il s’agisse d’immeubles (construction, rénovation) ou de meubles (réparation, etc.) et sur des choses immatérielles (conseils, soins, études). Elle peut consister en des travaux sur une chose mobilière ou immobilière ou en une prestation de service. La relation contractuelle implique, pour sa part, un maître d'ouvrage, donneur d'ordre, et un maître d'œuvre ou entrepreneur, qui opère le travail. À partir de la définition fournie par l'article 1710 aux termes duquel le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles, il est traditionnellement admis que le contrat d'entreprise est par essence un contrat à titre onéreux, la nécessité d'une rémunération n'imposant pas d’ailleurs que le prix consiste obligatoirement en une somme d'argent. Si la rémunération est un élément essentiel du contrat d'entreprise, celui-ci présente cependant une particularité en ce que l'étendue de la prestation à exécuter peut ne pas être complètement connue des parties lorsqu'elles contractent ensemble. La doctrine en a déduit dès le 19ème, la possibilité d'une indétermination du prix lors de la conclusion du contrat. Dans le même sens, le législateur a, dans certains cas, pris en compte la nécessité de garantir le paiement de l'entrepreneur qui aura avancé son travail et ses fournitures avant même que le prix ne soit formalisé. La question peut dès lors se poser de savoir si le prix, lorsqu'il n'a pas été fixé dès l'origine de la relation contractuelle, ne peut pas être un facteur d'incertitude pour le maître d'ouvrage lequel est, dans tous les cas, tenu à l’obligation fondamentale de payer le prix. Il sera ici observé que si le régime de la détermination du prix et de son paiement apparaissent favorables au maître d’œuvre (I), les règles relatives à la révision du prix ainsi que le rôle réservés au juge en cas d'exécution défectueuse permettent de conserver un équilibre contractuel (II).
I) Les règles a priori favorables au maître d’œuvre concernant la fixation et le paiement du prix La question se pose ici de savoir si les règles relatives à la détermination du prix (A) telles qu'issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ainsi que celles visant à garantir le paiement de ce prix (B) ne font pas du contrat d'entreprise un contrat favorable aux intérêts du maître d'œuvre ce, plus particulièrement lorsque le prix n'a pas été fixé d'avance. A) Un rôle accru du maître d'œuvre dans la détermination du prix La fixation du prix dans le contrat d'entreprise peut résulter d'un accord des parties dès avant l'exécution de la prestation. Elle résulte alors soit d'un contrat formel, soit d'un devis établi par l'entrepreneur et approuvé par le maître d'ouvrage. Dans le cadre de contrats portant sur des prestations importantes, notamment dans le domaine immobilier, la formalisation du prix peut également s'effectuer au sein de marchés soit plus particulièrement le marché à forfait dans lequel le prix est fixé d'avance et de façon ferme. Le droit de la consommation impose, pour sa part, dans les termes de l'article L 112-1 du code de la consommation, que le prestataire de services informe le consommateur sur les prix sans cependant que cette information ne soit une condition de validité du contrat. En effet, la jurisprudence a retenu que la détermination du prix n'est pas une condition de validité du contrat d'entreprise (Com. 29 janvier 1991, Civ.1 15 juin 1973 ou 28 novembre 2000). Il s'en déduit que le prix peut ne pas être fixé lors de la formation du contrat. Or, dans ce cas, il n'est pas retenu par l'article 1165 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 que les parties doivent ensemble convenir du prix une fois l’ouvrage achevé. L'entrepreneur se trouve en effet investi du pouvoir de le fixer unilatéralement à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. Par ailleurs, si le juge peut être saisi par le maître d'ouvrage en cas d'abus dans la fixation du prix par l’entrepreneur, il convient d'observer que l'ordonnance de février 2016 n'a pas retenu que le juge, comme il était susceptible de le faire antérieurement, avait alors le pouvoir de
fixer le prix. Ses pouvoirs ont été en effet délimités en ce qu'il peut uniquement être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts ou, dans des termes postérieurement introduits par le législateur par la loi du 20 avril 2018, de prononcer la résolution du contrat. L’article 1165 semble ainsi donner un rôle prédominant au maître d'œuvre dans la fixation du prix si ce dernier n'a pas été fixé avant l'exécution des travaux entre les parties. Or, dans le même temps, il convient d'observer que le régime du contrat d'entreprise accorde à l'entrepreneur un certain nombre de voies de droit permettant de sécuriser le paiement du prix. B) Les voies de droit ouvertes à l’entrepreneur en vue du paiement du prix Certaines voies de droit sont ouvertes à l'entrepreneur afin de lui assurer des garanties de paiement de sa créance de prix contre le maître d'ouvrage. Sa créance est ainsi privilégiée dans les termes de l'article 2103-4 du Code civil. Si le maître d'ouvrage ne paie pas les acomptes convenus, il peut suspendre l'exécution du contrat par le jeu de l'exception d'inexécution. Une fois le travail effectué, et en l'absence de paiement, il peut exercer un droit de rétention sur la chose qu'il détient (Com 11 juin 1969 sur le droit de rétention du garagiste) sauf faute de sa part. L'article 1799-1 du code civil issu de la loi du 10 juin 1994 a également organisé une protection de l'entrepreneur dans le domaine des travaux immobiliers en imposant au maître d'ouvrage de fournir un cautionnement bancaire faute de quoi l'entrepreneur peut cesser ses travaux après mise en demeure, cette obligation étant d'ordre public même si elle ne joue qu’au-delà d'un certain seuil Par ailleurs, et afin d'assurer le paiement du prix de travaux immobiliers effectués, en cas de défaillance des entrepreneurs principaux, la loi du 31 décembre 1975 a ouvert aux soustraitants des droits directs sur le maître d'ouvrage ayant donné leur agrément aux travaux. Ces derniers, une fois reçus copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant non payé à son débiteur, doivent geler les sommes pour les affecter directement aux sous-traitants et permettre à celui-ci d'obtenir paiement de ce qui lui est dû dans la limite de ce que le maître d'ouvrage doit encore. Ces éléments portant tant sur la fixation du prix que sur la possibilité d'en recouvrer le paiement à l'encontre du maitre d'ouvrage paraissent donc favorables à l'entrepreneur.
Cependant, il convient d'observer que pour leur part un certain nombre de règles portant sur la révision du prix contractuellement prévu et sur les pouvoirs du juge en cas d'inexécution défectueuse de la prestation viennent limiter ce premier point de vue.
II) Les protections accordées au maitre d'ouvrage lors de l'exécution du contrat Le maitre d'ouvrage se voit accorder un certain nombre de protection tant s'agissant de la révision du prix lorsque celui-ci a été contractuellement fixé par les parties (A) qu'en cas d'exécution défectueuse (B). A) Des règles de révision du prix fixé d'avance favorables au maître d'ouvrage Lorsqu'un prix a été préalablement fixé entre les parties, certaines règles sont protectrices des intérêts du maître d'ouvrage Ainsi, en matière de marché à forfait, lorsqu'un prix a été fixé d'avance de façon ferme et définitive, il est intangible. Il en résulte que les travaux convenus ne peuvent donner lieu qu'au paiement du forfait, même si leur exécution s'est avérée beaucoup plus coûteuse que prévu pour l'entrepreneur en raison de difficultés extérieures et imprévisibles. La jurisprudence a donc mis les aléas de l'exécution du marché à forfait à la charge de l'entrepreneur sauf dans le cas d'un bouleversement de l'économie du contrat (civ 3, 24 janvier 1990, civ 3 20 janvier 1999) auquel cas la jurisprudence admet la caducité du forfait. Dans le même ordre d'idées, lorsqu'un prix a été convenu entre les parties mais que la preuve doit en être rapportée, la charge de la preuve incombe à l'entrepreneur de ce que les travaux ont été commandés ou acceptés par le client (civ 1, 6 janvier 2004), le maitre d'œuvre devant également fournir les éléments permettant d'en fixer le montant. À défaut, le juge apprécie celui-ci en fonction de la qualité du travail fourni, le montant fixé?contractuellement d'avance mais non justifié étant donc susceptible d'être remis en cause.
Par ailleurs, en matière d'honoraires, et nonobstant le principe de l’autonomie de la volonté interdisant en principe au juge de modifier le prix fixé contractuellement, la jurisprudence a jusqu'ici retenu qu'en présence d'un accord des parties sur le prix que «?les tribunaux peuvent, quand une convention a été passée en vue de l’exécution de travaux donnant lieu à honoraires, réduire ces derniers lorsqu’ils paraissent exagérés, pourvu qu’ils n’aient pas été versés en connaissance du travail effectué et après service fait?» (Cass. 1ère civ., 3 juin 1986). La solution a été appliquée aux honoraires «?disproportionnés?» d’un conseil de gestion (Com., 2 mars 1993), à des honoraires d’avocat (Cass. 1ère civ., 3 mars 1998) et de généalogistes (Civ1, 5 mai 1998). Tenant compte de cette jurisprudence, l'avant-projet de réforme de l'Association Capitant suggère de retenir la possibilité d'une révision judiciaire au prix manifestement excessif ou dérisoire lorsqu'il a été fixé d'un commun accord avant l'exécution de la prestation, sauf s'il a été convenu qu'il était fixé forfaitairement (art. 72). Au-delà des règles protectrices portant sur la révision du prix fixé d'un commun accord, les droits du maître d'ouvrage sont aussi préservés concernant le prix à payer en cas d'exécution défectueuse du contrat de service B) La réduction du prix par le juge en cas d’exécution défectueuse Comme en matière de vente, et quel que soit le mode de fixation du prix, l’exécution défectueuse de ses obligations par l’entrepreneur autorise le juge à ordonner une réduction du prix afin de rétablir l’équilibre contractuel, ou, ce qui revient aux mêmes résultats, à opérer une compensation entre la créance du prix des travaux et la créance née notamment de malfaçons (Cass. 1ère civ., 1965). Il appartient pour ce faire au maître d’ouvrage de prouver l’exécution défectueuse (Cass. 3ème civ., 14 février 1996). C’est l’application au contrat d’entreprise de la réfaction du prix connue en matière de vente. Cette solution prétorienne est désormais consacrée par les dispositions de l'article 1223 du Code civil pour exécution imparfaite lequel dispose, en droit commun des contrats, qu'en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa
décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit, cet article ajoutant que si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. Ces éléments sont dès lors de nature à préserver les droits du maître d'ouvrage et à consolider l'équilibre contractuel entre les parties malgré les spécificités du contrat d'entreprise en matière de fixation et de paiement du prix....
Similar Free PDFs

Le prix psychologique
- 1 Pages

Thème 8 - Le prix
- 9 Pages
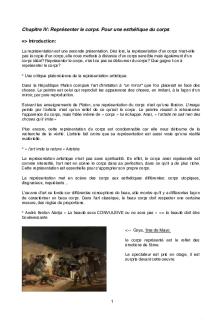
Le corps dans l\'art
- 6 Pages

Le contrat de travail - cours
- 6 Pages

Contrat ellr,grlgr, fke,le,
- 1 Pages

Les stéroïdes dans le sport
- 1 Pages

Le cinéma dans la mondialisation
- 3 Pages

La personnalité dans le recrutement
- 19 Pages

Cours - Le Miroir dans l\'Art
- 4 Pages

Chapitre 2 - Le contenu du contrat
- 11 Pages

Le contrat de vente cours - COMPLET
- 12 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu




