La sociologie et la santé PDF

| Title | La sociologie et la santé |
|---|---|
| Course | Sociologie |
| Institution | Université de Bretagne Sud |
| Pages | 6 |
| File Size | 131.8 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 96 |
| Total Views | 151 |
Summary
Sociologie de la santé...
Description
Sociologie de la santé La sociologie et la santé Bibliographie générale. Bibliographie de « La sociologie et la santé ».
I.
Qu’est-ce que la sociologie de la santé ?
Champ spécialisé de la sociologie, elle s’intéresse à la santé mais aussi à la maladie et à la médecine. La sociologie de la santé entretient des liens étroits avec l’anthropologie, l’histoire ou la psychologie sociale.
A.
Domaine 1 : la santé.
Les sociologues abordent la santé sous l’angle des politiques dont elle fait l’objet (politiques de santé), ils s’intéressent aussi aux mobilisations que la santé suscite (des usagers). Ils s’intéressent à la place que la santé occupe dans la société, une place de plus en plus importante. Etudient sous l’angle des valeurs et normes dont la santé fait l’objet, par exemple, aujourd’hui, les individus sont de plus en plus invité à surveiller, entretenir leur état de santé.
B.
Domaine 2 : la maladie
Les sociologues cherchent à rendre compte de la place que les maladies occupent dans les sociétés (époque donnée, société donnée). Leurs travaux portent aussi sur les représentations sociales des maladies (le sens que les maladies prennent pour les populations). S’intéressent aux malades et à leurs proches, entourage, aux relations entre les institutions de santé et les malades/proches. Des travaux portent sur l’expérience, le vécu, les conséquences des maladies (vie sociale, au travail des malades).
C.
Domaine 3 : la médecine.
Abordée sous de nombreux aspects, 2 principaux : des instructions qui composent ce domaine (HP, services de soins, cabinets de médecine libérale, fonctionnement, pratiques, division du travail, organisation…) et aux professions qui composent ce domaine (médecins, paramédicaux (infirmières, aidessoignantes, kiné…).
II.
Genèse de la sociologie de la santé (histoire). A. La sociologie de la santé aux Etats-Unis.
Dès l’après-guerre (début des 50’s), des grands noms de la sociologie américaine comme Parsons et Merton se sont penché sur la médecine et lance cette spécialité. Le premier texte sociologique consacré à la médecine (1951) est écrit par Parsons : « Social structure and dynamic process : the case of modern medical practice ». Aux Etats-Unis, dès l’après-guerre, des organismes privés ou publics ont financés les travaux en sociologie de la santé et en médecine.
Dans les 50’s, le système de santé américain connait une série de problèmes, système libéral qui ne permet pas répondre aux besoins de santé de l’ensemble de la population. Dans ce système, les médecins sont particulièrement attachés à l’exercice libéral, ce qui fait que les patients les plus pauvres n’ont donc pas accès à des soins de qualité. Pour éviter de réformer le système de santé, il faut donc faire du médecin un professionnel socialement orienté c’est-à-dire un professionnel responsable du bien-être de la population, préoccupé par la santé de la population. L’Etat fait appel aux sociologues, les organismes pensent pouvoir, par leurs travaux et leur implantation dans les facultés de médecines, sensibiliser les médecins sur la collectivité. Réponse à des préoccupations sociales. Les travaux menés portent sur la formation du médecin, le refus de la population à se faire soigner. Parmi ces études, certaines débouchent sur des interventions sociales, changements, par exemple, la création de dispensaires en sein desquels, les médecins ont des statuts de salariés (pas libéral). Cependant, ces premiers sociologues de la médecine ont beaucoup de mal à s’imposer, font face à une double résistance, premièrement des médecins, ils ne supportent pas qu’une autre discipline empiète sur leur domaine ; secondement des autres sociologues car il dédaignent la sociologie médicale puisqu’il s’agit d’une sociologie appliquée, finalisée, qui manque de perspective théorique, certains sociologues doutent car elles sont financés par des institutions sur lesquelles travaillent les sociologues (conflits d’intérêt). Finalement elle s’impose rapidement grâce aux grandes figures de la sociologie américaine de l’époque ; dès 1955, l’association américaine de sociologie créée une section de sociologie médicale. En 1961, on comptait plus de 1000 projets de recherche et 2000 chercheurs dans le domaine de la sociologie de la santé. Dans les 70’s, la sociologie médicale est un des domaines les plus fleurissant de la sociologie américaine.
B.
La sociologie de la santé en France.
Jusqu’aux 50’s : la sociologie ne se préoccupait pas de la santé. Pendant longtemps, les sociologues européens, ne se sont guère occuper d’analyser le champ médicale pour 5 raisons principales : -
-
-
-
Pour les sociologues français, la santé, la maladie et la médecine ne constituent pas de véritables objets de recherche. L’on estimait que la maladie et la santé n’avait aucun lien avec le social, faits individuels, biologiques, individuels. La santé et la maladie étaient principalement interprétés dans le cadre biomédical, or aujourd’hui on sait que la maladie et la santé ont aussi une dimension sociale. Ce démarrage tardif tient à la fermeture du monde médical, pendant longtemps, les médecins étaient soucieux d’ouvrir leurs portes aux sociologues. Jusqu’à une période récente, il existait un cloisonnement fort entre les facultés de médecines et les autres institutions universitaires (sciences humaines et sociale), chacun intervient dans ses institutions, pas de passerelle. Jusqu’aux 50’s, les progrès médicaux, les connaissances médicales et la profession médicale semblaient incontestables, pas remise en question comme elle l’est aujourd’hui, respect de l’autorité médicale (progrès qui montre la toute-puissance de la médecine). La généralisation de la sécurité sociale en 1945 à contribuer à masquer la dimension sociale des problèmes de santé, notamment les inégalités sociales de santé. Elle paraissait efficace, égalitaire.
La fin des 50’s : le temps des réformes et des premières études sociologiques. En France, la fin des 50’s représente un tournant dans la pratique médicale, en effet, la médecine libérale comme la médecine hospitalière font l’objet de plusieurs réformes fortes puis une période de crise, de déstabilisation qui conduit l’institution médicale à s’interroger sur elle-même. Les premières études sociologiques portent sur ses transformations, évolutions, changements. Exemples :
-
-
« Le grand tournant de la médecine générale », Henri Hatzfeld (1963) : s’intéressent aux conflits qui opposent les syndicats de médecins à la sécurité sociale et à l’Etat, autour du contrôle des honoraires médicaux. « Contribution à une sociologie de la décision. La réforme des études médicales et des structures hospitalières » (1968) de Haroun Jamous qui s’intéressent à la réforme de 1958, réforme « Debré », débouche sur la création des centres hospitaliers et des CHU (centres hospitaliers universitaires). Cette réforme a aussi modifié en profondeur l’enseignement médical, poussé le développement de la recherche médicale dans les CHU, à l’origine de la création du plein temps hospitalier pour les médecins, création du statut de médecin salarié.
Les premiers sociologues abordent le domaine de la médecine et de la santé comme des espaces de conflits, de décisions politiques, intéressant par leurs aspect général, au cours de cette période, la santé et la médecine, ne constituent pour eux que des exemples, des terrains d’étude parmi d’autres, ne sont pas encore des objets sociologiques à part entière. Sont intéressant car ils permettent d’étudier la société dans sa globalité. A cette époque, en France, personne ne soupçonne que la sociologie de la médecine est déjà un champ sociologique aux Etats-Unis.
La décennie 60’s : l’émergence d’une nouvelle spécialité sociologique. Marquée par des problèmes de gestion et de fonctionnement des institutions médicales, en effet, l’hôpital moderne est né, on veut qu’il soit , à présent, efficace, qu’il soit rentable or dans les faits, les hôpitaux connaissent des problèmes d’organisation, de gestion, le système coute plus cher que prévu : les pouvoirs publics commencent par faire appel aux économistes pour tenter de réduire les coûts et limiter les dépenses ; puis ils se tournent vers les sociologues pour qu’ils étudient les phénomènes de changement, de modernisation qui touche les institutions médicales. Dans ce contexte, l’hôpital et en particulier le CHU, devient un objet sociologique possible. Différentes recherches financées par des pouvoirs publics voient le jour dans les 60’s, elles ont toutes pour objet commun, l’hôpital, elles portent sur l’organisation de l’hôpital, la mise en œuvre des réformes hospitalière (réforme Debré), relations entre les médecins et les organisation hospitalières, la division du travail. Dans ces conditions, un nouveau domaine dans la sociologie apparait, pour la première fois, les sociologues français prennent conscience que le domaine médical constitue un champ sociologique spécifique, ils commencent à s’intéresser aux travaux d’ailleurs (anglosaxons). Claudine Herzlich, « médecine, maladie et société » (1970) : s’efforce, pour la première fois, de présenter de manière synthétique ce nouveau domaine sociologique, grâce à cet ouvrage, les sociologues français découvre ce champ aux Etats-Unis. La reconnaissance de cette sociologie reste encore faible.
1970-1990 : le temps de l’institutionnalisation et de la reconnaissance. Dans les 70’s, cette nvelle spécialité de la sociologie commence à s’institutionnaliser et à être reconnue. Cette institutionnalisation a débuté en juillet 1976 car a eu lieu le tout premier congrès (coloc) de sociologie médicale, organisée conjointement par le CNRS et par l’INSERM, à Paris, c’est un succès car les intervenants sont tous des sociologues, il a réuni 150 participants (en plus des intervenants) principalement dans le social mais aussi des médecins (inédit). A la suite, dans les 80’s, l’enseignement de la discipline se développe dans les facultés de département de sociologie ; dans les 90’s, dans les facultés de médecine. Depuis 1994, il existe un enseignement de sciences humaines obligatoire en 1ère année de fac de médecine, aujourd’hui, dans les fac françaises, il existe de nombreux départements où la santé est indispensable. Diverses formations paramédicales font appel à la sociologie de la santé, depuis 2009, les programmes d’IFSI prévoit deux UE intégrant la sociologie de la santé. Parution en 1982, de la première revue de sociologie de la santé en France, « science sociale et de la santé ». De la sociologie médicale à la sociologie de la santé : au cours de cette histoire, on a assisté à un glissement de l’intitulé de cette discipline, au départ, on parle de sociologie de la médecine/médicale, puis
dans les 70’s les choses ont évoluées, depuis les 90’s, on parle de sociologie de la santé. Ce changement est expliqué par le fait qu’à partir des 70’s, la toute-puissance de la médecine est remise en cause, elle n’est pas totalement efficace, référence au mouvement anti-médecine par Illich (chef de file, philosophe autrichien) qui a publié en 1975, un ouvrage, « Némésis médicale », dans cet ouvrage, il affirme de manière forte « l’entreprise médicale menace la santé », statistiques à l’appui, il soutenait que la médecine n’avait pas améliorer la santé dans le monde : baisse de la mortalité, s’explique plus par des progrès au niveau de l’hygiène et de l’alimentation ; des maladies iatrogènes (l’ensemble des effets néfastes qui peuvent être provoqués par un traitement ou un acte médical) ; dénonce une médicalisation exagérée. L’intitulé de la sociologie de la santé va s’imposer : englobe une diversité de thèmes.
III.
La place de la santé dans la société. A. Une place importante… (Vigarello)
Dans la plupart des sociétés on engage une conversation, on achève en s’inquiétant de la santé de son interlocuteur. Le verbe saluer vient du latin Salus, qui veut dire santé. Dans des pays africains, il convient avant d’aborder de tout sujet, de prendre des nouvelles de la santé de la personne mais aussi de la famille. Par ailleurs, les pratiques visant à entretenir la santé, ont toujours existées, ce que montre l’historien Georges Vigarello, dans son ouvrage « Histoire des pratiques de santé. Le sain et le malsain depuis le Moyen-Âge » (2014), retrace l’évolution des pratiques destinées à entretenir la santé depuis le Moyen-Age dans notre société, observe que le souci pour la santé n’est pas une préoccupation propre à notre époque (Au Moyen-Age, les pierres précieuses préservaient la santé). La pratique du régime était très présente au 16e, tout de même réservée à l’Elite ; le journal de la santé relatait le fait que Louis XIV faisait plusieurs saignées (Les globules rouges étant très riches en fer, le fait de les soustraire par saignée oblige l’organisme à les reconstituer en puisant le fer qui s’est déposé dans les organes surchargés (foie, pancréas, cœur). Le traitement vise à la fois à éliminer l’excès de fer (phase d’induction) et à éviter la reconstitution de la surcharge (phase d’entretien)) par mois ; le développement de la gymnastique. Le soucis pour la santé est loin d’être une préoccupation contemporaine.
B.
…. Et même de plus en plus importante.
Pour Georges Vigarello, en dépit de l’évolution de ces pratiques, les grands repères restent identiques d’une époque à l’autre, il pointe certaines permanences : l’idée d’épurer le corps et celle de renforcer le corps, par exemple, la saignée, renvoyait à l’idée d’épurer le corps (toxines) et la pratique de la gymnastique renvoyait à l’idée de renforcer le corps. Aujourd’hui, l’idée de renforcer le corps et renvoyer à la force de l’alimentation, des boissons (énergétiques), quant aux déchets à éliminer, ils seraient incarnés par la graisse, décrasser ses artères, se dépenser, éliminer sa masse graisseuse. Par conséquent, la santé a toujours eu une certaine importance dans nos sociétés, et même de plus en plus importante, il ajoute que la santé à prit plus d’importance encore dans la société actuelle, 3 arguments : -
-
La santé est devenue un bien de consommation comme un autre : « une santé consommée », témoigne le fort développement de la presse santé (dans les 70’s, seulement 2 magazines), ils attirent parce qu’ils répondent à des attentes individuelles en termes de santé. Le développement des sites internet dédiés à la santé (Doctissimo). Développement de nouveaux produits, de nouveaux services (thalasso thérapie, salles de remise en forme), des alicaments (yaourt qui renforce l’humanitaire), développement des applications E-santé. La santé constitue, aujourd’hui, un véritable industrie, un marché. Une plus grande exigence en matière de sa propre santé : Georges Vigarello s’appuie sur une enquête de santé publique, qui démontre que le nombre de maladie déclaré/personne s’est amplifiée de 75% entre 1970 et 1980, cette enquête repose sur la diffusion de 10 ans d’intervalle, de 2 questionnaires identiques, auprès d’un même échantillon de population, les résultats montre que le nombre de maladie augmente alors que l’espérance de vie avait également progressée : en
-
1970, en moyenne, 1.62 maladie déclarées/personne ; 1980, 2.28 maladies déclarées/personne or sur la même période, l’espérance de vie est passé de 76 à 79 ans pour les femmes et de 68 à 71 ans pour les hommes. Ces résultats permettent de voir que les individus sont devenus plus attentifs vis-à-vis de leur santé, plus exigeants ; et que la frontière séparant la santé de la maladie s’est déplacée, certains états sont considérés comme anomaux, pathologiques alors qu’ils ne l’étaient pas auparavant. La santé, un enjeu politique : l’emprise des politiques de santé sont plus grandes qu’auparavant : messages de prévention de plus en plus nombreux et donc les personnes sont de plus en plus incitées à contrôler leur santé. Ces discours culpabilisant imputent à chacun la responsabilité de sa santé, certains dénonce l’instauration d’un nouvel ordre moral dans lequel il serait mal venu de bien manger, de boire, de fumer, d’être sédentaire… La philosophe Claire Marin, « La tyrannie de la bonne santé » (2018) évoque l’idée d’une tyrannie de la bonne santé. Au-delà de cette tyrannie, la représentation de ce qui menace la santé a également changé : il ne s’agit plus de combattre contre des maux extérieur mais aussi de lutter contre des choses qui nous menace de l’intérieur, ainsi aujourd’hui, on lutte contre les prédispositions aux cancers, aux troubles cardio-vasculaires, par exemple, l’analyse ADN permet aujourd’hui de repérer des prédispositions à certaines maladies, cette nouvelle approche tend à brouiller la frontière entre santé et maladie, on ne sait plus où commence la maladie car on prétend les facteurs à risque comme des maladies que l’on va traiter, par exemple, on contrôle l’excès de cholestérol pour éviter une maladie. Lucien Sfez « La santé parfaite » (1995), fait un constat proche de Vigarello, il met en évidence l’existence, dans nos sociétés, d’une nouvelle utopie : « l’utopie de la grande santé », elle renvoie à l’image d’un homme qui serait en grande santé c’est-à-dire d’un homme qui serait débarrasser de toute maladie avant même qu’il soit né, déterminer à ne jamais tomber malade tout au long de sa vie, l’idée que la médecine soigne à priori, qu’elle soignerait en l’absence de toute maladie, utopie du 21e : il évoque des méthodes comme l’ablation des ovaires, des seins à titre préventif chez les femmes qui ont des antécédents familiaux afin qu’elles ne développent pas de cancer. Il qualifie ces pratiques de purification organique et selon lui, cette purification pourrait en préfigurer une purification génétique.
IV.
La notion de santé.
La santé est un terme complexe. A.
D’une définition restrictive et négative…
Pendant longtemps, la santé à été définie comme « l’absence de maladies », jusqu’au milieu du 20e c’est cette définition de la santé qui prédominait. La définition de référence était celle d’un médecin, René Leriche en 1936 dans « L’encyclopédie française » : « la santé c’est le silence dans la vie des organes ». Selon cette perspective, être en bonne santé c’est oublier son corps, qui se rappelle à nous qu’en cas de dysfonctionnement, de douleur, autrement dit, la santé c’est vivre dans l’inconscience de son corps, non perturbé par le bruit de la maladie. La santé était définie de façon restrictive et négative. Quelques années après, en 1943, Georges Canguilhem, « Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique » (1943) s’attache à discuter et enrichir la définition de René Leriche, il avait la particularité d’avoir une double formation : médecin et philosophe. Dans ce texte, il aborde une distinction fondamentale, entre le normal et le pathologique (santé et maladie), pour lui, il n’y a pas d’opposition nette entre le normal et le pathologique, en effet, il montre que la santé prend un sens pour un individu donné, dans un milieu social donné, face à certaines contraintes. Selon lui, il n’y a pas de sens à définir la santé d’un point de vue purement organique, biologique car la santé dépend aussi des attentes de la personne, besoins, son environnement. La santé ne peut pas être appréhender uniquement dans un sens objectif, scientifique, elle à aussi une dimension existentielle, il faut tenir compte de la subjectivité, du point de vue de la santé de l’individu qui a ses propres normes, valeurs. Exemples : certaines individus que l’on qualifie parfois de malades imaginaires, se considèrent comme maladies alors que la médecine n’a pas diagnostiqué chez eux de maladie ; inversement, des patients
diagnostiqué comme malades par la médecine, ne se sentent pas malade et clament leur normalité. Il dit donc que la maladie n’est pas seulement la maladie du médecin mais également la maladie du patient, il prétend que sans la maladie du malade il n’y ...
Similar Free PDFs

La sociologie et la santé
- 6 Pages

Sociologie de la modernité
- 29 Pages

Sociologie DE LA Musique
- 9 Pages
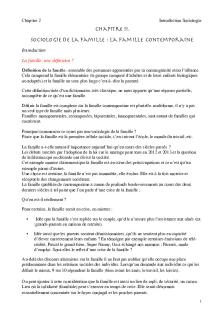
Sociologie de la famille
- 30 Pages

Sociologie de la famille
- 11 Pages

Domaines de la sociologie
- 45 Pages

Sociologie DE LA Deviance
- 18 Pages

Introduction à la sociologie
- 10 Pages

Sociologie de la culture
- 40 Pages

Délinquance et sociologie criminelle
- 28 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu





