Sociologie de la famille PDF

| Title | Sociologie de la famille |
|---|---|
| Course | Introduction À La Sociologie |
| Institution | Université Clermont-Auvergne |
| Pages | 30 |
| File Size | 1.3 MB |
| File Type | |
| Total Downloads | 42 |
| Total Views | 140 |
Summary
S1, L1 AES...
Description
Chapitre 2
Introduction Sociologie
Chapitre II. ! Sociologie de la famille : la famille contemporaine Introduction La famille, une définition ? Définition de la famille : ensemble des personnes apparentées par sa consanguinité et/ou l’alliance. Cela comprend la famille élémentaire (le groupe composé d’adultes et de leurs enfants biologiques ou adoptés) et la famille au sens plus large c’est-à- dire la parenté. Cette définition tirée d’un dictionnaire, très classique, ne nous apporte qu’une réponse partielle, incomplète de ce qu’est une famille. Définir la famille est complexe car la famille contemporaine est plurielle, multiforme, il n’y a pas un seul type de famille mais plusieurs:! Familles monoparentales, recomposées, biparentales, homoparentales, sont autant de familles qui coexistent. Pourquoi commencer ce cours par une sociologie de la famille ?! Parce que la famille est la première cellule sociale, s’en suivent l’école, le monde du travail, etc. La famille a-t-elle autant d’importance aujourd’hui qu’au cours des siècles passés ?! Les débats suscités par l’adoption de la loi sur le mariage pour tous en 2012 et 2013 et la question de la filiation qui en découle ont divisé la société.! Cet exemple montre clairement que la famille est au cœur des préoccupations et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres.! Une chose est certaine, la famille n’est pas immuable, elle évolue. Elle est à la fois motrice et réceptacle des changements sociétaux.! La famille qualifiée de contemporaine a connu de profonds bouleversements au cours des deux derniers siècles à tel point que l’on parle d’une crise de la famille ; Qu’en est-il réellement ? Pour certains, la famille serait en crise, en miettes : •
Idée que la famille s’est repliée sur le couple, qu’elle n’assure plus l’assistance aux aînés (ex :grands-parents en maison de retraite).
•
Idée aussi que les parents seraient démissionnaires, qu’ils ne seraient plus en capacité d’élever correctement leurs enfants ? En témoigne par exemple certaines émissions de téléréalité, Pascal le grand-frère, Super Nanny, On a échangé nos mamans ; Parents, mode d’emploi. Sont-elles le reflet d’une crise de la famille ?
Au-delà des discours alarmistes sur la famille il ne faut pas oublier qu’elle occupe une place prédominante dans les relations sociales des individus. Lorsqu’on demande aux individus ce qui les définit le mieux, 9 sur 10 répondent la famille (bien avant les amis, le travail, les loisirs).! ! On peut ajouter à cette considération que la famille est aussi un lieu de repli, de sécurité, un cocon. Lieu où la solidarité (familiale) peut s’exercer en temps de crise. Elle serait désormais essentiellement concentrée sur le foyer conjugal et les proches parents.! 1
Chapitre 2
Introduction Sociologie
Vous voyez, il y a un paradoxe. D’un côté on parle de crise de la famille, de l’autre d’un lieu privilégié qui est au cœur de nos relations sociales. Tâchons d’y voir un peu plus clair. ! Quel éclairage la sociologie apporte-t-elle à ses nombreux questionnements ? Mais avant de répondre à cette question il me paraît important de revenir sur les mutations qui se sont opérées au sein de la famille au cours des derniers siècles pour mieux comprendre ce qu’on entend par famille contemporaine. ! I – De la famille traditionnelle à la famille contemporaine A. La fin du modèle classique Le modèle classique, celui de la famille traditionnelle, est apparu dans la bourgeoisie du XVIIIe S. et s’est généralisé à l’ensemble de la société. Il a été dominant des années 20 aux années 60. Qu’en est-il ? Lorsqu’on parle de famille traditionnelle on fait référence à la famille nucléaire, centrée sur l’institution du mariage et sur l’éducation et la promotion sociale des enfants, famille qui impliquait une division très inégalitaire des rôles entre l’homme et la femme. A l’homme incombe la survie économique du foyer et sa représentation juridique. A la femme la reproduction biologique et la gestion de l’ordre domestique. Modèle patriarcal. Quels changements font dire que le modèle patriarcal n’est plus dominant ? Comment caractériser la famille contemporaine par opposition à la famille traditionnelle ? B. Caractéristiques de la famille contemporaine Pour le sociologue François de Singly, la famille moderne se caractérise par trois traits caractéristiques. La famille contemporaine est relationnelle, individualiste, et à la fois privée et publique.! ! - Relationnelle car il y a aujourd’hui une plus grande importance accordée à la qualité des relations. L’affectif occupe une place prépondérante. Plus simplement pour vivre ensemble il faut entretenir de bons rapports. Chaque individu est un individu à part entière, qui a des droits et qui a sa place. Pour reprendre les propos d’Emile Durkheim : « Nous ne sommes attachés à notre famille que parce que nous sommes attachés à la personne de notre père, de notre mère, de notre femme, de nos enfants. Il en était tout autrement autrefois ou les liens qui dérivaient des choses primaient au contraire ceux qui venaient des personnes, où toute l’organisation familiale avait pour objet de maintenir dans la famille les biens domestiques, et où toutes les considérations personnelles paraissaient secondaires à côté de celle-là ». Durkheim explique qu’autrefois les choses primaient sur les personnes. La transmission du patrimoine (financier, propriétés, terres, mobilier, objets) était très importante (exemple droit d’aînesse). 2
Chapitre 2
Introduction Sociologie
Aujourd’hui, c’est le lien entre les individus qui prime, ce qui nous rattache à l’autre. Les objets par exemple auront une place importante mais la raison de cet attachement aura surtout une explication affective et non matérielle.! Pour vous donner un exemple concret on peut être attaché à un bijou, à un vase, ou à une maison parce qu’ils ont appartenu à notre grand-mère. Ici l’attachement au patrimoine s’explique par le lien qui unit deux individus, l’objet évoque un être cher. Ceci illustre un changement, la famille contemporaine est relationnelle comme en témoignent ces exemples. - La famille contemporaine est individualiste.! Pour Emile Durkheim, la famille contemporaine est individualiste. Que veut-il dire ? Durkheim observe et annonce « une centration sur les personnes associées à une contraction de la famille ». La « zone centrale » de la famille conjugale est composée de la femme, du mari et des enfants, zone entourée de « zones secondaires », les ascendants, les descendants. Comment s’explique cette contraction et quel rapport avec l’individualisation ?! L’individualisation des rapports, c’est-à-dire le fait d’entretenir des rapports plus étroits entre individus d’une même famille, autrement dit des rapports privilégiés, a entraîné une contraction de la famille. Ces rapports privilégiés ne peuvent pas être entretenus avec tous les membres de la famille « élargie ». Donc recentrage sur la famille « nucléaire ». Ce recentrage entraîne aussi une contraction, les familles sont moins nombreuses, elles font moins d’enfants. On personnalise les relations et on les concentre sur quelques enfants. Durkheim explique une deuxième chose, cette « loi de contraction » a des explications également historiques. Il explique que le milieu social de chaque individu s’étend. Son milieu social ne se limite pas à la famille. L’individualisation entraîne la construction de rapports privés, propres à chaque individu qui compose la famille (chacun a ses amis par exemple). Durkheim explique que la famille est moins communautaire qu’auparavant, les individus sont plus autonomes et indépendants, ils jouissent d’une plus grande liberté. Ainsi au sein de la famille les individus ne sont plus soumis comme autrefois (modèle patriarcal), chacun occupe une place qui lui est propre.! Pensez à ce que je vous disais en introduction, lorsqu’on parle de crise de la famille ou qu’on entend dire que la famille est en miettes... Eh bien ici nous avons une toute autre explication. La famille a changé... Pensez aussi aux émissions de télé-réalité sur les relations parents/enfants qui nous inondent nos écrans. Souvent elles mettent en avant une plus grande liberté, autonomie des individus. Que veut l’enfant ? Il faut l’écouter et par exemple le faire participer à une décision d’achat, etc. - La famille contemporaine est privée/publique! Toujours Durkheim. Durkheim dit que la famille contemporaine est à la fois plus privée et plus publique. Plus privée nous l’avons vu avec la centration sur les personnes, « repli » sur le cercle domestique. Plus grande indépendance vis-à-vis de la parenté et du voisinage mais désormais plus grande dépendance par rapport à l’État. Cette vie privée est contrôlée par l’État, par les instances sociales. Dès la fin du XIXe S., pour limiter le droit de correction paternelle, des règles juridiques ont été édictées. Le pouvoir du père est désormais encadré et limité par l’État. Autre exemple plus récent, la création en 2002, d’une haute autorité indépendante en France, « Le Défenseur des droits des enfants ». Tout enfant peut dénoncer à un représentant de l’État de mauvais traitements. 3
Chapitre 2
Introduction Sociologie
Pour conclure et pour nuancer, on peut dire que ces changements au sein de la famille ont été ralentis, du moins on a voulu les ralentir. Ces évolutions ont fait peur.! Fin XIXe et début XXe les politiques ont mis en avant le mariage, ont rendu illégale la contraception. De plus la forte division du travail entre les hommes et les femmes a limité, comme l’explique François de Singly, « une trop grande émancipation de la famille ». Après ces explications historiques sur les bouleversements qu’a connu la famille ces derniers siècles et une définition de la famille contemporaine, étudions de plus près ces changements. Dans cette deuxième partie intitulée « Sociologie du couple : de la rencontre au mariage », commençons par le début de la formation d’une famille, c’est-à-dire le couple et plus précisément le choix du conjoint. II- Sociologie du couple : de la rencontre au mariage A. Le choix du conjoint A l’origine de la formation d’une famille, il y a le choix du conjoint. Avez-vous déjà réfléchi à cette question ? Comment s’opère le choix du conjoint ? Est-il libre ?! Certes, on peut déjà dire qu’il est beaucoup plus libre qu’autrefois où régnaient les mariages « arrangés » par les familles, stratégies pour la transmission et l’enrichissement du patrimoine. Épouser le meilleur parti. Aujourd’hui les individus sont libres, la famille n’intervient pas ou très peu dans le choix du conjoint, quoi qu’il en soit, l’avis de la famille peut être facilement contourné. Mais pour autant, le choix du conjoint est-il totalement libre ? Est-il débarrassé de toutes contraintes ? 1- Construction du couple En 1959, l’INED (Institut National des Études Démographiques) dans le cadre d’une enquête dirigée par Alain Girard répond à cette question. Les résultats se résument essentiellement en deux phrases :
- « n’importe qui n’épouse pas n’importe qui » - « qui se ressemble s’assemble ». Cette enquête révèle que l’homogamie dans la formation des couples est très forte. ! Qu’est-ce que l’homogamie ? ! C’est le fait d’épouser quelqu’un qui vous ressemble. Il peut y avoir différentes sortes d’homogamie: • Homogamie socioprofessionnelle, religieuse, géographique, culturelle. On parle d’endogamie, c’est-à-dire que l’on choisit son partenaire à l’intérieur d’un groupe (social, religieux, professionnel).
4
Chapitre 2
Introduction Sociologie
• homogamie géographique :! = en 1959, 9 couples sur 10 habitaient quand ils se sont connus le même département ou la même région, et parmi eux, 6 sur 10 habitaient la même ville. Aujourd’hui l’homogamie géographique a diminué avec l’accroissement de la mobilité des individus notamment pour le travail, les études, les vacances, etc. ; cela dit elle reste relativement forte. On peut rajouter que l’homogamie géographique varie en fonction du milieu social, on a plus tendance à trouver un conjoint éloigné géographiquement lorsqu’on est cadre supérieur ou profession intermédiaire que lorsqu’on est commerçant ou agriculteur. Cela dépend de la mobilité sociale de la catégorie à laquelle on appartient. • l’homogamie religieuse : elle est également forte mais la France étant un pays majoritairement catholique il est difficile de conclure sur ce sujet. • l’homogamie sociale : = l’enquête menée en 1959 par Girard révèle que 70 % des couples appartiennent à un même milieu ou à un milieu social très proche. Dans cette enquête Girard croise la profession du père de la femme et la profession du père de l’homme. 45 % des individus se trouvent en position homogamique, sur la diagonale. En plus 24 % des couples ne se sont séparés que par un seul intervalle et appartienne à la classe sociale voisine. Donc au total c’est presque 70 %.! En 1959, concernant le niveau d’étude des conjoints, c’est le même constat qui est fait, 60 % des conjoints ont un niveau d’étude identique et 83 % des niveaux d’étude voisins. Dans les autres couples, c’est plutôt le mari qui a un niveau d’études supérieur (21% contre 13%). Pour reprendre l’expression de Michel Bozon et François Héran : « la foudre, quand elle tombe, ne tombe pas n’importe où : elle frappe avec prédilection la diagonale ». Claude Thélot met en évidence dans ces travaux que l’homogamie est particulièrement forte aux deux extrémités de l’échelle sociale notamment chez les cadres supérieurs et les ouvriers.
5
Chapitre 2
Introduction Sociologie
Document n°1 : Exemple résultats d’enquête de l’INED en 1984 sur l’origine sociale des conjoints dans les couples français âgés de moins de 45 ans (mariés ou non) (Vous étudierez ces données en TD.)
Une enquête de 2011 réalisée par le sociologue Milan Bouchet-Valat nous permet d’avoir des chiffres plus récents et de faire une comparaison avec les données de 1959 et de 1984.
6
Chapitre 2
Introduction Sociologie
Document n°2 : Tables d’homogamie PCS 1982 (Milan Bouchet-Valat)
Document n°3 : Tables d’homogamie PCS 2011 (Milan Bouchet-Valat)
7
Chapitre 2
Introduction Sociologie
Aujourd’hui un peu moins d’1/3 des couples sont homogames, cela dit ces données sont à interpréter avec précaution. Si on élargit à la CSP voisine c’est 2/3 des couples qui sont homogames. Néanmoins on a une diminution de l’homogamie socioprofessionnelle sur la longue durée. (40 % environ en 1959, aujourd’hui un peu moins de 30%, attention ces chiffres concernent la même CSP). Peut-on pour autant parler d’une baisse de l’homogamie ?! A vrai dire non, cette diminution n’est pas liée à une plus faible propension à épouser quelqu’un qui nous ressemble. Cela s’explique par une modification de la structure professionnelle depuis les années 50. On peut prendre l’exemple de l’agriculture. On observe une très nette diminution du nombre d’emplois dans l’agriculture. Si on se réfère à notre tableau sur la répartition des couples selon la CSP en 1982, 82 % d’hommes agriculteurs ont une femme agricultrice, en 2011 seulement 33 % d’hommes agriculteur ont une femme agricultrice. Désormais une très grande part des femmes d’agriculteurs sont employées. Ces données nous montrent qu’il n’y a pas une diminution importante de l’homogamie socioprofessionnelle mais qu’en raison de la disparition d’un certain nombre d’emplois dans le monde agricole, les conjointes d’exploitants ont été contraintes d’exercer une autre activité (cf. documents 2 & 3). Document n°4 : Etude 2006 homogamie des couples, évolution de l’homogamie des années 1930 aux années 2000
Néanmoins, comme nous pouvons le voir, toutes les unions ne sont pas homogamiques. Il ne faut pas dire que les individus sont prisonniers et qu’ils n’ont pas de marge de manœuvre. Chaque 8
Chapitre 2
Introduction Sociologie
individu a une marge de manœuvre, les individus sont plus ou moins proches de la règle homogamique. Ces chiffres peuvent nous paraître étonnants.! Aujourd’hui les individus sont très libres dans le choix du conjoint, si on ajoute à cela la mobilité sociale, l’allongement de la durée des études on pourrait s’attendre à ce que la mobilité sociale soit plus forte. Ces facteurs devraient engendrés plus d’hétérogamie. Alors comment peut-on expliquer cela ? Cela est dû essentiellement aux conditions concrètes des rencontres. 2- L’espace social des rencontres Pour expliquer la forte homogamie que l’on constate encore aujourd’hui dans la formation des couples, il faut s’intéresser à l’espace social des rencontres. Comment la première rencontre s’estelle produite ? Où rencontre-t-on son conjoint ? Des études successives réalisées en 1959, 1984 et 2006 nous permettent de dresser un tableau de l’évolution des lieux de rencontres. Document n° 5 : Le choix du conjoint, les lieux de rencontres 1959, 1983-1984.
9
Chapitre 2
Introduction Sociologie
Document n°6 : Evolution des lieux de rencontres de 1914 à 1984
10
Chapitre 2
Introduction Sociologie
Document n° 7 : Les lieux de rencontres en 2013
11
Chapitre 2
Introduction Sociologie
Depuis un demi-siècle les lieux de rencontres ont changé, ils se sont élargis. Globalement, quel constat ? - Aujourd’hui on se rencontre moins qu’avant dans le cadre du voisinage. Dans les années 20 ce type de rencontre représentait 1 mariage sur 5, aujourd’hui ce mode a quasiment disparu. On peut expliquer ce phénomène par le déclin du monde rural, le desserrement de l’interconnaissance villageoise et à son remplacement en ville par des relations plus anonymes. On peut rajouter à cela le refus de rencontres qui se dérouleraient sous le regard de la communauté. - Autre changement, le déclin du bal. Dans les années 60, 1 couple sur 5 s’est rencontré au bal. Sur la longue durée, le bal est l’institution marieuse par excellence. Petit à petit, le bal a changé de public, c’est un lieu de rencontres spécifiquement rural aujourd’hui et plus souvent fréquenté par les aînés. Les boîtes de nuit ont pris le relai du bal. La danse continue à faire se rencontrer un couple sur quatre. Pourquoi ? Car rien n’est plus facile d’aborder une autre personne à ce moment-là. La danse libère les individus d’avoir à inventer des formules d’approche à chaque tentative. Cela dit les rencontres dans les boîtes de nuit ont diminué. - On rencontre son conjoint beaucoup plus dans les lieux publics (la rue, la cité, le centre commercial, l’hôpital, le café).! ! - On le rencontre aussi lors de visites ou de repas chez les amis ou des parents mais la rencontre est moins «arrangée» qu’autrefois (soirées). - Les rencontres sur le lieu de travail sont restées globalement stables, celles faites lors des études ont augmenté.! ! - On peut s’étonner de la faible part des rencontres via les annonces et agences matrimoniales. - Néanmoins la part des rencontres sur des sites de rencontres (exemple Tinder ou autres) augmente depuis quelques années, c’est ce que met en évidence le travail de la sociologue Marie Bergström (cf documents 8, 9 et 10 ainsi que l’article en ligne dans l’espace de cours).
Document n°8 :
12
Chapitre 2
Introduction Sociologie
Document n°9 :
Document n°10 :
13
Chapitre 2
Introduction Sociologie
En complément de cette étude, je vous invite à lire l’article « Sites de rencontres : qui les utilise en France ? Qui y trouve son conjoint ? » publié dans la revue Population et société de l’INED, février 2016, numéro 530. L’article présente les travaux de la sociologue Marie Bergström sur les sites de rencontres (en ligne dans l’espace de cours sur l’ENT). Conclusion Sur la durée on peut observer que la rencontre s’effectue beaucoup moins sur le regard de la famille et de la communauté mais plus sous le regard électif des groupes de pairs. C’est ce qu’i...
Similar Free PDFs
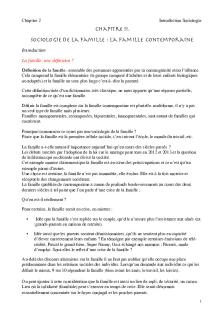
Sociologie de la famille
- 30 Pages

Sociologie de la famille
- 11 Pages

droit de la famille
- 7 Pages

Sociologie de la modernité
- 29 Pages

Sociologie DE LA Musique
- 9 Pages

Domaines de la sociologie
- 45 Pages

Sociologie DE LA Deviance
- 18 Pages

Sociologie de la culture
- 40 Pages

Droit de la famille complet
- 56 Pages

Synthèse droit de la famille
- 222 Pages

Droit de la famille (extrait
- 7 Pages

Cours droit de la famille
- 84 Pages

La famille grecque
- 1 Pages

Devoir sociologie de la santé
- 3 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu

