Sociologie de la culture PDF

| Title | Sociologie de la culture |
|---|---|
| Course | Sociologie |
| Institution | SKEMA Business School |
| Pages | 40 |
| File Size | 1.1 MB |
| File Type | |
| Total Downloads | 80 |
| Total Views | 163 |
Summary
This course was made by a teacher of Skema Business School in the 2020/2021 academic year. It contains the full course and tips given by the teacher during the face to face course in SKEMA BUSINESS SCHOOL. You will find some examples in order to help you memorize the course and understand it in an e...
Description
Sociologie de la culture 3 grandes parties : - Histoire de la sociologie de la culture - Sources d’information et méthodes de la sociologie de la culture - Les résultats d’enquêtes Approche sociologique dans le milieu culturel rencontre des résistances : - Refus de principe ( culture où le chiffre n’a pas de sens) - Refus du marketing (‘la logique de l’audimat’) Il y a assez peu de gens spécialisés dans la sociologie de la culture mais il existe tout de même un CNR de la sociologie de la culture et de l’art. Il existe également en France des centres d’études et d’évaluation qui réalisent des études sur la fréquentation des sites Internet culturels. Ils essayent notamment de voir comment les gens réagissent face à des expos. (cf. La Villette) La fête de la musique a été créée en 1982 et a été très liée à une enquête de 1981 qui rendait compte que beaucoup de français jouent d’un instrument de musique. La sociologie est éclatée en plusieurs domaines : - Tradition universitaire qui est très théorique : ‘sociologie professionnelle de métier’. - Sociologie par les comportements - Sociologie par les hommes Autre fait, la culture est extrêmement sectorialisée en France : Théâtre, musique, musées, monument, archives… Mais la culture reste un objet difficilement identifiable. PRESENTATION GENERALE I- RAPPEL DES DIFFERENTES CONCEPTIONS DE LA CULTURE
Deux Américains ont comptabilisé 160 définitions. La définition française correspond à la conception universaliste et évolutionniste ( Histoire) des lumières qui opposaient nature et culture. Définition : ensemble des activités et des connaissances de l’homme cultivé. La conception des philosophes allemands du XVIII correspond aujourd’hui à l’idée de civilisation. Ils ont développé la conception de ‘génie national’. C’est ainsi que l’on parle de culture allemande, de culture française. Dans la culture entendue au sens de civilisation, il s'agit de toutes les manières de vivre. Ainsi se pose le problème de culture locale / culture générale. La conception défendue par les anthropologues et les ethnologues (cf. Lévi-strauss) est de montrer que les hommes dans les sociétés primitives avaient une culture et un ensemble de mœurs et de techniques que l’on devait analyser sans hiérarchie. On parle de relativisme culturel : en effet, on ne doit pas avoir un système de hiérarchie mais au contraire étudier chaque culture qui est aussi digne d’intérêt. Ce sont ensuite des Sociologues, tel que Bourdieu, qui ont appliqué ce projet : Il n’y a pas une culture mais des cultures dans la société française. La conception de la culture de masse (cf. Edgar Morin)
Au-delà des différentes cultures, il y aurait une culture globale, planétaire. La culture de masse contribue à transformer les cultures populaires. On peut donc faire des études qui relèvent de choses différentes.
Genres mineurs
LOISIRS
BEAUX-ARTS
ECONOMIE
Médias et communication
Genres mineurs : En littérature, dans les années 60, on s’intéressait à la poésie ou au roman. Aujourd'hui, on assiste à un élargissement des genres : le roman policier est désormais considéré comme partie intégrante du genre romanesque. Initialement, lorsque l'on parlait de musique, on sous-entendait uniquement la grande musique mais aujourd’hui, les différentes formes de musique sont légitimées. ( Jazz à une certaine époque. Loisirs : sports, pétanque… Economie : idée, dans les années 80, que même les secteurs économiques avaient besoin de l’esthétique (pub, mode, design…. La question de l’esthétique est présente et déterminante dans la réussite ou l’échec d’un produit. (Cf. en ce qui concerne les voitures, le consommateur se base sur l’esthétique ; le Renault espace donne une image de famille. Avec sa forme arrondie, elle symbolise le cercle de la vie..)
La vraie question qui se pose en réalité est que certains sociologues s’intéressent à l’art. BOURDIEU ne s’est pas intéressé en tant que tel à la culture mais au lien symbolique qu’elle représente. Une sociologue a travaillé sur les résistances à l’art contemporain : la question était de savoir au nom de quoi les gens rejettent certaines formes d’art : à cause de l’éthique, de la morale, de la religion ou encore pour des raisons financières ? … Bibliographie : ‘la distinction’ de Pierre Bourdieu, édition Minuit (1979) ‘Question de sociologie’ de Bourdieu ‘L’amour de l’art’ de Bourdieu ( 1964) ‘Le raisonnement sociologique’ de Passeron, éditions Nathan. (1990) ‘Les mondes de l’art’ de Howard Becker, édition Flammarion.
La notion de culture pour PASSERON Passeron distingue trois éléments dans la culture : - La culture comme style de vie - La culture comme comportement déclaratif
-
= normes sociales, discours que l’on tient sur les valeurs. La culture comme un corpus d’œuvres valorisées. = toute société isole un certain nombre d’objets dans lesquels sont investis un certain nombre d’objets.
Ainsi, chaque groupe humain se spécifie par l’articulation de ces trois conceptions de la culture. La notion de culture pour BECKER ‘Les mondes de l’art’ = ensemble des personnes qui contribuent à la production des œuvres et à la croyance en la valeur de ces œuvres. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas les œuvres que des spécialistes ou critiques ont légitimé. La notion clé chez Becker est celle de Convention : il s’agit de ‘toutes les valeurs ou représentations que des agents partagent et qui permet des économies d’argent, d’énergie et de temps’. Ex : A l’extérieur du monde de la musique, il y a différents petits mondes qui ont leurs propres conventions : Les amateurs de hard rock vont se distinguer dans leur style vestimentaire par rapport aux gens qui vont plus à des concerts de classique. C’est une manière de devenir autonome par rapport aux autres genres. La conception de la culture pour BOURDIEU Deux idées essentielles pour Bourdieu : - Champ - Habitus L’homme montre tout ce que la production d’un génie à un moment donné a à voir avec une société à un moment donné. Le mouvement esthétique est en général parallèle aux contraintes techniques et esthétiques de l’époque. Tout artiste intériorise la condition de diffusion de son œuvre. Toute œuvre peut mener à des réinterprétations. Importance de la croyance en la valeur de l’œuvre (histoire de l’art, critiques…) Champ : ‘c’est un réseau ou une configuration de relations objectives entre des positions.’
II-
Historique de la sociologie de la culture en France A- Les grandes étapes du ministère
1959 : création du ‘ministères des affaires culturelles’. La majorité pensait que cela ne durerait pas + problèmes à mettre en place une administration de la culture. 1970 : création de la direction de la musique et du théâtre qui permet au ministère de prendre de l’importance. 1971 : une idée nouvelle apparaît : celle de la démocratisation avec le concept de l’action culturelle et le principe de la maison de la culture. Apparaît ainsi l’idée de réduire le clivage Province / Paris à travers les ‘cathédrales du XXè siècle’. Mise en place du 6è plan : développement de la culture. 1978 : Ministère de la culture et de la communication.
Avec le développement culturel, on transforme les relations de l’homme avec son milieu. Tout est culturel, les hommes se doivent d’être libres et créatifs. Les années 70’ sont des années hybrides car d’un coté se pose le problème des budgets ; de l’autre, le développement du milieu culturel, de la communication, et de nouveaux équipements ( cf. Beaubourg) 1978-1979 : création du centre Pompidou où tous les secteurs culturels sont développés. L’équipement culturel doit faire différentes propositions culturelles et diverses. 1981 : arrivée de J. Lang on arrive alors à un changement de situation puisque l’on a une double évolution : - Augmentation des budgets venant de l’Etat ET des municipalités ; - Elargissement du champ de compétence du ministère. Aucun ministre de droite ou de gauche n’a jamais remis en question les choix faits et les évolutions du ministère de la culture. A- L’organisation du ministère Il existe un nombre considérable de directions dans le ministère de la culture. Ainsi on parle de Segmentation et de sectorialisation de ce ministère. C. Trautman a décidé qu’il y avait trop de politiques sectorielles. Aujourd’hui, nouvelle organisation : 6 Directions sectorielles : -
Direction du spectacle vivant (DMDTS) (théâtre, musique, spectacle, danse, arts émergents du cirque et de la rue)
-
Direction de l’architecture et du patrimoine (DAPA)
-
Direction des musées de France (DMF)
-
Direction des archives
-
Direction du livre et de la lecture
-
Délégation aux arts plastiques (art contemporain) (DAP).
2 Directions transversales : -
Direction de l’administration générale (DAG)
-
Direction au développement de l’action territoriale (DDAT)
→ La situation actuelle de la structure de la distribution des différentes espèces de Pouvoir est la suivante : On observe un jeu d’interaction entre les différents acteurs de différents mondes. Ainsi, le phénomène de Boys Band a suscité beaucoup d’intérêt, lorsque l’un des groupes s’est disloqué, le réflexe a été pour d’autres groupes de prendre la place libre. C’est la position d’autres acteurs par rapport à la position d’un premier intervenant. En politique, par exemple, un homme politique énonce le premier qu’il est pour l’environnement, alors la réaction des autres politiques va être de se positionner par rapport à lui (soit pour, soit contre l’environnement.) On peut appeler cet ensemble de positionnement par le terme de champ. Ce champ est structuré par des systèmes d’oppositions que l’analyse sociologique peut identifier.
Il est possible de faire une analogie d’un jeu au casino. Il y a une logique propre au champ. Dans le domaine de la musique, l’idée principale est le désintéressement total. Dans le domaine économique, ce qui est essentiel, c’est l’intérêt. Pour faire partie du champ, il faut CROIRE que c’est important. La comparaison avec le casino intervient dans le fait que : les joueurs ont des jetons qui sont des atouts en eux-mêmes. L’un des atouts principal dans notre société sera d’avoir des diplômes ; dans d’autres sociétés ce sera, par exemple, de posséder le force physique. Les joueurs qui ont le moins de jetons et qui ont le moins de chance de gagner sont ceux qui ont le plus envie de changer les règles du jeu. B- Les grandes avancées du coté des chercheurs Années 60 : spécialiste de la sociologie des loisirs : J.Dumazedier. Il est le premier à signaler que notre société est de plus en plus une société de loisirs et qui prend du recule par rapport au travail. 1962 : Dumazedier écrit ‘vers une civilisation des loisirs’. 1964 : ‘L’amour de l’art’ par Bourdieu Première enquête du public sur la fréquentation des musées. 1960 : Premier sondage sur l’art et la consommation culturelle. 1967 : INSEE réalise la première enquête sur les loisirs des français. 1973 : première enquête sur la pratique culturelle des français.
La sociologie de l’art et de la culture des années 60 tourne autour de 4 pôles : -
-
relation art /société réflexion sur la société des loisirs (Militants d’éducation populaire : peuple et culture. Démarche sociologique mais avant tout militante) Sociologie critique Débat autour de la culture de masse (cf. Edgar Morin ‘les stars’ et ‘l’esprit du temps’1964)
Bibliographie ‘Les politiques publiques de la culture en France’ de Moulinier, ed. Que sais-je ? ‘L’invention de la politique culturelle’ de Urfalino, documentation française ‘La culture en action : Jean Villard à Jack Lang’ de Caune. ‘L’Etat culturel : essai sur une religion moderne’ de Fumarolli. ‘Le gouvernement de la culture’ de Maryvonne de Saint Pulgent Les quatre pôles ont réussi à cohabiter ensemble : idée de développement culturel qui, au début des années 70, marque une entrée dans une nouvelle ère liée à l’influence de la pensée de Bourdieu : - Joffre Dumazedier est resté isolé - Edgar Morin a changé de terrain en laissant de coté la culture - Les statistiques se sont développées avec les problématiques de Bourdieu Ex : publication de ‘la réflexion’ : cadre de références globales pour expliquer les comportements culturels. III- LA PENSEE DE BOURDIEU
a- La conception de Bourdieu Bourdieu conçoit la sociologie comme une démarche doublement critique. Le rôle de la sociologie est de ‘jouer le barbare’, en ce sens qu’elle doit nier toute valeur intrinsèque à l’art en mettant en évidence les déterminants sociaux de la croyance en cette valeur. Il n’existe pas de disparités naturelles d’intelligence ou de sensibilité mais des disparités sociales face à la culture. Bourdieu a construit le concept d’Habitus qui se défini comme l’ensemble des dispositions incorporé dans un corps et un esprit qui assure la cohérence de nos styles de vie. Ainsi à trois grandes classes sociales correspondent trois grands types d’individus : -
Les classes dominantes Les classes moyennes Les classes populaires
Les classes dominantes sont les privilégiées de la culture, culture qui est l’occasion pour eux de se distinguer des autres. Ex : Opéra. Pour les classes moyennes, c’est la ‘bonne volonté culturelle’ qui les porte à tenter d’imiter les classes dominantes sans vraiment leur permettre de s’identifier à elles. Les classes populaires sont définies par ‘les contraintes de la nécessité’. Elles manifestent pour l’art une reconnaissance sans connaissance : le conformisme des goûts le tient à l’écart. C’est donc l’idée, ici, qu’il existe un système de classement qui correspond entre la hiérarchie sociale et la hiérarchie des arts et des éléments culturels. Comment hiérarchiser les différentes catégories de population ? Bourdieu utilise la notion de Capital : Les groupes sociaux sont définis à partir du capital économique, culturel (ex : niveau de diplôme), social (ensemble des réseaux dont on dispose). Le capital social est déterminant pour la recherche d’un emploi. L’espace social est défini à partir de trois critères : - Niveau global de revenu global du capital - Structure du capital - Ancienneté de la position sociale que l’on occupe. Contrairement à ce que l’on pense, c’est le capital culturel qui est le plus important. D’avoir été familiarisé dès son enfance avec la culture est un facteur essentiel pour comprendre l’évolution d’un individu. Ce qui est central chez Bourdieu, c’est que le capital culturel se construit à l’école. Le plus important est alors le niveau de diplômes obtenu. b- La critique adressée à Bourdieu Des reproches ont néanmoins été faits à Bourdieu sur cet aspect de caractère déterministe des activités des différentes classes sociales. La critique apparaît à partir des années 80 : - Conception de la sociologie critique Le sociologue n’a pas besoin de toujours dénoncer les illusions des gens : ce que pensent d’autres sociologues. - Conception de la sociologie en trois classes - Vision binaire du social (sociologie de la domination) Les dominants imposent leur domination et les dominés acceptent d’être dominés.
En réalité, il s’agit d’une hétérogénéité. Le problème est que dans les classes moyennes, certains montent dans l’échelle sociale par rapport à leurs parents, alors que pour d’autres, c’est le contraire. -
N’y a-t-il pas un caractère tautologique dans ce que dit Bourdieu ? La culture populaire est-elle populaire parce qu’elle est issue et pratiquée par les milieux populaires ou bien est-elle populaire en elle-même ?
Depuis 20 ou 30 ans, les itinéraires des gens se sont complexifiés. Dans les années 60, deux grands schémas : - Reproduction - Mobilité ascendante grâce à l’école. Aujourd’hui, beaucoup de gens atteignent un niveau scolaire supérieur à celui de leurs parents. Mais avec le chômage, ces gens peuvent se retrouver dans des positions sociales inférieures à ce qu’elles méritent. La critique faite à Bourdieu par Passeron se trouve dans ‘Le savant et le populaire’. Les outils que Bourdieu met en places sont utiles pour étudier les classes dominantes mais pas les classes populaires. Passeron appelle cela le légitimisme, c’est à dire adopter le point de vue de la culture le plus légitime et sous-estimer les autres formes de la culture. Mais, il existe également l’effet inverse, qui se traduit par le relativisme culturel, c’est le populisme : c’est tout considérer comme de la culture. Cette critique touche en fait Dumazedier. Il faut essayer d’articuler ces deux approches et regarder avec les mêmes outils les pratiques les plus légitimes et les plus populaires. D’autres part, il faut prêter attention à ce que l’on appelle ‘les pactes de la réception de la culture’ : connaissances et codes qui vont permettre de déchiffrer une œuvre d’art par exemple. Les classes dirigeantes maîtrisent les codes, les classes moyennes essayent mais n’y arrivent pas et les populaires ne les connaissent pas. Passeron dit qu’il ne faut pas négliger ce manque de connaissances. Il faut analyser le comportement des classes populaires dans un milieu culturel même si les codes auxquels ils se réfèrent sont différents.
‘ce que l’art fait à la sociologie’ de Nathalie Heinich ‘l’homme pluriel’ de Lahire ‘Economie de la culture’ de Benamou, repère la découverte. Critique de la notion d’habitus : c’est une sorte de boite noire dont on ne sait pas grand chose. Pour Lahire, les modes de socialisation sont de plus en plus complexes et peuvent correspondre à des contextes contradictoires : Ex : - Les valeurs de la famille - Les valeurs de l’école } peuvent être différentes - Les valeurs du groupe des pairs Ce n’est plus simplement un système d’opposition très simple. Lahire propose de raisonner différemment, il ne faut non pas raisonner au niveau macro-social mais au niveau de l’individu = sous forme d’entretien, etc… Il faut donc prendre en compte le multilatéralisme. Pour analyser le rapport de l’individu à la culture, il faut étudier tous les aspects de la vie. Ex : rupture entre le comportement qu’un individu peut avoir au travail et dans sa famille
Bourdieu oublie le contexte et les différentes interactions qui agissent. Ex : Quelles personnes donnent à des SDF ? Cela dépend du contexte et de la manière dont cela se passe. Les éléments extérieurs jouent un rôle important parfois plus que les valeurs personnelles. Pour Lahire, il ne faut pas analyser comportements en dehors d’une situation réelle. Ex : Lorsqu l’on va voir un spectacle, différents éléments peuvent jouer : - Les personnes avec qui l’on y va - L’entourage - Le lieu - Lorsque l'on a travaillé toute la journée. Boltanski formule une autre critique : il ne faut pas attacher d’importance aux discours des individus et au sens qu’ils donnent à leur pratiques. Heinich dit qu’il faut prendre en compte la singularité et l’idée de génie. Le sociologue n’a pas à s’intéresser aux œuvres elles-mêmes mais au discours que tiennent les gens sur ces œuvres. Avant, il y avait donc un ensemble de corrélations entre culture et société ; aujourd’hui, il s’agit plus d’un triangle avec :
Œuvres (projetées)
Contextes (socio de la réception) Individus (multidéterminisme) La sociologie est donc plus modeste. Elle cherche à traduire la complexité des individus. De plus, elle est moins réductionniste que l’était la théorie de Bourdieu. Bourdieu parle de ‘lois’ pour qualifier les corrélations entre société et culture. Lahire répond à cela que l’on ne peut pas parler de lois car il n’existe pas de faits sociaux uniques et généraux. La diversité ainsi que la complexité sont à prendre en compte. Ex : en étant célibataire, on peut se détacher des modèles familiaux traditionnels tandis qu’au moment du mariage ou de la naissance d’un enfant, on les reproduira. Cela peut être totalement inconsciemment. ‘On peut dire que nous sommes trop multisocialisés et trop multidéterminés pour nous rendre compte de nos déterminismes.’ Lahire. CHAPITRE I : ETUDES DE PUBLIC ET POLITIQUE CULTURELLE : LA QUE...
Similar Free PDFs

Sociologie de la culture
- 40 Pages

Sociologie de la modernité
- 29 Pages

Sociologie DE LA Musique
- 9 Pages
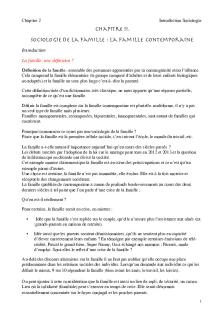
Sociologie de la famille
- 30 Pages

Sociologie de la famille
- 11 Pages

Domaines de la sociologie
- 45 Pages

Sociologie DE LA Deviance
- 18 Pages

Devoir sociologie de la santé
- 3 Pages

CM Histoire de la Sociologie
- 32 Pages

Pourquoi faire de la sociologie
- 12 Pages

CM Sociologie de la déviance
- 25 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu




