Ddddddddd - Sociologie de la culture PDF

| Title | Ddddddddd - Sociologie de la culture |
|---|---|
| Course | Sociologie de la culture |
| Institution | Université Grenoble-Alpes |
| Pages | 4 |
| File Size | 152.8 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 31 |
| Total Views | 142 |
Summary
Sociologie de la culture...
Description
Sociologie de la culture Cours 1 1. La notion de culture En guise d’introduction - La notion de culture est inhérente à la réflexion des sciences sociales : Penser l'unité de l'humanité dans la diversité autrement qu'en termes biologiques. - Culture : un concept polymorphe. J-.C. Passeron, « Les mots de la sociologie », Le Raisonnement sociologique, Paris, Nathan, 1991. Elle se dit POLYPHORME car les formes qu’elle prend sont déversent et multiples. - Culture : une inflation d’usages : . De ce fait on peut retrouver différentes formes de culture : culture d’entreprise, culture gay, culture de l’excuse…
Evolution sémantique du mot culture • Moyen-âge : « Culture » vient de cultura, en latin : le soin apporté aux champs et au bétail. • 16e siècle : sens figuré culture d’une faculté, travailler à développer cette faculté (chant, mathématiques) Au moyen âge le mot culture désigne une parcelle de terre qui est cultivé, au XVIème siècle le mot prend le sens d’une action, il prend un sens figuré de travailler pour développer une capacité (mathématique, science...). • Au cours du 18e siècle : synonyme de savoirs accumulés, de progrès… Au 18ème siècle désigne le travail du savoir, développé une faculté ou des connaissances, (utilisation métaphorique). • Fin 18e : les penseurs des Lumières opposent « nature » et « culture ». La culture est ce qui distingue de l’animal, c’est la somme des savoirs accumulés et transmis par l’homme. Fin 18ème siècle, les philosophes des lumières opposent le mot « nature » à celui de la « culture ». Pour eux, c’est la culture qui nous distingue des animaux : c’est la somme des savoir qui va donner la nature humaine. • Au 19e siècle : « culture » est utilisé au singulier dans la perspective universaliste des Lumières. La culture est le propre de l’Homme au-delà des distinctions de classes. Elle est associée à l’idée de progrès, d’évolution, d’éducation, de raison. • Au cours du 19e siècle : développement de la sociologie et de l’anthropologie. Le mot « culture » est utilisé pour penser la société, les sociétés et l’homme. 19ème siècle, la culture est utilisée au singulier dans la perceptive universaliste. La culture est le propre de l’homme au-delà des distinctions de classe sociale. Elle va aussi être synonyme d’évolution et donc avec le développer de anthropologie et de la sociologie. Ces derniers vont observer les sociétés éloignés et vont utiliser le mot culture pour décrire ses sociétés. On comprend que ce mot a une histoire selon les périodes il a différents usages. La notion de culture : Définitions et idées fortes
Définition : “Culture ou civilisation, prise dans son sens ethnologique le plus étendu, est ce tout complexe qui comprend la connaissance, les croyances, l'art, la morale, le droit, les coutumes et les autres capacités ou habitudes acquises par l'homme en tant que membre de la société.” (Edward Tylor, Primitive culture, 1871) Une culture : une totalité intégrée, dont toutes les composantes se conditionnent réciproquement (Guy Rocher). Idées fortes : La culture permet de penser la société à partir de la notion de groupes humains. 1. La culture s'adresse à toute activité humaine : (manière de penser, sentir, agir...) on arrive à identifier ses caractéristique à partir de l’observation. 2. Il s'agit d'un phénomène collectif : partager par une pluralité de personnes qui vont y soumettre, ce groupe peut être réduit, cela veut dire que les façons de faire sont accepter par tous. 3. Elle est inscrite dans la transmission : transmission, la culture est du domaine de l’apprentissage, de l'incorporation et de la répétition, rien n’est innée rien n’est acquis à la naissance mais tous est acquis par la socialisation. 4. Les manières d’agir, de penser sont formalisées : Chaque culture se soumet à des lois, des cérémonies à des coutumes. 5) activité symboliques : très importante ses manières de penser, d’agir sont des éléments qui permettent la communication, toutes activité culturelle sont des productions de significations et nous sommes dans un jeu d’interaction qui relevant d’une signification symbolique car ce sont des éléments qui symbolisent votre appartenance d’un individu à un groupe. 6. Elle est caractérisée par une cohérence interne : on peut approcher la culture d’un pays par la lois. 7. Elle constitue un « dedans » par rapport à un « dehors » : on appartient à une culture qui est toujours en opposition à une autre culture, la culture sert à marquer les limites symbolique (moi et les autres) , cela marque les limites matériels et symbolique qui nous aide à nous distinguer et se différencier des autres. La culture comme phénomène proprement humain ? Reconnaissance des cultures animales à la 11e conférence de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, traité international, sous l'égide de l'ONU, auquel la France a adhéré en 1990.
.Culture, Kultur, Civilisation • « Kultur » apparaît en allemand au sens figuré au 18e siècle. • Kultur : Les bourgeois allemands l’utilisent pour s’opposer à l’aristocratie de cours. • Kultur et Civilisation : « Tout ce qui relève de l'authentique et qui contribue à l'enrichissement intellectuel et spirituel sera considéré comme relevant de la culture ; au contraire, ce qui n'est qu'apparence brillante, légèreté, raffinement de surface, appartient à la civilisation. (D. Cuche). • A partir du XIXème siècle, la notion allemande de Kultur va tendre de plus en plus à des revendications identitaires. Elle se lie de plus en plus au concept de « nation ». • Au XXème siècle, pour se démarquer des allemands qui parlent de Culture dans un sens nationaliste les français préfèrent le terme de civilisation.
La Civilisation des mœurs, Norbert Elias Norbert Elias : éléments biographiques - Né en 1897 en Allemagne. Décédé en 1990 aux Pays-Bas. - A étudié la médecine, la philosophie, puis de psychologie et finalement de sociologie. - Soutient une thèse de doctorat sous la direction d’Alfred Weber, (frère de Max). - Assistant de Karl Mannheim (Ecole de Francfort). - A vécu en Allemagne, en France, en Angleterre, aux Pays-Bas et au Ghana. La civilisation à laquelle s’intéresse Nobert Elias n’est pas un fait mais plus un processus. Il envisage cela en termes de processus de dynamique, c’est une approche historique socio historique. Le processus de civilisation consiste en une modification de la sensibilité, et du comportement humain dans un sens bien déterminé. Qu’est-ce qu’il entend par civilisation ? C’est toute les nouvelles façon de se tenir (manières de table, les façons d’échanger... ) « La Civilisation des mœurs » retrace et analyse l’évolution des pratiques sociales dans la civilisation occidentale depuis la Renaissance. Les manières de gérer les fonctions corporelles comme objet d’investigation sociologique : se moucher, cracher, uriner, déféquer mais aussi les manières de table, l’intimité… Le processus de civilisation implique une mise à distance des corps : Manière de tables, Fonction corporelles, Sphère de la pudeur. Comment expliquer une évolution aussi importante ? - Des manières « civilisées » transmises par l’aristocratie de cour. - Disparition d’une chevalerie féodale violente et rapprochement avec la cour. - Le royaume se met en place grâce à la loi des monopoles (fiscalité, violence, justice) Critiques de l’ouvrage : un ouvrage teinté d’évolutionnisme et d’ethnocentrisme.
Civilisation « Civilisation » : un terme controversé : jugement de valeur implicite, ethnocentrisme larvé. Certains sociologues et anthropologues contemporains distinguent : - Civilisation : ensemble de cultures particulières ayant entre elles des affinités ou des origines communes (civilisation occidentale). - Civilisation : sociétés présentant un stade avancé de développement : progrès technique, urbanisation, … La civilisation précolombienne (Maya, Aztèques…).
Le Choc des civilisations (The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order), Samuel Huntington, professeur à Harvard, paru en 1996 et traduit en français en 1997....
Similar Free PDFs

Sociologie de la culture
- 40 Pages

Sociologie de la modernité
- 29 Pages

Sociologie DE LA Musique
- 9 Pages
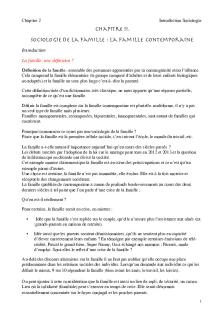
Sociologie de la famille
- 30 Pages

Sociologie de la famille
- 11 Pages

Domaines de la sociologie
- 45 Pages

Sociologie DE LA Deviance
- 18 Pages

Devoir sociologie de la santé
- 3 Pages

CM Histoire de la Sociologie
- 32 Pages

Pourquoi faire de la sociologie
- 12 Pages

CM Sociologie de la déviance
- 25 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu




