De la sociologie du travail à la sociologie de l\'emploi PDF

| Title | De la sociologie du travail à la sociologie de l\'emploi |
|---|---|
| Author | Lila PND |
| Course | Sociologie du travail |
| Institution | Université de Limoges |
| Pages | 10 |
| File Size | 205.1 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 95 |
| Total Views | 154 |
Summary
Download De la sociologie du travail à la sociologie de l'emploi PDF
Description
Chapitre 4 : De la sociologie du travail à la sociologie de l'emploi Les sociologues ont longtemps été concentré sur le monde de l'usine et sur les ouvriers. C'est à partir des années 80 que les sociologues vont rectifier le tir à cause de plusieurs évolutions. 4 grandes évolutions qui vont les amener à élargir leur focale : → le développement d'un chômage de masse lié aux différentes crises économiques → l'accès continue des femmes sur le marché du travail → les questions très vives liées à l'I → les problématiques liées à l'insertion professionnelle des jeunes Ces 4 raisons vont amener les sociologues à penser différemment leur problématique. Finalement ces problématiques vont évoluer et se diversifier. Les sociologues vont travailler sur les modalités d'accès aux emplois, sur les différentes manières de faire carrière sur le marché du travail, les inégalités dans le monde du travail et les effets du chômage sur l'individu. C'est pour cela qu'on ne parle plus de sociologie de travail mais de sociologie de l'emploi. I) Les caractéristiques de l'emploi en France Quelles sont les tendances de l'emploi en France ? Pour répondre à cette question on va voir 2 évolutions : → l'accroissement et la mutation de la population active → l'apparition d'un chômage massive et endémique A) La population active en France 1) Définition et état des lieux La population active représente l'ensemble des individus en âge de travailler, de 15 à 64 ans et disponible pour un emploi. Elle regroupe les personnes ayant un emploi et les chômeurs en recherche d'emploi. En sont exclu les étudiants, les retraités et les personnes au foyer. Elle est estimée à 29,6 millions en 2016. Parmi cette population active, les titulaires d'emplois sont majoritairement des salariés (88% en 2017) et des indépendants. Les catégories socio professionnelles de cette catégorie : les employés sont la catégorie la plus représenté (30% des actifs occupés), les professions intermédiaires (¼ de la population active), les ouvriers (20% des emplois) et les cadres (16 à 17% des emplois). Le groupe ouvrier est toujours le 3ème groupe en France. 2) Les transformations de la population active La principale transformation réside dans la croissance continue en France. Dans les années 60, la population active compté que 20 millions d'individus et maintenant c'est 30 millions. 2 facteurs expliquent cette augmentation : → les facteurs démographiques → l'augmentation de la population française avec 2 facteurs : le solde démographique (l'écart entre les naissances et les décès, écart largement positif : prolongement de l'espérance de vie et taux de fécondité) et le solde migratoire (l'écart entre les immigrants et les émigrants, entre ceux qui rentrent en France et ceux qui en partent, solde positif). Dans les 60's, le solde démographie était plus important qu'aujourd'hui. → les facteurs sociaux : → expansion de l'entrée des femmes sur le marché du travail. Entre 1962 et 2002, le nombre de femmes actives a augmenté de 6 millions. Ce phénomène est d'autant plus remarquable qu'il touche l'ensemble des générations féminine et qu'il ne cesse d'augmenter malgré les différentes
crises économiques. En 2016 elle représente 48,2% des actifs occupés. Mais toujours sous représenté par rapport aux hommes. → l'allongement de la durée des études puis les politiques d'encadrements de l'âge de la retraite soustrait un nombre important de jeunes et de séniors du marché du travail. La population active se concentre plus sur la tranche 25-49 ans qui représentent 65% de la population active. La population active a évolué à la fois en nombre et en composition depuis 60's. Mais le principal élément qui contribue à la faire muter est l'apparition du chômage de masse.
B) Le chômage en France En France comme dans la quasi-totalité des pays industrialisé, la croissance de la population active s'est accompagnée d'une augmentation des emplois. Mais pour des raisons que ne parviennent pas à expliquer clairement les économistes, le nombre de création d'emplois n'a pas été suffisant pour combler la croissance de la population active. La conséquence est l'augmentation du taux de chômage qui depuis les années 80, flirt avec les 10% de la population active. Ce qui contribue actuellement à 3 millions de personnes touchées par le chômage. 1) Les théories expliquant le chômage Au milieu des années 70, le chômage n'a touché que 500 000 personnes, et actuellement on est à 3 millions, donc c'est un chômage qui a été multiplié par 6. Plusieurs théories expliquent cette augmentation : → la théorie des croissances des actifs : c'est l'explication la plus simpliste qui est très souvent utilisé dans les discours politiques et médiatiques. Donc le chômage serait lié à la croissance des actifs. Le travail féminin et l'I sont 2 éléments qui expliquent qu'il y a trop d'actifs. On peut critiquer cette explication pour plusieurs raisons : → lorsqu'on regarde sur le temps long on observe que la progression quantitative de l'offre du travail ne correspond pas historiquement à la brutale montée du chômage. Ce n'est pas au moment où le nombre d'actifs augmente que le chômage augmente également. C'est entre 1968 et 1975 que la population active augmente le plus et pourtant c'est une période où le chômage est extrêmement faible. C'est à ce moment où il y a une stagnation du nombre d'actifs que le chômage augmente. → On se rend compte que les nouveaux actifs (femmes et immigrés) ne remplacent pas les anciens actifs dans leur poste. Les femmes ne décrochent pas des anciens emplois masculins mais sont embauchés sur de nouveaux postes qui sont considérés historiquement comme des emplois féminins (santé, travail social, emplois de bureau). Les femmes vont entrer sur le marché du travail et occuper ce type d'emplois mais ne vont pas remplacer les hommes sur des emplois industriels par exemple. On retrouve le même phénomène pour les immigrés, ils ne vont pas remplacer des emplois occupés par les nationaux mais occuper des postes qui leur sont « réservés ». Nicolas Jounin a mené une recherche en 2010 dans les secteurs du bâtiment. Il s'est fait employer là-bas et va mener une recherche. Son enquête permet de démontrer que dans le secteur du bâtiment il y a un recours très important au travailleur immigré pour occuper les postes les plus dures et les plus pénibles. Ce sont des immigrés qui n'ont pas de papiers à jour et donc considérés comme des clandestins. Cet exemple montre que ce n'est pas les nouveaux actifs qui viennent concurrencer les anciens actifs. Cette manière de voir les choses s'inscrit dans la droite ligne des économistes les plus libéraux et notamment les économistes les plus classiques : Adam Smith qui défend l'idée que le marché s'auto régule lui-même. Dans sa logique, lorsque l'offre de l'emploi se dégrade, c'est à la demande de s'adapter pour trouver un équilibre, soit en se réorientant vers les secteurs plus porteurs et/ou une baisse des prétentions des baisses de salaires et des prétentions de travail. Dans cette logique, si les
travailleurs sont au chômage c'est qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter et donc ils sont responsables de leur situation. Le chômage deviendrait donc un acte volontaire. Si les individus sont au chômage c'est bien évidemment de leur faute, mais aussi à cause du système éducatif car la formation ne serait pas adaptée au monde du travail. → la théorie de la segmentation du marché du travail : théorie formée dès les années 70 par des économistes américains. Elle explique que le marché du travail est séparé en 2 : → le marché primaire : il y a des emplois stables et bien rémunérés, les salariés ont des possibilités d'évolution de carrière, ont des protections sociales et ont accès à la formation professionnelle. Toutes les entreprises ont besoin d'un noyau dure d'une main d'œuvre qualifiée pour répondre aux commandes et pour maintenir une certaine cohésion dans l'entreprise. → le marché secondaire où les emplois sont instables, les situations sont précaires et les salaires sont bas. Les protections sont relativement faibles et les syndicats sont absents. Pour les économistes américains, c'est sur ce marché que les risques de chômages sont plus importants et dans ce marché on va retrouver des femmes, des jeunes et des travailleurs immigrés. Ces individus sont plus touchés par le chômage et la précarité. Ces 2 marchés sont complémentaires et peuvent se retrouver à l'intérieur d'une même entreprise. Quelques critiques de ce modèle : → il y a un côté un peu figé entre le marché primaire et secondaire. → la segmentation peut contribuer à opposer les salariés entre eux et contribuer à reproduire des différences entre les salariés du marché primaire et secondaire, mais aussi cela contribue à normaliser les divisions et les inégalités de travail en la défaveur des femmes, des jeunes et des immigrés. → paradoxalement les situations peuvent s'inverser et que les individus du marché primaire peuvent être plus en danger que ceux qui sont dans le marché secondaire. Pour conclure, il est extrêmement complexe de proposer une théorie globale pour rendre compte des raisons du chômage. 2) Les inégalités face au chômage L'idée de séparer dans l'analyse 2 types de chômages : le chômage de longue durée et le chômage de courte durée (la privation momentanée d'emploi). • Le chômage de longue durée : l'apanage des ouvriers peu qualifiés. Le groupe social est déterminant dans les probabilités de subir le chômage et de perdurer dans cette situation. Ce sont les ouvriers et les travailleurs les moins qualifiés qui sont le plus touchés par le chômage et notamment par le chômage de longue durée. Plus on monte dans la hiérarchie sociale et plus les probabilités sont faibles. La plupart des enquêtes sociologiques ont montré que c'est la durée du chômage qui est destructrice pour le travailleur. Paul Lazarsfeld a fait une enquête dans les années 30 « les chômeurs de Mariental ». Un chômage de masse et de longue durée qui va toucher la population de la ville. Ce chômage produit chez les demandeurs d'emplois une forme de découragement et de replis sur soi, car le travail servait de repère dans la vie quotidienne des ouvriers et de moteur à leur vie sociales et alors que plongé dans le chômage les ouvriers voient leur temps libre s'accroitre, paradoxalement ils ne profitent pas de cette augmentation de temps libre. La lassitude va les pousser à un repli dans leur foyer, ils ont encore moins de loisir que lorsqu'ils travaillaient. Ce chômage est destructeur puisqu'il s'attaque à la vie privée des individus et à la vie professionnelle. Cette contestation-là est toujours valable. Cette situation de chômage de longue durée a une tendance à devenir pratiquement indépassable, puisqu'un long passé de chômeur devient un frein dans le processus de recrutement. Plus le travailleur passe du temps au chômage, plus il se replie sur soi. Il y a un risque d'enlisement dans la situation de chômage.
• Les femmes et les jeunes victimes privilégiées du chômage Le sexe demeure encore et toujours un facteur de discrimination important face au chômage. Quel que soit l'âge les femmes affichent un taux de chômage supérieur aux hommes. De plus elles sont davantage soumises, qu'aux hommes, aux emplois à temps partiels, à la précarité, à la pauvreté laborieuse. L'âge est aussi un facteur d'inégalités face au chômage, et les jeunes sont notamment des victimes importantes du chômage. D'après les chiffres de pôle emploi, 1 jeune de moins de 25 ans sur 5 est en recherche d'emplois. Par contre les statistiques démontrent que les jeunes sont 2 fois moins au chômage que les plus anciens et ont moins de risques de tomber dans le chômage de longue durée. Donc la jeunesse est un atout sur le marché du travail, mais il y a plusieurs désavantages qui surgissent : → l'instabilité, il y a une forte alternance entre des périodes d'emplois précaires, de chômage et de stage, ce qui fait que le tiers des salariés âgés de 15 à 29 ans subis la précarité contre seulement des 10% des 30 à 49 ans sont considérés comme des précaires. Les raisons expliquant que les jeunes sont plus soumis au chômage. Plusieurs « spécialistes » expliquent ses raisons. Dans toutes les explications, il y en a très peu qui dise que c'est le marché du travail qui ne fonctionne pas, beaucoup accusent les jeunes : → cette précarité et instabilité de la jeunesse seraient dû à la désaffection vis à vis du travail. Ils seraient allergie au travail et aux valeurs du travail. → la précarité et l'instabilité seraient un moyen de prouver leur anti conformiste au sein du travail en quête d'expérience et d'instabilité. Tous ces discours cachent la responsabilisation des plus précaires et faire peser sur les individus leur malheur. Les jeunes sont les principales victimes de l'inflation des diplômes (c'est le fait que de plus en plus de diplômes sont accordées ce qui fait que les diplômes perdent de la valeur sur le marché du travail). En 1940, seul 5% d'une classe d'âge obtient le bac. Aujourd'hui on a le même pourcentage voire plus pour le taux d'obtention du doctorat par classe d'âge. Ce qu'on appelle l'instabilité de la jeunesse c'est souvent le temps pour comprendre que le diplôme n'a plus de valeur. Cette infection de diplôme est rédhibitoire pour ceux qui n'en ont pas. Les BTS ou les DUT sont les petits diplômes pù il y a moins de % d'employabilité. II) Les transformations du travail en France depuis les années 80 Robert Castel analyse le développement du salariat. Il montre que les années 70 marque l'apogée de la société salariale c'est à dire l'apogée d'une forme de compromis social entre les employées et les instances dirigeantes où c'est l'âge d'or du système de protection sociale à la française avec un ensemble de protections mise en place après la 2nd GM (sécurité sociale avec tous les risques qui sont pris en charge par celle-ci ; risques santés, risques vieillesse et risque d'accident de travail). Castel démontre que la société salariale a mis en place la propriété sociale de l'individu qui assure les protections au travail. A ces protections qui sont liées à la sécurité sociale, il faut ajouter le régime de l'assurance chômage et l'ensemble des minimas sociaux. Ce système est donc associé à la société salariat. Le salariat donne accès à l'individu l'ensemble de ces protections. C'est un système qui fonctionne avec la société salariat, ce qui explique qu'une partie des indépendants soient beaucoup moins bien protégé que les salariés. Le développement de nouveaux emplois indépendants ne s'ouvre pas au système de protection sociale. La déstabilisation du marché du travail s'explique par → la montée du chômage → la précarisation des plus fragiles → la refondation de l'organisation du travail vers davantage de flexibilité
→ les dynamiques de recomposition de la société salariale qui entraine notamment la baisse des modes de résistances. A) Le démantèlement de la classe ouvrière C'est le groupe le plus touché par le chômage et aussi touché par les mutations de l'organisation du travail. On va voir les conséquences de ces transformations sur la classe ouvrière. 1) Les années 80 : le déclin de la sociabilité ouvrière L'enquête d'Olivier Schwartz paru dans l'ouvrage du Monde privé des ouvriers. Dans cet ouvrage, il fait une enquête sur une cité ouvrière dans le Nord de la France entre 1980/1985. Il va faire de l'observation participante et il va centrer son analyse sur ce qui se passe dans la sphère privée chez les ouvriers. Ce qui l'intéresse c'est le mode de vie et le mode d'organisation des familles ouvrières. Il met de côté le travail. Les résultats de son travail montrent l'effet de transformation du monde social sur les familles ouvrières. Il souligne que l'on retrouve chez ces familles plusieurs traits classique de la culture ouvrière, notamment les identités sexuées demeurent très présentes et renvoient à une vision des choses plutôt traditionnelles ; pour les femmes, le mariage et la maternité sont des passages obligatoires et le travail féminin est cantonné au période d'avant la 1ère grossesse et ensuite lorsque les enfants sont autonomes. La division des tâches domestiques demeure très largement un principe de division sexuelle du travail. Ce sont les femmes qui gèrent aussi le budget familial. Du côté masculin, les hommes se réfèrent au modèle de l'ouvrier traditionnel, les valeurs de virilité sont très présentes. Il y a des ilots masculins, comme le dit Schwartz, (le bricolage, le jardinage) qui demeurent des lieux exclusivement masculins. La crise et la déstabilisation de la société salariale va jouer le rôle de catalyseur du changement. Pour lui, cette cité ouvrière est un laboratoire à ciel ouvert des changements induit par la déstabilisation de la société salariale. Le chômage de masse va fissurer le modèle traditionnel ouvrier et notamment la place des hommes. C'est notamment toute la référence de virilité acquis par le travail qui va être remis en cause. Il va donc avoir un repli masculin sur le foyer familial, beaucoup d'hommes refusant de montrer à leur ancien collègue leur statut de chômeurs. Il va y avoir le même processus pour les ouvriers encore salariés puisqu'ils vont pousser leur enfant dans leur étude pour leur faire sortir de la classe ouvrière. Cet investissement du père dans les études des enfants va faire qu'il y aura un recèrement dans la sphère familiale et domestique. Il va y avoir un déclin de la sociabilité ouvrière qui va aussi être un déclin du mouvement ouvrier dans son ensemble. Ce sont les années 80, un monde relativement traditionnel mais qui a été fissuré de l'intérieur. 2) Les années 90 : la fragilisation de l'unité ouvrière Stephan Beaud et Michel Pialoux, ouvrage sur Retour sur la condition ouvrière et démontre la fragilisation de l'unité ouvrière. Enquête qui se passe sur l'usine de Peugeot à Sochaux et ils s'intéressent à ce qu'il se passe dans la sphère privée et professionnelle. Ces auteurs vont avoir des conclusions relativement pessimistes. Ils décrivent un monde ouvrier qui ont fait le deuil de l'âge d'or des années 70 et retrouvent le même constat de Schwartz c'est à dire que la sociabilité ouvrière a largement diminué et ils interprètent ça dans le monde du travail. La sociabilité était ce qui permettait aux ouvriers de supporter leur condition de travail, de se forger une identité commune et de construire un collectif. Ils montrent qu'au moment de l'enquête la peur du chômage, l'absence de mobilité professionnelle, la concurrence dans le travail, la stagnation des salaires renforcent l'amertume des ouvriers. Celle-ci alimente un sentiment de désarroi, amplifie la crise de la représentation syndicale et incite à la xénophobie. L'idée est de montrer que la déstabilisation de la société salariale a apporté une insécurité. Les ouvriers français s'opposent aux ouvriers immigrés. Ils montrent qu'une distance se crée entre les générations ouvrières, pour plusieurs raisons. La direction oppose ces générations par le jeu de marché du travail primaire et secondaire parce que pour les jeunes on leur réserve que des contrats en CDD ou de l'intérim et on leur fait miroiter une
hypothétique embauche en CDI. Pour parvenir à cela, les jeunes doivent montrer qu'ils sont dignes d'avoir un CDI et s'acharner dans le travail. Par l'augmentation de rendements, les plus jeunes vont casser une vieille tradition ouvrière qui cherche à maintenir la production à une vitesse moyenne pour ne pas mettre en péril leur santé et aussi leur emploi. Tout ça provoque des vives tensions entre les générations et sapent l'unité ouvrière. A cette opposition entre les générations s'ajoute le désenchantement des plus jeunes ouvriers car ils sont passés beaucoup plus longtemps par l'école, ce qui a fait naître chez beaucoup l'espoir d'une sortie de la classe ouvrière ; espoir qui est une déchue car malgré leur diplôme, ils sont contraints d'occuper des emplois ouvriers. Donc l'entrée à l'usine est un passage qui peut être ressenti comme obligé et douloureux. Le système scolaire ne donne pas que des diplômes, il permet aussi de s'ouvrir à d'autres univers culturels. La vie lycéenne et étudiante ouvrent à d'autres manières de voir le monde du travail. Il y a une forme d'opposition culturelle qui se met en place entre les plus jeunes et les plus anciens qui est lié au passage beaucoup plus lon...
Similar Free PDFs

Sociologie DU Travail
- 5 Pages

Livre sociologie du travail
- 11 Pages

Sociologie de la modernité
- 29 Pages

Sociologie DE LA Musique
- 9 Pages
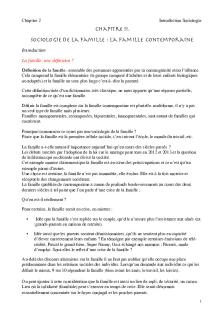
Sociologie de la famille
- 30 Pages

Sociologie de la famille
- 11 Pages

Domaines de la sociologie
- 45 Pages

Sociologie DE LA Deviance
- 18 Pages

Sociologie de la culture
- 40 Pages

Devoir sociologie de la santé
- 3 Pages

CM Histoire de la Sociologie
- 32 Pages

Pourquoi faire de la sociologie
- 12 Pages

CM Sociologie de la déviance
- 25 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu


