CM Sociologie de la déviance PDF

| Title | CM Sociologie de la déviance |
|---|---|
| Course | Sociologie de la déviance |
| Institution | Université de Paris-Cité |
| Pages | 25 |
| File Size | 555.7 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 74 |
| Total Views | 154 |
Summary
Cours magistral de sociologie de la déviance...
Description
SOCIOLOGIE DE LA DEVIANCE
Séance 1 : Qu’est-ce que la déviance ? Introduction : IIIIII-
Déviance, normes, étiquetage, sanctions : le lexique du contrôle social. Les dilemmes de l’intégration Les principaux modèles d’analyse de la déviance :
Introduction : On tous un point commun : Assassins, Gothiques, toxicomanes, les chauffards qui conduisent en état d’ivresse, les anorexiques, les homos, transsexuels, bi, les fondamentalistes ou religieux, les électeurs du FN. Point commun : sont considérées comme déviantes par les autres membres de la société. Elles s’écartent de la voie considérée comme correcte, comme normale par ces derniers, par les autres membres de la société. « les braves gens n’aiment pas que l’on suive une autre route qu’eux ». La notion de déviance n’est apparue que récemment, dans les années 60 aux Etats-Unis. Devient un concept sociologique à partir des années 1960 mais des phénomènes qu’il désigne existent depuis bien longtemps. Ce terme est chargé de significations, terme sociologique spécial, pas pareil que le sens commun. Déviance : renvoie à l’idée de transgression des normes en vigueur dans un groupe donné. Par leurs pratiques déviantes des individus s’écartent du groupe. Cette transgression fait que les gens qui comment cette transgression s’éloigne du groupe social. Cette éloignement est potentiellement durable voir de plus en plus important. C’est ce que révèle le glissement qui des actes fait porter la désignation sur les personnes. Celui qui commet un vole, devient un voleur. Un voleur on présuppose que cette personne serait habitée par une tendance à subtiliser les objets en permanence. Confond avec la kleptomanie. La kleptomanie est plus l’exception que la règle, kleptomane= rare. Pareil pour les tricheurs. Souvent un phénomène qui arrive une fois ou de fois. Mais c’est le premier pas qui compte, une fois la transgression opérée une première fois, idée derrière que celle-ci va être recommencée. Le voleur devient kleptomane, alors que souvent le voleur vole une fois, deux fois mais ne recommence pas. 2ème remarque : la déviance n’est pas synonyme de délinquance. Le socle de normes d’une société ne se résume pas aux seules lois d’une société. On est délinquant quand on enfreint une loi. Or, la déviance est plus large, désigne un ensemble de comportements plus larges que les seuls comportements délinquants. Normes sociales/normes juridiques.
I-
Le lexique sociologique de la déviance :
Valeurs et normes/ contrôle social/ Sanctions négatives, positives ; formelles, informelles/ Stigmatisation/ Déviance primaire, secondaire. La cohésion d’un groupe social repose notamment sur l’existence de normes communes que chacun des membres doit respecter. Ces normes peuvent êtres explicites, des lois, des règlements et implicites, la morale, jugement moral, règles de comportements implicites, modes vestimentaires ou langagières. Ces normes implicites ou explicites sont souvent perçues comme naturelles par ceux qui s’y conforment pourtant elles varient dans le temps et dans l’espace. Elles varient selon les sociétés et les périodes. Y a 8à ans, les naissances hors mariages étaient très fortement réprouvés. Aujourd’hui les naissances hors mariages choquent beaucoup moins. L’avortement avant la fin des années 70 était passible de poursuite judiciaire. Aujourd’hui légal. La conduite en état d’ivresse était autorisée dans les années 60, 70. Aujourd’hui interdite. Les normes sont perçues comme naturelles pourtant elles évoluent. Un acte déviant n’est pas déviant en soi, il est déviant parce qu’un ensemble de lois, de normes le déclarent comme déviant. Un individu n’est pas déviant en luimême. La déviance n’est pas un attribut naturel ou psychologique qui serait attaché aux personnes. On doit rapporter les comportements déviants, doit les ramener au système qui les décrit comme déviant.
Contrôle social : pour tenter de limiter les comportements déviants, le groupe social met en œuvre, instaure des dispositifs spécifiques pour limiter les comportements déviants, ces dispositifs spécifiques surveillent et sanctionnent les comportements= contrôle social. Il passe par l’attribution de sanction.
2 types : sanctions négatives quand il s’agit de punir les auteurs d’actes déviants et pour dissuader les autres de faire la même chose. Puis les sanctions positives pour récompenser les auteurs d’actes conforment et pour encourager les autres aussi à les imiter. Les sanctions et les instances qui les mettent en œuvre peuvent être ouvertement reconnues comme telles. On parle de contrôle social formel qui s’oppose au contrôle social informel c’est lorsque les sanctions et les instances qui les mettent en œuvre sont plus discrètes. Le contrôle social s’exerce à tous les niveaux de la société. La mère qui surveille son enfant, les contrôles de police. De façon diffuse, le regard réprobateur d’un inconnu, de ses amis ou à travers d’une instance spécialisée, les instances d’un tribunal. Contrôle social formel : instances officielles : instances spécialisées : tribunal, etc… Informel : regard réprobateurs, etc… inconnus… La déviance est une notion doublement relative : d’abord parce qu’un comportement n’est déviant que par rapport à une norme particulière qu’il transgresse. On parle de déviance primaire. Notion mise en place par Edwin Lemert dans les années 50. Doublement relative car cette transgression doit être reconnue comme tel par d’autres membres de la société, on parle alors de déviance secondaire. Lemert donne un programme d’étude de la déviance : 1ère étape : étape de la transgression : déviance primaire. 2ème étape : étude de l’activité du contrôle social. Il peut y avoir déviance primaire sans déviance secondaire : celui qui arrive à ne pas se faire coince. Comme un acte déviant, mais cet acte déviant n’est pas reconnu comme tel par les autres membres de la société. Il peut y avoir déviance secondaire sans déviance primaire : c’est lorsqu’on va imputer à tort une transgression à un individu. Ex : contrôle de police au faciès. Subit le contrôle social alors qu’il n’a rien commit. Déviance : construction sociale qui se construit à partir d’un système de norme, définit à partir de normes sociales.
II-
Les dilemmes ou les contradictions de l’intégration :
Emile Durkheim est un des premiers sociologues à avoir insister sur un paradoxe, une contradiction entre la nécessité d’avoir des règles communes pour faire société mais en même temps ces règles s’exercent comme une contraintes sur les individus. « De la division du travail social » Durkheim montre que l’on est passé d’une société où s’exerçait une solidarité mécanique à une société où s’exerce une solidarité organique. C’est réalisé sous l’effet de la division du travail, de l’urbanisation. La solidarité mécanique concerne les sociétés traditionnelles qui n’ont pas vécu la révolution industrielles, la solidarité, le lien social résulte de la proximité et de la ressemblance entre les individus. Ressemblance entre les individus qui vivent dans des petites communautés, des villages. Le poids de la communauté, du groupe est très fort. Ces individus là partagent des valeurs communes et exercent des rôles, des fonctions similaires, des activités sociales peu spécialisées, peu différenciées. Sociétés d’autoproduction où l’on produisait sur place, à la ferme se dont on a besoin. Après, dans les sociétés modernes (après la révolution industrielle), le travail est plus divisé, les fonctions occupées par les individus sont plus nombreuses, beaucoup de métiers se créer dans tous les domaines de la vie sociale. Les individus sont plus dépendants entre eux, les uns des autres, ils sont obligés de faire preuve de solidarité, ils sont obligés de compter sur les autres, sont complémentaires, dépendants les uns des autres. Pour Durkheim, la solidarité organique est fondée sur l’interdépendance entre les individus. Le problème pour Durkheim, c’est que dans ces sociétés organiques il y a un risque d’anomie. Anomie : désigne une société ou une personne confrontée à un affaiblissement des normes, des normes de conduites et un affaiblissement du contrôle social. Confusion sociale, contradiction sociale, dérèglement social des règles sociales. Pour D, l’anomie est liée aux risques d’individualisme. L’individualisme peut créer un affaiblissement des normes, valeurs, etc…
Nécessité de règles commune pour la vie en collectivité, s’il n’y a pas assez de règles= risque d’anomie. Ces normes communes peuvent étouffées les membres de la société et finalement empêcher la vie commune.
Durkheim élabore une typologie du suicide : 4 types de suicide, catégories : 2 catégories renvoient à un problème d’intégration sociale (soit on est trop intégrer soit pas assez à un groupe)
Suicide égoïste : c’est lorsque les groupes auxquels appartient sont affaiblis, l’individu fonctionne en fonction de ses propres règles et il peut amener à se suicider par impression d’être seul au monde, suicide du chômeur, du célibataire, etc… l’individu n’est plus intégré à un collectif. Vous avez plus de chance de vous suicider si vous n’êtes pas mariés. Suicide altruiste : lorsqu’un individu est tellement intégré à un groupe qu’il ne fait suffisamment assez cas de sa personne. Ex : les suicides collectifs des sectes, l’individu n’existe plus en tant que personne. Suicide des kamikazes. Suit les règles du groupes, si elles sont de se tuer, se tue.
2 autres types de suicides : là renvoie à un manque ou un excès de régulation :
Suicide fataliste : lorsqu’il y a trop de normes, de règles, trop de régulation. Finit par « étouffer » l’individu qui voit son destin bouché, tellement bouché, sans issu que la mort, lui semble la seule solution. Ex : l’amour impossible, (règles sociales qui empêchent une liaison entre 2 personnes). Trop de régulation, trop de normes. Le suicide anomique : lorsqu’il n’y a pas assez de règles, de normes. Lorsque les mécanisme de régulation sociale sont en panne= manque de repères. Ex : gens qui changent trop vite de classe sociale.
Pour Durkheim, le suicide est un fait social, pas du à des causes psychologiques. Pour lui renvoie à des causes sociales et notamment le niveau d’intégration d’un individu dans un groupe et le niveau de régulation.
III-
Les principaux modèles d’analyse de la déviance :
Après Durkheim, de nombreux « sociologues » , intellectuels se sont penchés sur les phénomènes de déviances et ont proposé de nombreux modèles d’explication de la déviance. A) L’Approche « essentialiste » : Elle consiste à considérer que la déviance serait en quelque sorte inscrite chez les gênes de certains individus. De nombreux savants au 19ème et au 20ème siècle vont chercher à « détecter » des personnalités « déviantes ». A travers de tests psychologiques voir par la physiognomonie. C’est la mise en correspondance de propriétés physiques avec des traits de personnalité. Cesare Lombroso. (1835-1909) Il a écrit un ouvrage qui s’appelle : « L’homme criminel ». C’est un médecin légiste, il a étudié l’anatomie de millier de criminels et il va en tirer un certains nombre de conclusions sur les facteurs physiques de la criminalité. Il distingue les « criminels nés » eux sont irrécupérables pour lui, il faut soit les enfermer soit les éliminer. Ce sont des erreurs de la nature selon Lombroso, ils sont nés criminels et mourront criminels. Ensuite il y a les criminels par passion et les criminels occasionnels. Ils sont moins dangereux que les criminels nés et surtout on peut les rééduquer. Lombroso distingue les criminels nés et les distingue des autres par des critères physiques : la longueur du front, la forme du nez, la mâchoire, une puberté précoce. La déviance est reconnaissable à partir de traits physiques, attributs physiques, pathologie innée selon l’approche essentialiste. Aujourd’hui : on dit plus que c’est du à une tendance génétique. Que c’est dans les gênes avec l’approche essentialiste.
B) L’approche de la rationalité individuelle, « rationnelle » : Vient de la théorie économique dominante : la théorie néo-classique. Part du principe que la conduite des hommes et des femmes est guidée par des calculs, ces calculs qui visent en chaque situation à maximiser les intérêts individuels. L’individu fait une différence entre le bénéfice qu’il attend de son action et le risque encouru, son coût. Les comportements déviants résulteraient d’un tel calcul et donc pour dissuader les individus de commettre des actes déviants il suffit de diminuer les gains espérer et d’augmenter les coûts. Ex : La fraude au transport, à la ratp. Evaluation du risque de se faire choper, ex : se fait pincer 1 fois par mois, coût de l’amende= 27€. Coût du pass navigo par mois : 60€. Plus rentable de prendre une amende que de payer le pass. Si on augmente l’amende : 200€ le coût de ce comportement déviant est plus important que le bénéfice. Pour cette approche, la délinquance résulte d’un choix fait par un individu et donc la meilleure façon d’enrayer la déviance est de dissuader l’individu. Théorie en
politique située plutôt à droite. Théorie largement dominante si on regarde l’alourdissement des peines, la répression toujours croissante. La prévention situationnelle.
C) Les approches culturalistes et interactionnistes : Approches développées à partir des travaux de « L’école de Chicago ». L’école de Chicago, la première est composée de sociologues qui travaillent à Chicago dans les années 1920-1930. Chicago dans les années 20 et 30 se développe de manière spectaculaire, dans les années 10 : environ 1 million de personne, dans les années 30 : 4 millions. Va accueillir toute une population de migrants. : Européens, afro-américains qui vivaient dans le sud des États-Unis qui fuient la ségrégation. Et des paysans. Ces approches là se composent de différentes sous-approches : la première : celle de la désorganisation sociale. A été mise en point par 2 sociologues : William Thomas et Florian Znaniecki. Cherche à savoir à comment les familles polonaises réagissent au transfert de la vie rurale en Pologne à la vie urbaine aux USA et à Chicago, au transfert dans une autre culture, et quelle modalité d’adaptation ces migrants parviennent ils à mettre en place ? Les 2 auteurs pointent les contradictions entre une culture d’origine, celle des migrants polonais et celle de la société d’accueil urbaine et individualiste. Pour eux l’immigration affaiblit les normes, les règles, les solidarités des migrants ce qui favoriserait les transgressions et la déviance. Elabore le concept de désorganisation sociale. La migration provoque un phénomène de désorganisation sociale temporaire. Lorsqu’ils migrent les polonais perdent leurs repères, ceux de leur ancienne culture et n’ont pas encore acquis les codes de leur nouvelle culture. Hugues Lagrange…. L’éducation déviante. Concept mis au point par Erwin SUTHERLAND. Pour lui la déviance résulte d’un processus d’apprentissage similaire à l’éducation familiale ou scolaire. Apprentissage qui s’opère dans un groupe restreint en interaction avec d’autres déviants. Cet apprentissage contient une dimension technique et une dimension morale, apprendre à légitimer son geste, ses actes. La déviance s’apprend et c’est un processus de socialisation. -Albert Cohen. D) L’approche fonctionnaliste : L’approche fonctionnaliste rassemble des sociologues qui souhaitent expliquer des phénomènes qu’ils étudient à partir de la fonction que ces phénomènes remplissent dans la société. Quelle fonction rempli la déviance pour les fonctionnaliste ? Elle a pour but d’amenuiser, de diminuer les inégalités sociales. Le vol par exemple, n’est qu’un moyen illégitime car sanctionner et interdit par la loi pour parvenir à des fins légitimes (s’enrichir). Parce que les déviants ne peuvent pas emprunter les voies normales ils mettent en placent des stratégies déviantes, ils adoptent des comportements déviants. La société Américaine valorise l’enrichissement, la richesse. Pour devenir quelqu’un en Amérique il faut avoir de l’argent. Mais pour certains, ils ne peuvent pas emprunter les voies normales, légitimes donc ils utilisent des voies illégitimes. Pour les pauvres, la déviance est un moyen de résoudre, de diminuer les inégalités sociales. Toutes ces approches sociologiques ne détiennent pas à elles seules l’explication des comportements déviants. Il faut les combiner. Les trajectoires des individus déviants ont quelques chose d’irréductiblement individuel. On ne peut pas prendre une théorie pour expliquer un comportement. Toutes, sauf une, l’approche essentialiste, biologique, elle a été discréditée. Robert Merton, Paul Willis.
2ème séance : Comment devient-on déviant ?
Introduction : La socialisation, un processus fondamental.
L’étude de la socialisation, c’est l’étude du processus de socialisation, c’est la manière dont nous devenons ce que nous sommes en fonction des contextes ou des situations dans lesquelles on est plongés. Les sociologues cherchent à comprendre les facteurs qui font qu’un individu ou un groupe social agit, pense d’une certaine manière plutôt qu’une autre. Bourdieu à élaboré le concept d’habitus. Ce sont les dispositions acquises par un individu lors de sa socialisation primaire (enfance et adolescence) au contact de la famille et de l’école. Ces habitus s’incarnent dans des situations concrètes. Processus complexe à étudier. Un habitus n’est pas figé, il n’est pas donné une fois pour toute. Il n’est pas non plus forcément cohérent. Bernard Lahire, il montre que la dissonance l’emporte sur la cohérence. L’habitus culturel des individus est incohérent. Les individus mêlent des activités légitimes avec d’autres qui le sont moins. Ex : aller à l’opéra et regarder la star académie. Opéra : culture bourgeoise, Star académie : culture populaire. « La culture des individus » 2004. Comment des individus vont devenir déviants et comment vont-ils le rester ? Howard Becker, va donner une analyse pionnère, classique particulièrement féconde pour comprendre comment les individus deviennent et restent déviants. « Outsiders » 1963. Né en 1928, à la base pianiste de Jazz, entame des études de sociologie à l’université de Chicago et va enquêter sur les clubs et les boites de Jazz américaines. Réalise une Observation participante et entretiens avec des musiciens de Jazz et des fumeurs de Marijuana. Il utilise donc des méthodes ethnographiques. Les méthodes ethnographiques impliquent un contact direct avec les populations étudiées. Elles impliquent une immersion du chercheur sur son terrain. Il observe de l’intérieur la population qu’il étudie. Le Jazz dans les années 60, quand Howard Becker mène son étude, est une musique particulièrement mal vue, déconsidérée, illégitime. Pratiquée par des individus supposés de mauvaises mœurs. Comme tout ce qui est issu de la culture afro-américaine à cette époque. Surtout par les élites blanches. Aujourd’hui, vit à Paris et à écrit plusieurs œuvres, ouvrages sociologiques. « Les ficelles du métier » I) Lé déviance un étiquetage : A) Un processus interactif : Becker rappelle d’abord que la déviance ne se réduit pas à la délinquance et ce n’est pas un phénomène qui se réduit en soi. Pour B. ce qui constitue la déviance réside dans les interactions sociales. Et dans le fait que certains groupes ou individus étiquettent certains comportements supposés déviants et par extension ils étiquettent également les individus qui les effectuent. Becker « Les groupes sociaux créent la déviance en instituant des normes dont la transgression constitue la déviance et en appliquant ces normes à certains individus ». La déviance n’est pas créée par la personne qui commet l’acte mais par ceux qui étiquette. Un comportement sera jugé déviant en fonction du contexte dans lequel il est effectué. Ex : la consommation d’alcool n’est pas une déviance par nature, les seuils en termes de quantité d’alcool et la fréquence à partir desquelles on va penser qu’une personne est alcoolique varie. Selon les lieux, selon les époques et selon les contextes. Les seuils changent parce que certains groupes sociaux, décideurs politiques, ligues de ver...
Similar Free PDFs

CM Histoire de la Sociologie
- 32 Pages

CM Sociologie de la déviance
- 25 Pages

CM Sociologie de l\'éducation
- 16 Pages
![CM sociologie complet [3564]](https://pdfedu.com/img/crop/172x258/xw2peolo59r5.jpg)
CM sociologie complet [3564]
- 22 Pages

CM Les grands courants de sociologie
- 21 Pages

Sociologie de la modernité
- 29 Pages

Sociologie DE LA Musique
- 9 Pages
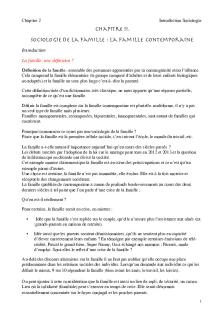
Sociologie de la famille
- 30 Pages

Sociologie de la famille
- 11 Pages

Domaines de la sociologie
- 45 Pages

Sociologie DE LA Deviance
- 18 Pages

Sociologie de la culture
- 40 Pages

Devoir sociologie de la santé
- 3 Pages

Pourquoi faire de la sociologie
- 12 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu

