Sociologie DE LA Musique PDF

| Title | Sociologie DE LA Musique |
|---|---|
| Course | Sociologie de la musique |
| Institution | Sorbonne Université |
| Pages | 9 |
| File Size | 164.6 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 52 |
| Total Views | 147 |
Summary
Sociologie de la musique...
Description
6/02/2015
SOCIOLOGIE DE LA MUSIQUE
Moodle : Durkheim
Qu'est-ce que la sociologie ? En quoi consiste la démarche sociologique ? Pour quelles raisons utilise-t-on l'approche de la sociologie sur les faits musicaux ?
Plan du cours : 1. Introduction - Les premiers pas de la sociologie de la musique 2. La musique et les approches marxisantes 3. La musique et l'approche interactionniste 4. La sociologie des arts et de la culture de Pierre Bourdieu 5. Perspectives actuelles de la sociologie de la musique en France 6. L'émergence de la socio-musicologie Synthèse du semestre : la sociologie confrontée à la spécificité du musical
1. Introduction - Les premiers pas de la sociologie de la musique
La démarche sociologique : Comment la société est-elle liée à la musique ? La sociologie fait partie des sciences humaines en général. Le terme de sociologie remonte à la première moitié du XIXe siècle avec Auguste Comte depuis 1839, où l'on trouve l'appellation "démarche sociologique". Un bouleversement apparait avec la transformation des villes, et ce phénomène a été emparé par les sociologues. On s'interroge scientifiquement avec des outils rigoureux et c'est de cette manière qu'à la fin du XIXe siècle on pose la sociologie comme une discipline scientifique. Elle est fondée sur des savoirs établis à partir de recherches tangibles. Emile Durkheim (1858-1917), notamment par Les règles de la méthode sociologique (1895), explique que la science ne repose pas sur des croyances, et Max Weber (1864-1920) pose également les bases de cette sociologie en Allemagne. Ex : étude du suicide par Durkheim -> Cela donne l'état d'intégration des individus dans une société. Elle met en cause beaucoup d'idées reçues.
La sociologie, c'est donc distinguer la psychologie. Il y a des causes sociales à un phénomène, il y a des choses qui varient par rapport à des facteurs individuels et psychologiques. On constate également une distinction par rapport à l'anthropologie. Dans les origines de la discipline, la sociologie s'est intéressée à ce qui est arrivé à celui qui est proche dans notre société mais que l'on ne comprend pas forcément. La sociologie mobilise deux grands types d'approche méthodologique : - l'approche quantitative où l'on cherche à quantifier une étude sur un objet, une population donné, à partir de différents outils comme le questionnaires ou le recensement, la statistique étant un objet d'analyse. - l'approche qualitative, à l'image des ethnologues : faire des enquêtes sur le terrain en rencontrant les individus afin d'obtenir des données générales, savoir réellement ce qu'elle aime par exemple, elle permet d'approfondir les questions. -> La démarche sociologique est avant tout fondée sur l'enquête, sur l'empirie. Elle passe par cette exploration concrète du social d'une manière ou d'une autre. Définition : Elle se propose d'étudier scientifiquement l'humain vivant au sein d'une société, les relations entre les individus et les mécanismes de fonctionnement d'une société humaine. Il s'agit bien avant tout d'un type de regard et d'un effort de scientificité. -> Texte n°1 : Peter L. Berger, Invitation à la sociologie, Paris, La Découverte, 2006 (1963), p.49-57 Chaque geste de la vie quotidienne peut devenir un objet d'étude.
Les débuts timides de la sociologie de la musique Max Weber Charles Lalo -> Texte n°2 : Max Weber, Sociologie de la musique. Les fondements rationnels et sociaux de la musique, Paris, Métailié, 1998, p.137-142
Georg Simmel Alfred Schütz Maurice Halbwachs -> Texte 3 : Maurice Halbwachs, "La mémoire collective chez les musiciens", dans La mémoire collective, Paris, Albin Michel, 1997, p.25-28
Le développement d'une sociologie d'enquête Pierre Francastel et Lucien Goldman Jean-Louis Fabiani, Anne-Marie Green, Antoine Hennion, Pierre-Michel Menger, Emmanuel Pedler,... Ivo Supičič Theodor W. Adorno Howard S. Becker
Simon Frith -> cf. Hyacinthe Ravet, "Sociologies de la musique", L'année sociologique, vol. 60, n°2, 2010, p.271-303
20/03/2015 Chapitre 4 : La sociologie de l'art et de la culture de Pierre Bourdieu Pierre Bourdieu (1930-2002) Professeur au collège de France (1981-2002) A partir de 1970, tous les travaux consacrés aux pratiques culturelles et artistiques font référence aux travaux de Bourdieu. Plan du cours : 1 - L'analyse des goûts culturels 1.1 La musique et la distinction -> Texte n°7, "L'origine et l'évolution des espèces de mélomanes" Selon lui, on se représente la musique comme l'art le plus immatériel, le plus spirituel, le plus détaché du monde qu'il soit. Il stigmatise les gens qui se présentent comme sensibles et raffinés. Contrairement à ce qu'affirmerait le sens commun, les goûts musicaux ne sont pas innés mais profondément acquis par des expériences musicales d'autant. Ces expériences musicales précoces sont souvent liées à sa classe sociale d'appartenance. 1.2 La théorie de la légitimité culturelle (1) : l'homologie structurale Cette idée constitue l'introduction de Pierre Bourdieu avec La distinction publiée en 1979. Bourdieu montre que la hiérarchie sociale et les goûts sont liés par la hiérarchie sociale, c'est une répartition sociale précise des goûts. D'après des enquêtes qualitatives et quantitatives qu'il a mené avec son équipe dans les années 1960-1970 une correspondance entre les genres culturelles et Tous les domaines de pratique culturelle sont légitimés par la hiérarchie sociale. Les goûts culturels sont classés les uns par rapport aux autre mais sont aussi classant. Chaque goût impliquerait un rejet des autres goûts. Il y a une annexion des goûts musicaux par les classes dominantes. Les fractions de classe : 2 fractions de la classe dominante qui s'oppose (professeur/ Patron de commerce et d'industrie)
1.2 La théorie de la légitimité culturelle (2) : l'habitus de classe L'habitus de classe soutient que le style de vie d'un individu est le produit de son habitus de classe. Habitus : système des manières de faire, de penser, d'agir, des principes de perception et d'appréciation (bref, des "dispositions"), incorporés au sein d'un univers social particulier (une classe sociale). L'habitus est issu d'un processus de socialisation de classe sociale. Il repose sur des mécanismes d'imprégnation informelle et inconscients via les interactions avec les proches (parents, amis,... circonscrits dans une origine sociale particulière) qui transforment les individus. La disposition esthétique est "la manière socialement tenue pour convenable d'aborder les objets socialement désignés comme oeuvre d'art, c'est-à-dire comme exigeant et méritant à la fois d'être abordé selon une intention proprement esthétique, capable de les reconnaitre et de les constituer en tant qu'oeuvre d'art." La distinction, BOURDIEU Le propre de l'habitus en tant que style d'action unifié est de se transposer dans tous les domaines de pratique, culturelle ou non d'ailleurs, et sera le principe de l'homologie structurale. Cela se traduit même dans la façon de parler, de se tenir, de marcher,... L'habitus est donc toutes ses actions qui ont leurs principes de cohérence dans l'origine de la classe sociale. 3 types d'habitus de classe : - Habitus des classes supérieures (maîtrise de la culture "légitime") : va s'accompagner d'une forte conscience de cette maîtrise. C'est en quelque sorte le double sens de la distinction, c'est à la fois un habitus distingué au sens noble du terme, et à la fois distinguant. - Habitus des classes moyennes (bonne volonté culturelle) : se traduit par une fascination pour la culture légitime mais une faible maîtrise des codes qui permettrait de la décoder. - Habitus des classes populaires (illégitimité culturelle) : pratique populaire dévalorisée (tel que la musique de bal) qui s'accompagne d'un sentiment de honte culturelle. Cela va générer ce que Bourdieu appelle des goûts de nécessité.
-> L'art et la culture ont une fonction de légitimation des différences sociales et de reproduction des écarts de classe. C'est une théorie très désenchanteur par rapport à d'autres théories de l'époque. L'école assume une fonction essentielle dans une reproduction des classes sociales. 2 - L'analyse de la production symbolique : -> Texte n°8, "Mais qui a créé les créateurs" Bourdieu propose dans le texte de contourner deux choses : - Les préjugés des artistes : qui brandissent l'idéologie du don, la liberté absolue de créateur. Cette croyance fait obstacle à la sociologie. Il faut contourner les principes de l'artiste. - L'approche marxiste de l'art : Bourdieu la juge réductrice car selon lui, elle écraserait l'art sous la . Bourdieu va essayer de trouver une voie intermédiaire
2.1 Le champ artistique et son autonomie relative : Les champs = domaines d'activités relativement autonome (musique, droit, politique, économie, religion, ...). Il y a des sphères d'activités qui sont animées par des enjeux spécifiques. Les champs artistiques vont être animés par d'autres enjeux tel que de la reconnaissance plutôt que de faire des profits. Ce concept est bâti sur une double métaphore, à la fois un champ de force et à la fois un champ de bataille. L'idée du champ de force est que le champ est un réseau structuré occupé par les producteurs, traversé par des luttes, des conflits par ces producteurs. Le champ est animé par une dynamique de conflit. ex : Le champ de musique française dans les années 1980-1990 était structuré par l'IRCAM, la mouvance néo-tonal qui ont refusé l'atonalité de Schoënberg. Le champ se structure par différents pôles de production. Illusio : adhésion ou croyance tacite des agents en l'intérêt de l'activité du cham (idée que le jeu en vaut la chandelle). Un champ est toujours doté d'une autonomie relative. Bourdieu insiste sur le fait qu'il faut se donner une vue d'ensemble 2.2 L'oeuvre entre l'habitus et le champ : Comment appréhender une oeuvre ? Pour Boudieu, l'oeuvre individuel est toujours le point de rencontre entre l'habitus de l'artiste et la position de l'artiste dans le champ au moment où il produit cette oeuvre (histoire du champ et "espace des possibles"). Tout artiste doit faire avec l'état du champ dans lequel il est incéré, ce que Bourdieu nomme l'"espace des possibles". Tout artiste doit faire avec le champ, son histoire,... à tout moment le champ offre un champ limité. L'artiste doit faire face à une situation complexe, il doit composer avec son habitus et le champ auquel il appartient. -> Oeuvre : prise de position de l'artiste, au croisement de sa position (au sein du champ) et de ses dispositions (habitus). 2.3 Le champ musical ? Il a travaillé sur le champ littéraire avec Flaubert et Baudelaire ainsi que sur la peinture au XIXème siècle (Manet). Emprise sur l'institut de France et des beaux arts. Manet chamboule les critères esthétiques et réussit à l'imposer suffisamment pour qu'ils deviennent dominants? Spécificité des institutions musicales. Roheff restitue la constitue et le champ du jazz jusqu'à nos jours. Ce concept de champ a des limites historiques de validité. Espace qui apparait en Occident au XIXème siècle. Affaiblissement des institutions monarchiques et religieuses, avant le XIX on trouve peu d'oeuvres qui se détachent complètement de ces institutions. Au XIX, les instituions sont plus souples, plus ouvertes.
Résumé : Tous les travaux de Bourdieu ont profondément marqué la sociologie des arts et de la culture, notamment en France et à l'étranger, avec de nombreuses distinctions qui ont renforcé sa renommé et sa puissance scientifique. Son approche a créé de nombreux débats et certains ont depuis longtemps rejeté son héritage, mais d'autres sociologues continuent de prolonger son oeuvre. Actes de la recherche sociale (1975, revue)
Pour aller plus loin : - Pierre BOURDIEU, Questions de sociologie, Paris, Minuit, 2002 (1980) - Pierre BOURDIEU, Alain Darbel, L'amour de l'art, Paris, Minuit, 1966 - Pierre BOURDIEU, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979 - Pierre BOURDIEU, Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1992 - Pierre BOURDIEU, Manet. Une révolution symbolique, Paris, Seuil, 2013
17/04/2015 6/ L'émergence de la socio-musicologie : Depuis les années 2000, on observe un foisonnement des recherches en sociologie de la musique, avec une dynamique importante dans le domaine des arts. Elles sont l'objet de nombreux travaux et d'un domaine extrêmement novateur. Des directions d'investigation variées : - Genres musicaux Simon Frith, Timothy J. Dowd, Jean-Louis Fabiani,... - Goûts musicaux Richard A. Peterson (omnivorisme), Philippe Coulangeo (éclectisme éclairé) En socio-musicologie, le genre musical se réfère à la fois à un genre musical et également à un usage social, pratique, et à un usage symbolique. Il y a eu un foisonnement des recherches il y a environ une quinzaine d'années tel que le jazz, le rock, le flamenco, le rap mais également l'opéra, le genre symphonique,... Cela suscite des réflexions sur le concept du genre musical, quelles sont les frontières du jazz par exemple avec les musiques improvisées, le croisement avec les musiques électroniques... Les chercheurs ont voulu comprendre à qui certains genres s'adressés. Cela a créé des questions autour de l'institutionnalisation de ces musiques, avec l'enseignement dans les lieux publiques notamment. Frith et Dowd cherchent à comprendre ces domaines par le biais historique, économique,... Fabiani a beaucoup réfléchi autour de l'articulation du savant et du populaire à propos de musique. Il discute autour de l'idée en se demandant si le jazz est un art
moyen tel que Pierre Bourdieu le qualifie. On ne peut pas parler d'art moyen pour le jazz, en disant que l'on a plutôt à faire à de l'art savant en France. En discutant les travaux de la légitimité culturelle de Pierre Bourdieu, cette homologie, Richard A. Peterson favorise la thèse de l'omnivorisme. On mange de tout. Il observe que la classification l hiérarchisation que Pierre Bourdieu avait repéré auparavant, il remarque dans les années 1980-1990, les personnes les plus hautes dans l'échelle sociale sont plutôt caractérisées par un éclectisme culturel. Pour Peterson, cela remet en cause la thèse de Bourdieu. A sa suite, cela a été testé sur de grandes enquêtes au niveau des français, et Philippe Coulangeo parle alors d'éclectisme éclairé. C'est l'idée que l'on écoute de tout mais pas n'importe quoi tout de même (j'écoute par exemple du classique mais aussi du rap, mais pas n'importe quel rap). Cela ne remet pas en cause la théorie de Bourdieu mais cela démontre une transformation par le biais d'internet, les supports numériques... Cela vient nourrir la réflexion pour les arts en général. Une autre manière de - Réception : Philippe Le Guern, Hervé Glevarec, Christian Le Bart et Jean-Charles Amboise, Gabriel Segré, Anne-Marie Green,... - Travail musical : Marc Perrenoud, Franck Léard ("musicos") Pierre-Michel Menger, Pierre François (socioéconomie) Bernard Lehmann, Wenceslas Lizé (champ) Marie Buscatto, R. Hatzipetrou-Andronilou, Hyacinthe Ravet (gender) - Analyse des processus créateurs : Pierre-Michel Menger, Maÿlis Dupont, Denis Laborde, Jacques Cheyronnaud,... -> "Travail musical", "oeuvre", "goûts" -> Production / produit culturel / réception-consommation Une approche sociomusicologique : -> Analyse externe et analyse interne Pluridisciplinarité - Une voie prometteuse : Max Weber - Une relecture de T.W. Adorno : P.-M. Menger - Howard S. Becker et Robert P. Faulkner : le répertoire en action - Musico-sociologie ? - Socio(-)musicologie OICRM, IReMus - Juliette Gréco : L. Cugny, H. Ravet et C. Rudent - L'orchestre au travail ou la construction collective d'une interprétation musicale - Claudio Abbado, Laurence Equilbey, Claire Gibault, Debora Waldman... - Irina Kirchberg
-> Texte n°11 : Irina Kirchberh, "Oreille de nageuse' et écoute musicale : un compositeur au bord de la piscine", dans Marc Perrenoud (dir.), Travailler, produire, créer, Paris, L'Harmattan, 2013, p. 159-162. - Alexandre Robert Déodat de Séverac La sociologie confrontée à la spécificité du musical : 1/ Une forme symbolique particulière 2/ Un rapport privilégié au temps 3/ Un art de la performance 4/ Un art du corps
15/05/2015 Séance de révision : Théorie du reflet : Chez Marx et Engels, au départ les idéologies sont déterminées en dernière instance par les catégories économiques. L'art au XIXe serait un art bourgeois déterminé Critique sur le fait que l'oeuvre n'est pas un simple reflet de la réalité. Théorie de la légitimité culturelle : Homologie structurale : idée qu'il y a une échelle des légitimités culturelles dans chaque pratique culturelle : légitimité dans les domaines : échelle de légitimité culturelle. Pour une même classe donnée, on a des pratiques culturelles qui correspondent à chaque classe. Structure sociale qui sont fortes pour Bourdieu tandis que pour d'autres, tout bouge tout le temps. Rapport entre l'espace de position des individus et le fait qu'ils aient certaines choses ou non. - Habitus : va permettre par reproduction cette homologie structurale. Mode de faire, de pensée propre aux individus. Porte la trace de l'homologie structurale. Pour Bourdieu, habitus de classe, partagé par certaines classes. - Champ de bataille / champ de force : Champ : concept qui va saisir ou décrire la réalité. 2 champs pour Bourdieu Bataille : champ = espace de lutte entre les compositeurs, peintres, écrivains. Enjeux esthétiques particuliers. Lutte pour la définition de ce qu'est l'art car pas de définition légitime de l'art. Rapport entre eux pour obtenir chacun la place de l'autre artistiquement, plus avant garde. Force : structures qui s'imposent aux individus et qui s'imposent à eux. Au sein d'un champ, grandes tendances dans lesquelles les individus sont pris et qui déterminent en partie ce que sont les compositeurs. Position à travers le champ. ex : début du XX, fin XIX, en France, champ musical qui commence à s'organiser autour de l'opposition entre l'Institut des beaux arts, logique plutôt académique, conservateur (Saint-Saëns, Reyer) et la Schola Cantorum (dirigé par D'Indy), plus
avant-gardiste, structuré par des logiques qui vont faire ressortir l'artiste, le désintéressement, dégagement de l'intérêt financier. -> Illusio : principe commun au champ musical, voire culturel, adhésion par les compositeurs, mais possibilité de déclinaison en fonction des arts, pas la même manière de l'investir. Croyance dans la valeur de l'art. Sorte de religion de l'art. - Médiation et attachement : s'inscrit dans la même conception théorique générale, mais ne désigne pas tout à fait la même chose. Attachement : désigne l'attache entre un amateur de musique dans le contexte qui nous intéresse et l'objet musical écouté, et en retour, l'objet musical transforme le goût et le rapport entre cet objet. Observation braquée sur la relation entre l'amateur et l'objet musical. Comment se construit l'attachement ? Lien entre deux choses. Attachement peut souligner un peu plus le lien affectif. Double sens : connexion entre deux entités et l'affect. Concept souligne mieux le rapport à la musique, mais implicitement, affect également. Médiation : défendre l'idée qu'il n'y a jamais accès à l'objet musical direct mais il y a toujours des choses qui viennent se mettre entre l'amateur et l'objet musical (pochette de disque,...). Idée que l'oeuvre, l'objet musical n'est jamais le même, toujours incarné dans quelque chose que ce soit matériel, ressenti,... Sorte de prise, toujours idée de construire le lien. Menger essaye de fournir une explication théorique de la grandeur artistique en renvoyant dos à dos deux explications : - le succès artistique serait la conséquence d'une propriété intrinsèque entre deux individus (don, génie,...) - ≠ Adorno interpréta le succès de Beethoven comme le produit direct de la catégorie sociale de Beethoven, petite bourgeoisie -> origines sociales (approche marxisante). Menger va lire le succès comme Tia DeNora (approche empirique, enquête historique sur des éléments précis), travaille sur différents liens que Beethoven avait. Le génie serait purement lié à des conditions sociales....
Similar Free PDFs

Sociologie DE LA Musique
- 9 Pages

Histoire de la musique romantique
- 17 Pages

Évolution de la musique disco
- 4 Pages

Sociologie de la modernité
- 29 Pages
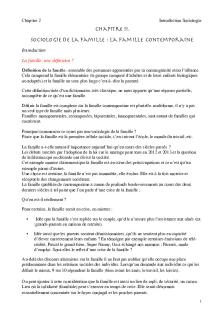
Sociologie de la famille
- 30 Pages

Sociologie de la famille
- 11 Pages

Domaines de la sociologie
- 45 Pages

Sociologie DE LA Deviance
- 18 Pages

Sociologie de la culture
- 40 Pages

Devoir sociologie de la santé
- 3 Pages

CM Histoire de la Sociologie
- 32 Pages

Pourquoi faire de la sociologie
- 12 Pages

CM Sociologie de la déviance
- 25 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu


