CM Histoire de la Sociologie PDF

| Title | CM Histoire de la Sociologie |
|---|---|
| Course | Sociologie |
| Institution | Université Jean-Monnet-Saint-Étienne |
| Pages | 32 |
| File Size | 506.3 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 8 |
| Total Views | 150 |
Summary
cours complet dispensé par Ahmed Boubeker...
Description
PLAN !
1er cours : L’histoire de la sociologie dans le champ des sciences humaines et sociales !
2ème cours : Le paradigme de la modernité et l’héritage humaniste!
! 3ème cours : Communauté et société !
4ème cours : Les précurseurs de la théorie sociale !
5ème cours : Le berceau industriel de la sociologie !
6ème cours : L’école Française de sociologie !
7ème cours : Les pères fondateurs allemands !
8ème cours : L’école de Chicago et la sociologie Américaine !
9ème cours : La tradition sociologique et la sociologie contemporaine!
BIBLIOGRAPHIE ! !
Emile Durkheim, «"Les règles de la méthode sociologique"», 2010!
Joseph et Grafmeyer, «"L’école de Chicago"», champ urbain, 2000!
Raymond Aron, «"Les étapes de la pensée sociologique, Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, Pareto, Weber"», Gallimard, 1967!
Berthelot «"La construction de la sociologie"», Presses universitaires de ! France, 2007! Milly, Delas «"Histoire des pensées sociologiques"», Armand Colin, 2009!
Lallement, «"Histoire des idées sociologiques!», Nathan, 2010!
Mendras «"Les grand auteurs de la sociologie"», Hatier, 2012!
Nisbet «"La tradition sociologique"», presses universitaires de France, 1966 !
1er cours : L’histoire de la sociologie dans le champ des sciences humaines et sociales ! 1. Qu’est ce que la sociologie ? ! #
A) L’étude de phénomènes sociaux !
# La sociologie c’est l’étude des phénomènes sociaux de manière à la fois qualitative et quantitative. Les phénomènes sociaux c’est tout ce qui touche à la vie des hommes et des femmes en société. L’Homme en général ça intéresse la philosophie, la psychologie, la biologie mais ça n’intéresse pas la sociologie. Ce qui intéresse la sociologie c’est l’homme collectif, l’homme pluriel dans sa vie sociale. Est ce que l’objet de la sociologie sont les groupes sociaux ? Oui et non. Oui parce qu’effectivement la question de groupe est une question centrale de la théorie sociologique mais on ne peut pas limiter la sociologie à cette dimension parce qu’il y a déjà une discipline qui s’intéresse aux groupes sociaux : l’ethnologie, l’anthropologie. D’autre part parce que la sociologie ne s’intéresse pas seulement aux groupes mais aussi aux individus. Comment la sociologie constitue son objet ? ! #
B) Un objet trouble !
# ! # La sociologie à un problème de base : elle s’intéresse à la fois à un ensemble qu’est la société et en même temps aux éléments qui l’a constitue et les éléments qui constituent l’ensemble sont les individus et les groupes. L’élément de base c’est l’individu. La sociologie c’est l’ensemble de tous les individus qui vivent en société. Cet élément de base a une dimension plurielle, individuelle, culturelle, politique, l’individu lui même est pluriel. Tout le problème de la sociologie c’est de construire un domaine particulier qui serait celui du social, qui permettrait de rendre compte de la vie collective des individus en société. Cette dimension sociale a mis beaucoup de temps à émerger, il faudra attendre le XIXème siècle pour que cette notion de sociale émerge. La sociologie scientifique va apporter la réponse suivante à propos du paradoxe individu/société : ce n’est pas l’individu ou le groupe qui intéresse la sociologie, ni l’individu ni le groupe qui construit l’élément de base du système social, ce qui intéresse la sociologie c’est quelque chose qui se trouve dans l’individu et dans le groupe. Yves Barel «"Ce quelque chose est ce part quoi les individus et les groupes intervient dans la structure et le fonctionnement de la société, c’est à dire leurs rôles sociales, la catégorie dans le sociale remplace les individus et groupes concrets comme élément de base du système social"». Il existerait une sorte de mise en scène sociale ou les acteurs sociaux ne sont que les acteurs de leurs fonctions. L’objet de la sociologie c’est un individu représenté par ses rôles sociaux dans son rapport à un système social qui est lui même représenté par des institutions. ! #
C) Un objet scientifique !
# L’histoire de la sociologie a aussi un rapport au pouvoir de la pensée. C’est un agent de pouvoir dans la pensée parce que c’est l’histoire de la sociologie qui fixe les cadres, les références, la langue et de la méthode. La sociologie en tant que science sociale ne veut et ne peut pas se confondre avec ce que Bourdieu appelait la sociologie spontanée. La sociologie spontanée est faite par les médias et les politiques mais aussi par les individus. On est tous spécialiste de la société car on y vie. La sociologie scientifique doit se distinguer de ce type de connaissance spontanée. On a tous des idées sur la société. Ces idées ne peuvent pas prétendre au titre de socio-vie. Pourquoi le sociologue aurait le monopole ? La philosophie n’est que de la théorie il manque de l’empirie. C’est un discours généralisant sur la société. La société ce n’est pas un objet scientifique comme les autres à la différence des autres sciences. L’objet de la sociologie c’est un objet qui rentre dans le domaine de la relation et c’est précisément le problème, dans le domaine des relations humaines on peut s’imaginer que nous sommes tous experts. Pour défendre et affirmer son monopole de compétence sur la société, la sociologie va d’abord rompre avec la sociologie spontanée pour construire son objet. Pour cela elle va condamner le subjectivisme («"moi je pense que…"») pour prétendre faire science et comme dirait
Durkheim elle va «"observer les faits sociaux comme des choses"». Pour y arriver elle va défendre des méthodes d’observation, d’analyse et elle va permettre de réunir ces observations et ces analyses pour construire un domaine scientifique qui va se construire en évoluant, c’est à ce titre que l’histoire de la sociologie fixe les cadres. C’est un agent de pouvoir et d’autorité scientifique. C’est d’abord une école de pensée sociologique qui fabrique/forme les spécialistes de la pensée sociologique. C’est une école qui apprend à penser sociologiquement et pour cela il faut avoir lu les sociologues comme Bourdieu, Durkheim, Weber. C’est comme ça que se forme un savoir. Les théories se suivent, se construisent et créent des controverses et cela fait avancer le savoir. Pour faire de la sociologie il faut discuter avec d’autres sociologues pour rentrer dans le cadre.! #
D) Une discipline et une intervention !
# L’histoire de la sociologie est une tradition. Pour devenir sociologue il faut se faire gardien de cette tradition, il faut défendre l’institution du langage sociologique. Il y a des styles de langage dans une même langue. Pour être sociologue faut il se contenter de répéter ce que dit la tradition sociologique ? Non, car sans innovation l’histoire s’arrêterait. Il faut s’inscrire dans la tradition. Il y a beaucoup plus de suiveurs que de vrais créateurs (redite). Il y a toute une part de la sociologie liée à la créativité. Il y a une partie de la sociologie très proche de sa propre tradition donc assez fermée et une autre part de la sociologie plus créative qui tire ses sources de l’humanisme. En même temps, il est incontestable que parmi les père fondateurs de la sociologie beaucoup se voulait des maitres penseurs qui défendaient un ordre moral de la société. Avant la seconde guerre mondiale, les études de psychologie et sociologie relevaient des sciences morales. Ces penseurs de la morale étaient des gens conservateurs et avaient souvent des rapports privilégiés avec l’état pour préserver l’ordre moral de la société et leurs projet étaient même de faire la sociologie la langue officielle d’un état idéal en réconciliant l’individu et le système social d’ou l’importance de thèmes centraux comme l’intégration, le lien social, la division du travail social. D’une certaine manière cette thématique là nous parle d’une dimension d’ordre dans la société, d’ordre sociale parce que la sociologie a la prétention de nous dire ce qui permet d’ordonner les relations en sociétés. C’est une sorte de tribunal de la raison, elle n’est pas la seule à prétendre à ce rôle, d’autres disciplines comme la philosophie la psychanalyse, les Sciences Economiques se disputent ce privilège mais la particularité de la sociologie c’est la prétention à comprendre l’ensemble du langage de la société et d’être à ce titre un garant ou un agent moral dont l’expertise serait essentielle aux yeux de l’état. Il y a toujours eu un rapport de pouvoir avec la sociologie. Aujourd’hui la sociologie n’est plus tellement la science qui est mise en avant. Les économistes sont les conseillés du prince (mis en avant). Il y a une concurrence entre les différentes sciences sociales. ! ! ! ! !
Roles
Individus
! ! !
Société Groupes
Institutions
# On doit le terme sociologie à Auguste Comte qui est l’inventeur du terme et qui pensait que la sociologie était une discipline vouée à diriger toutes les sciences sociales, qui étaient faites pour «"couronner le rôle des science sociale" ». Pour lui, la sociologie est une disciple reine des sciences sociales. Aujourd’hui la discipline reine est l’économie. Au début, Auguste Comte voulait appeler cette science «" physique sociale" » parce qu’il pensait que cette science devrait permettre de comprendre les lois évolutives des sociétés humaines ( il ne l’a pas appelé comme ça car il n’aimait pas le savant belge qui avait utilisé ce terme. Il a donc préféré le mot sociologie. Ce coté de la sociologie est un coté scientiste de la sociologie. Fort heureusement il y a une
tradition de la sociologie qui est beaucoup plus ouverte, imaginative, moins scientiste, comme Simmel, Gabriel Tarde, Marcus, Edgar Morin qui font partie de l’histoire de la sociologie. Ce sont des grands noms mais en même temps des marginaux. Souvent d’ailleurs, ce sont les marginaux qui font avancer la science, ce sont les vrais acteurs de l’innovation. Edgar Morin, Sociologie, «"La fécondité scientifique extrême c’est à dire la découverte, relève évidement de ce facteur personnel mystérieusement nommé génie mais il y a des conditions favorables à la découverte et souvent ce sont les marginaux et non pas les intégrés (dans les grandes organisations, les grandes entreprises, les grands systèmes) qui produisent les plus grandes découvertes. Le marginal cela peut être aussi bien l’isolé, le solitaire, l’amateur. La marginalité peut être une disposition psychologique ou le résultat d’une situation de fait. Du progrès scientifique, de la découverte de la théorie peuvent provenir du monde intégré de l’université, de l’industrie, de la science, mais l’en dehors, le rejeté demeure grand pauvoyeur en innovation. On sait qu’à leurs manières Marx, Freud ou Einstein furent des marginaux dans la matière même ou éclate leurs génies en matière de sociologie, il y a un champ de marginalité vaste et indéterminé et le reporter de journal peut être un sociologue à l’état sauvage" ». Jusqu’à la création de la licence de sociologie, au début des années 60, tous les sociologues furent formés marginalement. Est ce que pour autant il faut glorifier la marginalité ? Il y a eu des périodes (années 68-70) où on pensait la sociologie de manière très engagée. !
2. Des humanités aux sciences sociales! # La sociologie ne va triompher qu’à la fin du XIXème siècles, elle a tout un héritage humaniste qui est celui des humanités classiques qui sont issues de la renaissance. Les sciences humaines vont ensuite venir. Gusdorf Georges fait reposer la naissance des sciences humaines au XVIIIème siècle car c’est à l’époque où la notion de condition humaine et donc condition de l’homme est rendue possible du fait du recul des religions et du fait d’un progrès des sciences en générales. Ce sont ces conditions qui font que les sciences humaines sont filles de la modernité. ! #
A) Caractère de la modernité!
# La modernité c’est aussi une période de l’histoire et c’est une période qui débute au lendemain du Moyen-Age et qui dure jusqu’à aujourd’hui. Aujourd’hui on parle de post-modernité de sur-modernité ou de modernité tardive. On est à l’ère du post. Néanmoins nous traversons une période de crise de la modernité. Il faut souligner aussi que la modernité n’est pas partout. Il n’existe pas pour autant une modernité qu’on retrouverait à l’échelle du monde. Elle n’est repérable qu’en Europe à partir du XVIème siècle. Elle atteint son vrai déploiement à partir du XIXème siècle. La modernité est en opposition à la tradition c’est à dire aux culturelles antérieures, archaïques. La modernité face à la diversité des cultures géorgraphiques et symboliques, des anciennes cultures, la modernité s’impose comme cadre unique. Ce cadre unique sera vu comme le phare de l’occident qui illumine le monde. ! La dimension culturelle : ! # La modernité valorise le changement. La modernité est avant gardiste. Elle s’impose dans une sorte de fuite en avant continuelle et c’est à travers ce changement permanent qu’elle arrive à dépasser les contradictions de l’histoire. A travers cette dimension culturelle c’est le progrès de l’humanisme qui propose à l’homme de devenir maitre de sa condition puis maitre du monde grâce aux lumières de la raison et donc à travers une prise de conscience scientifique de toutes les dimensions de la réalité. Cette prise de conscience scientifique va permettre une conquête de la nature qui va permettre d’organiser le monde à l’image de l’homme et par la mise en oeuvre de techniques qui sont liées à des projets. Cette dimension culturelle de la modernité, il s’agit là d’une représentation rationnelle, claire, cohérente du monde. Ce qui va permettre cette révolution culturelle c’est le progrès continu des sciences mais aussi le développement des modes de production. Tout cela va marquer la modernité comme l’air de la grande transformation du monde et de ses représentations. La capacité de transformer le monde est inédite et n’a jamais existé dans l’histoire de l’humanité. ! La dimension politique : !
# La modernité va mettre fin à la société traditionnelle en détruisant des anciennes communautés qui étaient souvent enfermées dans une culturelle théologique. La modernité va faire disparaitre cette société traditionnelle pour promouvoir la société moderne des individus. Il y a deux piliers de la modernité : l’individualisme moral et la rationalisation. C’est sur ces deux piliers que s’appuie un nouvel ordre politique qui s’impose au nom du règne et de la raison ou encore au nom du sens de l’histoire. «" Nous sommes ce que nous faisons" » c’est l’idée la plus forte de la modernité. Il ne tient qu’à nous de nous en sortir, avant ce n’était pas possible, celui qui était né pauvre le restait car c’était l’ordre de Dieu. Cette idée est qu’il y a une correspondance entre la conscience de soi et l’action sur le monde. En jouant son rôle on devient un personnage responsable qui est en capacité d’entrer dans le domaine de droit universel. Cette correspondance entre rôles et institutions / individus et collectif est favorisé au nom de l’universalité d’une conception rationaliste du monde et ce qui permet d’assurer cette correspondance c’est d’une part le droit des individus et le droit à l’éducation. Ce qui va permettre d’émanciper les consciences et de créer de véritable citoyens. C’est le règne de la raison contre celui des passions irrationnelles qu’il faut garantir par la loi, l’éducation. C’est le règne de la raison qui va permettre de construire de vrais citoyens. La modernité c’est l’idée de société conçue comme un état de droit. L’état de droit c’est un ensemble d’institutions qui fonctionne selon les principes de droits universels qui vise les individus. C’est le principe d’ordre et d’intégration. Le progrès est de construire l’homme libre, libéré de ses préjugés, des schèmes de la tradition des anciens régimes, de la superstition, le citoyen est définit par la loi qui lui reconnait le droit de contribuer à la volonté générale. ! La dimension symbolique et identitaire! # Il y a une promotion de l’individu avec son statut de conscience autonome. L’individu a ses intérêts collectifs autonomes, son logos, il a aussi ses dérives liées aux excès de l’individualisme. La première dimension est la temporalité. Le rapport au temps, sous tous ses aspects, la temporalité moderne va introduire une nouvelle vision du monde en rupture avec les anciennes sociétés. C’est une temporalité qui est très spécifique. Il y a la dimension du chronomètre. C’est le temps moderne. Le chronomètre parce que c’est un temps qui se mesure. L’homme pressé c’est l’homme de la modernité et auquel on mesure ses activités. C’est aussi celui qui organise la division du travail et la vie sociale en générale. C’est un temps qui est abstrait, qui c’est substitué à ce qui existait auparavant, les rythmes des saisons, des travaux et des fêtes. Face à ces rythmes anciens on a substitué le rythme chronométrique lié à la contrainte productive. Cette contrainte productive règne partout. Le deuxième aspect est le temps linéaire : dans la société traditionnelle le temps était cyclique. Le temps moderne n’est plus cyclique il se développe selon une ligne : passé / présent / avenir. Si la tradition était très encrée sur le passé, la modernité est axée sur l’avenir. La troisième dimension est l’aspect historique. L’histoire est devenue avec la modernité une instance dominante. On pense l’histoire avec la modernité. L’histoire est la discipline première de la modernité. Hegel : «"Le rôle de la raison dans l’histoire"». Cette idée de l’histoire est liée au fait que les sociétés s’inscrivent dans un devenir et disent s’accomplir en progressant graduellement, en se transformant graduellement. Toute l’évolution est liée à l’histoire. La modernité se pense historiquement alors que la tradition se pensait mythiquement.! !
! ! ! ! ! ! #
SOCIO
LOGIE
SOCIUS! SOCIETE
LOGOS
!
LOGIQUE DE LA SOCIETE
#
!
#
B) Genèse de la modernité et des sciences sociales !
# Il y a un héritage humaniste dans la sociologie. A savoir quels sont les rapports entre les humanités classiques issues de la renaissance et les sciences sociales élaborées à partir du XIXème siècle. ! L’étude des humanités ! # Le latin humanitas ça signifie culture, éducation ou civilisation, c’est à partir de ce terme la qu’est venu le terme humanisme. C’est un terme de révolution qui va s’opérer à la fin du MoyenAge et qui se veut issu d’une double tradition : hellénistique ou gréco latine, et une tradition judéo chrétienne. L’humanisme c’est une entreprise grandiose par laquelle l’être humain tente de se construire lui même, de s’accomplir lui même, d’assumer sa propre liberté, c’est la conquête de l’homme par lui-même. Cette conquête va placer l’homme au coeur de l’univers. L’homme n’a pas toujours été au coeur de l’univers, avant c’était Dieu. Foucault : «"l’homme est une invention récente"». Une invention de l’humanisme qui triomphe à partir du XVIème siècle. Voici de grands humanistes : Montaigne, Rabelais, Erasme. Auparavant c’était le Moyen-Age, la divinité régnait sur le monde, l’église imposait cette centralitée. A partir du XVIème siècle cette pensée médiévale devient inacceptable pour certains pionniers qui décident de libérer l’individus de ses termes théologiques / religieux. Le libérer d’une forme d’injustice millénaire qui au nom de la raison divine lui impose une position et un rôle sur lequel il ne pouvait pas s’élever. Il a fallu renverser ça. Remettre en cause cet ordre là c’était dangereux car c’était remettre en cause la parole de l’église. On risquait alors la mort. Giordano Bruno, un humanisme brulé. Les humanistes avaient comme défenses leurs plumes et leurs langues. Il fallait donc avancer masqué. Ils ont commencé par transformer l’idée même de tradition. La conception médiévale était une conception ecclésiastique / religieuse et plus précisément juridico-théologique. Les humanistes vont procédés en inventant la critique philologique (c...
Similar Free PDFs

CM Histoire de la Sociologie
- 32 Pages

CM Sociologie de la déviance
- 25 Pages

CM Sociologie de l\'éducation
- 16 Pages

Cm histoire de l\'EP
- 38 Pages

Histoire de la psychologie CM 1
- 4 Pages
![CM sociologie complet [3564]](https://pdfedu.com/img/crop/172x258/xw2peolo59r5.jpg)
CM sociologie complet [3564]
- 22 Pages

CM Les grands courants de sociologie
- 21 Pages

CM Histoire des médias audiovisuels
- 38 Pages

Cm 2 histoire - Notes de cours 2
- 3 Pages

Sociologie de la modernité
- 29 Pages

Sociologie DE LA Musique
- 9 Pages
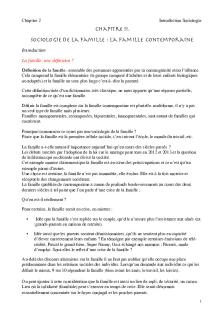
Sociologie de la famille
- 30 Pages

Sociologie de la famille
- 11 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu


