Résumé de cours : sociologie de la jeunesse PDF

| Title | Résumé de cours : sociologie de la jeunesse |
|---|---|
| Course | Sociologie |
| Institution | Université Clermont-Auvergne |
| Pages | 6 |
| File Size | 217.9 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 9 |
| Total Views | 166 |
Summary
Résumé de mes cours de sociologie sur la thématique de la jeunesse ( comprend des extraits de livre...)...
Description
Sociologie : La jeunesse *Introduction : « Les âges de la vie » L’âge est une réalité biologique mais aussi sociale. - Il est d’abord une réalité biologique qui permet d’expliquer certaines différences dans les modes de vie (capacités intellectuelles qui varient selon l’âge…), de ces constatations est né un découpage biologique de la vie. (Naissance, croissance, corruption, mort) -Ces âges de la vie font références également à des statuts sociaux ou professionnels. Ils ne sont pas seulement fondés sur le développement biologique mais aussi sur des représentations sociales qui évoluent au cours de l’histoire et qui changent selon les cultures (ex : Dans de nombreuses sociétés, se marier faisait des individus des adultes). Hors de nos jours, l’âge adulte dépend à la fois de la majorité civile (18 ans) et de la prise d’autonomie des individus mais leur dépendance financière visà-vis des parents fait perdurer la relation parent/enfant. => Les statuts familiaux et professionnels ainsi que le contexte historique sont donc tout aussi important que l’âge biologique pour situer un individu dans une classe d’âge. Dans la 2nd moitié du 20ème siècle, on a vu émerger la jeunesse comme catégorie sociale et simultanément comme question voire problème social. Cette classe d'âge a pris son autonomie progressivement comme le décrit Olivier Galand (les jeunes) en partant des années 50-60 avec les « blousons noirs », en passant par la révolte étudiante de 68 jusqu’à aujourd’hui. I-
Le concept d’« enfance » travers l’histoire :
Philippe Ariès dans son livre « l’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime » cherche à définir comment s’est construit la conscience de la particularité de l’enfant à travers l’histoire, il distingue ainsi : -Le premier sentiment de l’enfance ou « mignotage » qui est apparu dans le milieu familial -Les hommes d’églises, moralistes (ceux qui réfléchissent l’éducation) vont se préoccuper de l’enfant et de leur instruction progressive. Il termine son ouvrage sur le sentiment de la famille et le développement du sentiment de l’enfance qui s’accompagne d’une transformation de la famille. La famille nucléaire et les sentiments qui en assurent la cohésion remplace le lignage. Au 18ème siècle, le droit d’aînesse est remis en cause au profit de l’égalité entre les enfants. Selon Ariès cela correspond à un « glissement de la famille-maison (pour suivre la lignée, transmettre des biens) vers la famille sentimentale moderne (la famille se restreint aux enfants et aux parents, l’unité est les liens affectifs) 1) Enfance et société traditionnelle -La société moderne se représentait mal l’enfant, l’idée d’enfance était liée à l’idée de dépendance lorsque l’enfant ne peut pas suffire à lui-même. C’était un passage de la vie sans importance où le problème consistait à survivre. De très petit enfant, on devenait un homme jeune sans passer par d’autres étapes. -La socialisation et la transmission des valeurs n’est pas souvent assurée par la famille car l’enfant est très vite éloigné des parents pour aller vers l’apprentissage. On ne gardait pas ses enfants, on les envoyer pour être formé chez d’autres. La famille était une réalité morale plutôt que sentimentale.
2) L’enfance reconnue pour elle-même : -A partir de la fin du 17ème siècle, l’école s’est progressivement substituée à l’apprentissage, l’enfant a cessé d’apprendre la vie au contact des adultes. C’est la conséquence du succès des institutions scolaires qui s’était structurées au cours du moyen-âge et en particulier à partir du 15ème siècle. On parle désormais de devoir des parents concernant l’éducation de leur enfant et la famille commence à devenir un lieu d’affection. -Fin 18ème, 19ème, l’enfant devient l’objet d’un attachement spécifique qui ne va faire que croire avec les progrès de la médecine. L’enfant est désiré, on construit un culte de la maternité et la bourgeoisie se préoccupe de plus en plus de l’instruction des enfants. -Au 20ème siècle, avec la baisse du taux de mortalité, la perte de l’enfant devient plus douloureuse. L’enfant est davantage désiré pour lui -même, sa place est plus importante dans l’affecte parentale. C’est dans ce concept que s’est développé la psychologie de l’enfant et sa psychanalyse. -Françoise Dolto a eu un rôle très important dans la popularisation des théorie psychanalytiques en ce qui concerne les enfants. Grâce à une émission sur France Inter de 1976 à 1978 « Lorsque l’enfant paraît », elle modifie la manière de penser l’enfance et la pédagogie. Selon elle : -L’enfant y compris le nourrisson doit être considéré comme une personne. Il cherche à communiquer et exprime un désir qui lui est propre. Il faut prendre le temps de lui expliquer les choses et d’obtenir si possible son consentement. -Les gestes, mots des enfants sont toujours porteurs de sens (suite du travail de Freud). Il faut y être attentif pour comprendre le développement de l’enfant. -Elle invente le concept d’image inconsciente du corps. Elle distingue deux étapes fondamentales par rapport au corps : 1- Mise en place du schéma corporel = place du corps dans l’espace 2-Image inconsciente du corps = expérience du miroir, appropriation de son image. -Pour respecter, préserver et assurer la liberté de l’enfant, il faut lui dire la vérité et veiller à l’accord entre ce que l’on dit et ce que l’on fait. -Elle compare l’adolescence au complexe du homard c’est-à-dire que l’enfant doit se débarrasser d’une carapace trop petite pour une nouvelle mais c’est un passage risqué où il devient plus vulnérable. 3) L’enfant et les changements familiaux : Les liens familiaux n’ont pas disparu, ils ont évolué. La famille n’est plus de type patriarcal, on est passé de la famille traditionnelle à la famille moderne et nucléaire. Au sein de la famille, les relations affectives dominent sur les rapports d’autorité, le couple entretient un rapport différent à l’enfant. La famille est plus resserrée sur elle-même et entretient des sentiments amoureux ou affectifs. Par conséquent l’enfant est davantage au centre des préoccupations, il est voulu voir programmé, il est le résultat d’un choix. Cela s’accompagne aussi de la transformation de la place de la femme dans la famille et dans la société : -la femme a un accès plus facile à la contraception -la femme peut plus facilement entrer dans le monde du travail. L’enfant acquiert un statut juridique, on lui reconnaît des droits spécifiques et on s’inquiète de sa vulnérabilité, il n’est plus seulement celui qui assurera la transmission d’un patrimoine.
4) Vers le culte de l’enfant roi ? : La place de l’enfant aujourd’hui reste assez ambivalente. D’un côté l’enfant est devenu sujet de droit et de l’autre il n’est pas considéré comme adulte et doit être protégé. D’un côté, on cherche à agir dans son intérêt, de l’autre il est soumis à la tutelle des parents. Le phénomène de l’enfant roi est assez récent mais le fils ainé dans le passé n’était pas dans une place similaire ? C’est un phénomène social lié à un certain contexte. L’enfant roi est l’enfant qui prend une place écrasante dans la famille du fait du surinvestissement affectif dont il est l’objet. *Causes qui expliquent ce phénomène : -situation familiale qui le favorise : divorce, maladie, conflit conjugal -les enfants ne sont pas responsables de ce surinvestissement bien qu’ils profitent bien souvent de la situation. Ils sont le moyen de combler le manque d’amour, de réussite sociale. => L’enfant roi c’est celui qui n’est plus à sa place d’enfant mais qui est l’égal des adultes. Certes il commande mais il subit le désir des autres. La société de conso à tendance à s’adresser à ces enfants. On oublie ce que l’enfant à de spécifique, il n’est pas encore apte à décider de lui-même, il a besoin de repères à travers l’autorité des parents. Sans cela, il ne fait pas l’épreuve de la frustration importante du principe de réalité pour son développement affectif ce qui risque de provoquer une difficulté à trouver sa place, à communiquer, à partager, à se s’obliger = s’imposer quelque chose à soi en toute liberté). Ce phénomène n’est toutefois pas dominant mais une dérive possible. II-
L’adolescence : une période de transition : 1) Le statut social de l’adolescence : On peut situer l’adolescente entre 11 et 16 ans, elle correspond à des changements biologiques et psychologiques bien déterminées mais elle demeure une notion socialement construite. Il faut distinguer adolescence de puberté. -L’adolescence est une période de vie qui signe un passage du statut social d’enfant à celui d’adulte. Bien que la tranche d’âge concernée corresponde en partie il y a 2 perspectives différentes : -L’adolescente est à la fois ce qui termine l’enfance et ce qui commence l’âge adulte -Elle désigne le statut de celui qui est en train de grandir, un état transitoire de passage (situation instable, précaire) Les changements les plus importants durant cette période sont : -Morphologiques (seins, règles…) -Apparition d’une nouvelle manière d’appréhender le monde extérieur, de se représenter les choses -Aptitude à être davantage autonome, à prendre ses décisions seuls même s’il n’y a pas de véritable indépendance. -Période où s’effectuent des choix de scolarité ayant des conséquences sur l’avenir -Découverte de la sexualité et ses modifications sur la vie affective et relationnelle. -Age de recherches nouvelles parfois dangereuses ou interdites -Age de conflit plus ou moins important avec les parents ou les autorités en général L’adolescence n’est pas un concept ancien, elle a plutôt commencé à se développer au 19ème siècle. Dans beaucoup de sociétés primitives, il existait des rites initiatiques qui accompagnaient ce passage à l’âge adulte mais la reconnaissance est récente et dépend en particulier de la scolarisation plus longue. Les aspects biologiques et sociaux vont aller de pairs dans cette reconnaissance et semblent interférés l’un avec l’autre. L’adolescence ne cesse de s’allonger (+ précoce et + durable) et physiologiquement, les manifestations de la puberté ont évolué. Il y a un siècle, les jeunes filles avaient leur 1ère règle vers 15 ans, désormais plutôt 12ans. Comment expliquer cela ?
D’une part les conditions de vie ont changées (santé, hygiène, alimentation), le regard porté sur les âges a changé et enfin les conditions socio-économiques ont changés. Cependant, sous le terme « adolescence » se cache des réalités bien différentes : c’est une longue période, on distingue donc : -la prima-adolescence entre 11 et 14 ans à la grande adolescence de 14 à 17ans. -De plus, on vit ces étapes différemment selon son sexe, son individualité (personnalité) et son contexte familial, ainsi que le contexte socio-économique, culturel.
1)
2)
3)
4)
2) Le développement de l’adolescent : Le développement biologique : puberté On fait souvent commencer l’adolescence à la période de la puberté. Les transformations de la puberté qui sont physiologiques et psychologiques sont en partit dû aux effets des hormones et ont pour principale conséquence la pousse des poils, des seins… et une incidence psychologique : les ados se rendent compte que leur corps change et ne maitrise pas forcément les changements. Ils peuvent avoir du mal à les accepter. Le développement social et cognitif : En rentrant dans l’adolescence, les jeunes se voient capable de nouvelles opérations intellectuelles plus abstraites que les enfants. Ils se projettent davantage dans un monde virtuel dont ils tirent des conséquences par leurs comportements réels. Ils se projettent davantage dans l’avenir, organise leur temps mais ils ont encore du mal à maitriser leur imagination, à accepter les limites, les autorités s’imposant à lui. Ils ont du mal à penser à long terme, à ne pas chercher une gratification immédiate. Les relations avec les parents et pairs : On a longtemps pensé que l’adolescence était un passage obligé de conflits avec les parents et les autorités. Rousseau parle de crise surtout pour les garçons. Il est vrai les changements hormonaux importants et rapide ont des conséquences sur les relations parent/enfant en termes de conflit, agressivité et rivalité. Cependant, la cause déterminante n’est pas que physiologique mais cela est lié au contexte social de l’environnement de l’adolescent. Les sujets de conflits sont nombreux mais très souvent liés au quotidien et aux autorités. Cela entraîne des négociations, marchandages, du chantage. Cela dit, si les conflits sont intenses c’est qu’ils révèlent des sentiments complexes : de rejet mais aussi d’attachement aux parents. Voilà pourquoi on peut parler de crise. Les adolescents n’attendent pas la même chose des parents que des pairs. Ils consultent les parents pour les études et les pairs pour l’intimité, la sexualité. Ils cherchent des confidents qui ne les jugeront pas. Certains apprécient aussi le phénomène de bande qui offre un repère identitaire. La « culture » adolescente : S’il existe une culture ado, cela suppose que : -La population ado constitue une unité, que les ados est un sentiment d’appartenance et reconnaissent une unité commune. -Il faudrait que cela se manifeste par des goûts, comportements propres à ce groupe qui les distingue de la culture commune. Cette idée est étrange étant donné que l’adolescence soit une période de transition. La culture ado dépend de l’apparition dans nos sociétés d’une nouvelle catégorie appelée « jeunesse ». Selon Olivier Galand, elle a commencé à se former dans les années 50 et s’est manifesté
clairement dans la fin des années 60 (mai 68). Cela se manifeste par un recul de la forme culturelle classique chez les ados (plus les livres mais les BD…), l’apparition de nouveaux supports de communication (transistors…, et aujourd’hui internet), de l’inscription dans la société de consommation. Cela s’est développé en même temps que la montée des difficultés à trouver un emploi stable, la massification de l’enseignement supérieur et le recul de l’âge de l’union stable. Cela dit, selon les sociologues comme Galand mais même avant Bourdieu, le mot jeunesse cache des réalités différentes selon les contextes socio-économiques. Il n’y a donc pas vraiment de population jeune homogène. (Jeune dans les quartiers # jeunes qui sont chez leur parents et font des études). De plus, la reproduction sociale théorisée par Bourdieu est un phénomène qui demeure et persiste. Les inégalités augmentent et favorisent cette persistance. Les raisons sont multiples : massification de l’enseignement sup, augmentation des effectifs pas favorable à ceux en difficultés, le savoir académique reste privilégié, … 5) Adolescence et conduite à risque : L’adolescence est la période des essais, des expérimentations ce qui peut se manifester par des prises de risque + ou – inconsidérés. Il s’agit d’apprendre ce qu’est la liberté en s’émancipant c'est-àdire en refusant de se soumettre aux autorités, aux règles, limites qui représentent le principe de réalité. Ces risques concernent en 1er lieu la santé physique, mentale, son entourage, son parcours scolaire et ses relations sociales. Les effets se font ressentir à plusieurs niveaux : -Niveau physique : blessures, handicaps, maladie voir mort -Niveau psychologique : traumatisme psychique, décompensation, -Niveau social : atteinte de l’image donc difficultés d’insertion sociale et professionnelle voir marginalisation et exclusion. Les conséquences des prises de risque peuvent être immédiates ou différés. On peut dire que tous les ados ont un jour prit un risque mais les prises de risque ne sont pas toutes équivalentes en termes de gravité. Attention : Prise de risque / Conduite à risque Prise de risque : L’ado se met en danger au cours de certains essais. On parle de l’adolescence comme une période ordalique. Ordalie = série d’épreuve imposées dans certaines sociétés traditionnelles (souvent aux garçons pour témoigner de leur force). L’ado se sent invulnérable mais il veut aussi se mettre à l’épreuve, se prouver des choses et s’intégrer au groupe. -Conduite à risque : Comportements ancrés dans le quotidien, habituels qui mettent leur vie en danger. On parle de troubles préoccupants quand cela interfère sur la vie de l’ado (santé, scolaire.), ou que cet état s’installe dans le temps ou que ces comportements se répètent. Constats de l’enquête auprès des jeunes : -Après 10ans de baisse régulière de la conso de tabac, cette tendance repart à la hausse. -L’alcool est la substance psycho active la plus consommé chez les jeunes. (80% ont bu durant les 12 derniers mois) mais il y a peu de conso quotidienne. Il y a différents types de rapports à l’alcool : l’alcoolisation ponctuelle forte (au cours d’une même occasion) et la recherche de défense. -La conso de cannabis est stable mais importante. Les autres drogues sont moins consommées mais en hausse malgré tout (poppers, cocaïne.)
=> Ces conso chez les jeunes sont liés à un contexte à l’origine festif, dans un cadre convivial afin de se désinhiber, de se sentir appartenir au groupe. B) Le rapport au corps : Dans la plupart des prises et conduites à risque, le corps de l’adolescent est central. Son corps se transformant, il a du mal à se l’approprié. Se développe des formes de scarifications par lesquels l’ado fait l’épreuve de sa résistance à la douleur ou se coupe de son propre corps étranger à luimême. Le regard des pairs est primordial à cet âge où on attend de ces derniers de la reconnaissance. Les ados cherchent à s’exprimer par leurs corps tout en se méfiant ou en le modifiant eux-mêmes. (Ex : la mode, le choix d’un style, piercing…) Avant, les sociétés de traditions judéo-chrétiennes chercher à occultés le corps, depuis la montée de la société de conso, la libération des mœurs (après-guerre), on développe un nouveau rapport au corps : on le soigne, on l’embelli et on cherche à le garder jeune au point qu’on parle de tyrannie de l’apparence corporelle qui n’est pas sans effet sur les jeunes : culte de la minceur, muscles pour les hommes....
Similar Free PDFs

Cours de sociologie
- 34 Pages

Sociologie de la modernité
- 29 Pages

Sociologie DE LA Musique
- 9 Pages
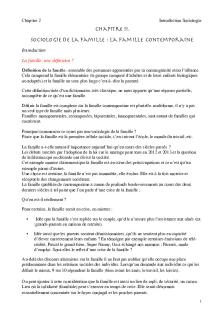
Sociologie de la famille
- 30 Pages

Sociologie de la famille
- 11 Pages

Domaines de la sociologie
- 45 Pages

Sociologie DE LA Deviance
- 18 Pages

Sociologie de la culture
- 40 Pages

Sociologie - Notes de cours 1-10
- 54 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu






