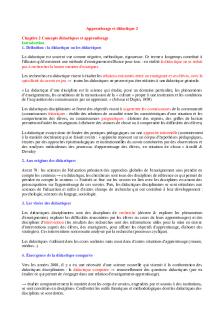Fiche 2 - ville entre utopie et réalité PDF

| Title | Fiche 2 - ville entre utopie et réalité |
|---|---|
| Course | Droit de l'urbanisme Master 1 |
| Institution | Université de Lille |
| Pages | 8 |
| File Size | 500.6 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 6 |
| Total Views | 139 |
Summary
Fiches complémentaires sur les enjeux politiques de la ville, très utile pour compléter le cours magistral donné en amphi...
Description
Q
LA
e2 me
LA VILLE ENTRE UTOPIE ET REALITE
T ABLE DES MATIÈRES Introduction ...................................................................................................................... - 2 1.
Fonctions de l’utopie pour penser la ville ...................................................................... - 2 1.1. 1.2.
2.
Utopies urbaines progressistes .................................................................................... - 4 2.1. 2.2.
3.
Platon...........................................................................................................................- 2 Thomas More ................................................................................................................ - 3 Expérimentations dans le domaine du logement ouvrier ...................................................- 4 Les cités-jardins.............................................................................................................- 5 -
Utopies urbaines et expérimentations socio-architecturales.......................................... - 6 3.1. 3.2.
Les utopies urbaphiles................................................................................................... - 6 Les villes flottantes libertariennes .................................................................................. - 6 -
Conclusion ........................................................................................................................ - 7 Bibliographie .................................................................................................................... - 8 -
QUESTIONS CONTEMPORAINES – LA VILLE – FICHE 2
Tremplin IEP – BP 70076 – 59360 SAINT ANDRÉ LEZ LILLE – [email protected]
-1-
Questions contemporaines – LA VILLE – Fiche 2 Lurson Guillaume
I NTRODUCTION Les critiques adressées à l’encontre des villes ne manquent pas : agencement chaotique, ségrégation urbaine, exclusion des populations, etc. La critique de la ville n’est pas un phénomène contemporain : Rousseau affirmait qu’elles étaient le « gouffre de l’espèce humaine1 », Baudelaire, face aux turpitudes de la vie moderne s’écriait « Horrible vie ! Horrible ville !2 », et Simmel verra dans les grandes villes le lieu du déploiement absolu de « l’égoïsme économique3 ». Faut-il alors fuir la ville, ou tenter de la transformer ? Faut-il la tenir pour un lieu de corruption, et aller retrouver « L’innocence et la générosité indescriptibles de la Nature4 », à l’encontre de la vie étriquée et bruyante des villes artificielles ? Faut-il au contraire cherche à l’améliorer par des politiques publiques d’urbanisme et des mesures sociales ? Il pourrait exister une autre voie pour penser la ville et son organisation : celle de l’utopie. L’utopie signifie, d’un point de vue étymologique, l’absence de lieu. )l pourrait alors sembler paradoxal d’envisager la fonction positive d’une ville qui n’existe pas, au sens où elle reposerait sur une construction imaginaire, voire délirante, de la pensée. Pourtant, le recours à l’utopie pour penser la ville est récurrent : Platon envisageait déjà, dans La république, une cité idéale qui serait débarrassée des vices humains grâce à une organisation politique spécifique. L’utopie pourrait alors avoir une fonction positive, au sens où elle donne à penser ce que la ville devrait être pour faire disparaître les maux dont elle souffre. D’un côté, elle court donc le risque de sa potentielle vacuité, puisqu’elle semble vouée à ne jamais exister. D’un autre côté, elle a pu donner lieu à des tentatives et à des expérimentations concrètes qui ont eu plus ou moins de succès. Ainsi, la ville est un des lieux privilégiés de l’utopie, au sens où elle est le lieu du vivre ensemble et des relations interindividuelles. En ce sens, penser la ville est indissociable d’une réflexion sur l’homme et sur ce qu’il est également nécessaire, en lui, de réformer. Nous nous efforcerons, dans cette fiche, de présenter certaines utopies ainsi que des expérimentations qui en ont découlé. Nous montrerons que toute pensée de la ville, même imaginaire, est inséparable d’une réflexion d’ordre politique. La politique n’est-elle pas avant tout l’art de gouverner les cités polis) en vue du meilleur ? La ville ne doit-elle pas être pensée comme le prototype de l’Etat, et même de toute organisation sociale ? Et l’utopie, si elle semble hors du temps, ne donne-t-elle pas des indications quant au devenir souhaité des villes ?
F ONCTIONS DE L ’ UTOPIE POUR PENSER LA VILLE 1.1. Platon
1
Emile ou de l’éducation, Paris, Folio, 1969, p. 113. « A une heure du matin », Le spleen de Paris, Paris, livre de proche, 2003, p. 83. 3 Georg Simmel, Les grandes villes et la vie de l’esprit, Paris, Petite bibliothèque Payot, 1989, p. 44. 4 H.D. Thoreau, Walden ou la vie dans les bois, Paris, L’imaginaire Gallimard, , p. . 2
QUESTIONS CONTEMPORAINES – LA VILLE – FICHE 2
-2-
L’utopie peut être utilisée afin de penser, hors de l’espace et du temps on parle alors d’uchronie, ce qui pourrait, ou devrait être. Elle a donc une fonction critique, et une fonction normative, bien que son domaine soit l’imagination. Platon, dans La République, mais aussi dans Les lois, met en exergue un double mouvement de croissance possible pour la cité. )l examine, d’une part, la cité « parvenue au luxe5 », et dont la préoccupation principale est l’accumulation de bien pour satisfaire des besoins de plus en plus raffinés. Le désir illimité d’acquérir des biens, que Platon tient pour ancré dans la nature humaine, conduit ainsi à une croissance illimitée de la cité, qui cherche alors, par tous les moyens et notamment la guerre à s’étendre. Or, ce mouvement de croissance risque de détruire la société : les individus, livrés à leurs propres jouissances, ne s’intéressent plus a u bien commun. Il faut donc penser, grâce à l’imagination d’une cité idéale, les différents moyens de contenir ces appétits. Platon envisage ainsi un certain nombre de médiations qui vont permettre une telle limitation : l’éducation paideia) sera la condition pour une vie équilibrée et mesurée. Sur le plan économique, il faut parvenir à un tel équilibre, au risque sinon de dissoudre la cité : celle-ci doit, autant que faire se peut, atteindre une forme d’autarcie6. La ville doit donc fonctionner comme un microcosme à l’image du monde : elle doit être une totalité harmonieuse dans laquelle les risques de discorde et de division sont grandement limités. On peut noter quelques caractéristiques propres à la conception utopique de la cité platonicienne : - L’idéal de vertu propre aux habitants de la cité (voir les Lois, Livre X, qui réclament « justice » et « tempérance » de la part des citoyens). - Une législation parfois assez stricte en matière de mœurs voir par exemple Les lois, livre VI, sur le mariage, ou République X, sur le bannissement des artistes). - Une régulation stricte de la population, dans ses variations internes, et dans ses relations avec l’étranger Les lois, XII). - Une planification du territoire qui répond à des principes mathématiques et géométriques (Les lois, V, afin d’assurer le découpage le plus juste possible.
1.2. Thomas More L’écriture de L’Utopie de Thomas More (1516) est indissociable du contexte historique, caractérisé par le développement de grandes propriétés terriennes et l’accroissement de la misère sociale. L’Utopie doit donc être comprise comme une réflexion sur les conditions politiques d’un bon gouvernement, en accord avec les présupposés humanistes de More. « Utopie » est le nom d’une île qui possède « cinquante-quatre villes grandes et belles, identiques par la langue, les mœurs, les institutions et les lois.7 ». La ville est tenue pour l’unité de base des relations interindividuelles, en tant que communauté prototypique d’un ensemble plus grand. On peut déjà remarquer deux traits constitutifs des utopies : le statut insulaire du lieu, qui accentue sa dimension autarcique, et
5
Platon, La République, II, 372e Le terme vient du mot grec autarkeia, qui signifie l’indépendance, la suffisance à soi. C’est la raison pour laquelle Platon, dans Les lois, IV, avertit sur les risques que court la cité si elle est construite au bord de la mer. 7 Thomas More, L’Utopie, Paris, GF, 1987, p. 139. 6
QUESTIONS CONTEMPORAINES – LA VILLE – FICHE 2
-3-
l’uniformité des modes de vie, sans variations individuelles. Tous les habitants vivent dans des maisons identiques, se nourrissent de la même manière, et ont les mêmes horaires de travail. Une des caractéristiques essentielles de l’organisation des communautés de l’île consiste dans l’abolition de toute propriété privée. D’un côté, les maisons dans lesquels les utopiens vivent ne leur appartiennent pas. D’un autre côté, ils « ne font aucun usage de la monnaie. )ls le gardent pour un évènement qui peut survenir […]. Cet or et cet argent, ils les conservent chez eux sans leur attacher plus de valeur que n’en comporte leur nature propre.8 ». More reprend ici un des topoï des utopies : l’argent, et le désir illimité d’appropriation qu’il génère, sont dénoncés en raison de leur pouvoir corrupteur et dissolvant. Quel remède à cela ? More insiste sur l’éducation des utopiens, qui a pour but de prévenir les excès de tous les genres : la philosophie se réduit ainsi à l’enseignement de la morale, la constitution suffit presque totalement à prévenir les crimes, et le mariage – donc la sexualité – sont encadrés par la loi. Aussi tout est-il pensé pour que les appétits individuels soient contenus et ne puissent menacer l’ordre global de l’île. Enfin, la religion joue un rôle important, au sens où elle permet de juguler les comportements grâce à la croyance de peines ou de récompenses dans l’au-delà. Sur le plan architectural, les villes décrites dans L’Utopie remplissent une triple exigence : de protection (un rempart, un fossé, des buissons, un fleuve), de beauté, et de fonctionnalité (rues larges. Les villes de l’île sont donc pensées afin de favoriser une dynamique interne, mais leur organisation repose aussi sur un contrôle important de la population. Ainsi, « Aucune cité ne doit voir diminuer excessivement sa population, ni davantage se trouver surpeuplée.9 », et de même, les autorisations de visite supposent l’obtention d’un laisser passer. La contrepartie d’une ville parfaite consiste-t-elle dans la clôture de celle-ci, comme dans la limitation extrême des libertés ? A cet égard, L’Utopie morienne demeure ambiguë : le maintien de l’ordre suppose de contenir non seulement les appétits individuels, mais aussi les aspirations de chacun. )l faut bien reconnaître qu’en ce sens, le sacrifice des libertés est exigé, de même que celui de toute mobilité sociale et géographique.
U TOPIES URBAINES PROGRESSISTES 2.1. Expérimentations dans le domaine du logement ouvrier Au X)Xe siècle, l’urbanisation massive, liée au développement du capitalisme et, parallèlement, la paupérisation de la classe ouvrière, deviennent des sujets de préoccupation majeure. La pression démographique fait s’entasser dans les villes une foule d’individus, ce qui amène un certain nombre de complications sociales, hygiéniques, ou politiques. Zola décrit ainsi, dans L’assommoir, ou dans Le ventre de Paris, le tumulte des villes modernes, avec toutes les sensations bruits, odeurs… qui y sont liées. Face aux difficultés que rencontrent les habitants des grandes villes industrielles, tout un
8
Ibid., p. . L’argent n’a pas pour finalité le commerce et l’enrichissement, la chrématistique au sens aristotélicien étant interdite. 9 Ibid., p. . More fait preuve d’une forme de malthusianisme sur ce point. QUESTIONS CONTEMPORAINES – LA VILLE – FICHE 2
-4-
courant d’utopistes socialistes10 va réfléchir à la manière dont il faut repenser l’organisation de la ville : logement, conditions de travail, esthétique, etc. On peut noter que le travail de l’utopie a donné lieu à certaines expérimentations. Les idées de Charles Fourier ont par exemple conduit à la création d’une « Colonie Sociétaire » à Condé sur Vesgre en 1832, bien que celle-ci ait décliné en 1836. Jean Baptiste André Godin11, inspiré par les idées de Fourier, a fondé à Guise à partir de 1859 le « Familistère », ou « Palais social ». Les idées économiques et sociales (association du capital et du travail) de Godin ont trouvé leur réalisation dans la construction d’un ensemble comprenant une usine, des logements ouvriers, des écoles, une bibliothèque, et un théâtre. L’objectif de cet ensemble est de favoriser le progrès social grâce à une amélioration des conditions de vie des ouvriers : le logement doit être « un lieu de tranquillité, d’attraits et de repos12 », et dans le Palais social, « la clarté et l’espace sont les premières conditions de la propreté et de l’hygiène ». L’idée de Godin est que l’organisation de l’espace doit répondre aux exigences d’une vie communautaire harmonieuse et apaisée : la distance entre les logements et l’usine est minutieusement calculée afin que les ouvriers ne se fatiguent pas en se rendant à leur lieu de travail.
2.2. Les cités-jardins Il existe aussi, des utopies urbaphobes, qui prônent, pour les plus radicales, la disparition des ensembles urbains, ou qui revendiquent une intégration de la nature dans les villes. Le concept des cités jardins (garden-city illustre cette tendance, et a été initialement théorisé par l’urbaniste britannique Ebenezer Howard en 1898. Il a donné lieu à certaines réalisations comme à Stains, Suresnes, ou Châtenay-Malabry. A l’origine, ce dispositif a été conçu en réaction aux conséquences sociales de l’industrialisation et de l’urbanisation modernes. )l s’agissait de réintroduire la nature dans un espace qui s’en était débarrassé, afin de gommer les différences existantes entre ville et campagne, vie urbaine et vie rurale. Cet idéal a eu un écho en France entre les années 1920 et 1939, et a servi à la planification de certains quartiers de banlieue. )l s’agissait de proposer des logements de qualité à des prix compétitifs. De plus, la nature n’y est pas envisagée comme simple ornement : elle doit participer de la structuration de l’espace afin de remplir une fonction d’assainissement (potager notamment). Ne retrouve-t-on pas, aujourd’hui, des projets similaires dans les « écoquartiers » ? )l s’agit de réintégrer la nature dans la ville, afin de satisfaire aux préoccupations actuelles concernant l’environnement. Ces éco-quartiers privilégient ainsi la transition écologique et énergétique, ce qui suppose de réfléchir sur les matériaux employés ainsi que sur les modes d’approvisionnement en énergie. L’objectif est également d’assurer une plus grande cohésion sociale ainsi qu’une plus grande intégration citoyenne.
10
Ce terme générique permet de qualifier la pensée d’individus tels que Charles Fourier -1837), inventeur du phalanstère, Robert Owen (1771-1858), Victor Considérant (1808-1893), Etienne Cabet (1788-1856). Ils partagent tous le souhait d’un progressisme social et d’une amélioration du bien être humain. 11 L’inventeur du chauffage en fonte. La société Godin SA a été reprise par une entreprise qui a redressé la marque après la dissolution du groupe en 1968, lui redonnant une place de leader français dans le domaine des appareils de chauffage et des cuisinières de haute qualité. 12 La richesse au Service du Peuple : le Familistère de Guise, Paris, 1874, cité par Françoise Choay, L’urbanisme, utopies et réalités, Paris, Seuil essais, 1965, p. 143. QUESTIONS CONTEMPORAINES – LA VILLE – FICHE 2
-5-
e2
U TOPIES URBAINES ET EXPÉRIMENTATIONS SOCIO ARCHITECTURALES
3.1. Les utopies urbaphiles En tant que production artificielle née de l’activité humaine, la ville fait face à un double destin. Soit ses défauts peuvent être corrigés par l’action de l’homme, c’est-à-dire par l’amplification et l’amélioration des moyens techniques et scientifiques, soit son caractère artificiel doit disparaître au profit de ce qu’elle-même a supprimé : la nature. La première solution a donné lieu à des utopies célébrant la beauté et la puissance de la modernité. Déjà, le mouvement artistique du futurisme louait cette transformation, lorsque Marinetti écrivait : « la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle : la beauté de la vitesse. » (Manifeste du futurisme, 1909). Iannis Xenakis a ainsi conçu un modèle de ville faisant de la verticalité le principe de l’architecture nouvelle, en voulant fonder la « Ville Cosmique verticale ». Il imagine des transports aériens qui permettront de libérer les villes des encombrements qu’elles rencontrent, en rompant avec leur ancrage terrestre. Celui-ci défend alors l’idée que la ville du futur doit se caractériser par une logique qui rompt avec l’horizontalité de l’urbanisation, et qu’elle doit laisser place à la gestion électronique des activités économiques. Ainsi, « Le paysan classique […] devra disparaître. »13, pour laisser place à d’autres secteurs d’activités plus en lien avec les transformations modernes des sociétés.
3.2. Les villes flottantes libertariennes Les utopies de la ville, toutefois, n’ont pas disparu. Elles servent encore d’idéal régulateur dans certains projets urbanistiques, mais aussi dans certains courants de pensée. On peut ainsi mentionner le projet Seasteading, qui découle du cofondateur de Paypal, et qui repose sur l’idée d’une « ville flottante » possédant une indépendance économique absolue14. Ce projet est soutenu par des libertariens, qui appartiennent à un courant prônant un Etat minimal et un libéralisme économique très affirmé15. Le projet se veut expérimental et respectueux de la liberté de chacun, idée soutenue par Robert Nozick lorsque celui-ci refuse « une société statique et rigide16 », et qu’il envisage la fonction positive de l’utopie dans la constitution d’un projet politique. Quelle liberté, cependant, s’agit-il de défendre ? N’est-ce pas la seule liberté économique ? Le projet des villes flottantes n’est-il pas d’échapper à l’Etat, et par là même à toute régulation ? Dans Anarchie, Etat et utopie, Nozick défend l’idée que les principes de la coopération dans une société libérée de la mainmise de l’Etat pourraient donner lieu à des formes très diverses : on pourrait autant tout mettre en place une société communiste qu’une société capitaliste. Mais l’exemple du projet Seasteading montre que, paradoxalement, les conditions d’une telle liberté sont
13
Cité par Françoise Cholay, op. cit., p. 339. Xenakis a été le collaborateur de Le Corbusier pendant plus de 10 ans. N’est-ce pas ce modèle de ville que les dystopies reprennent systématiquement ? 14 Voir l’article suivant : http://www.slate.fr/story/49727/INTERNATIONAL-villes-flottantes-libertariensmarxistes-droite 15 Bien que ce terme ne soit pas toujours très clair, puisqu’il peut s’appliquer aussi à des courants de gauche. Dans sa version la plus radicale, le courant libertarien devrait plutôt être appelé « anarcho-capitaliste ». 16 Anarchie, Etat et utopie, Paris, PUF, 1988, p. 399. Robert Nozick fait partie des libertariens de droite.
-6-
QUESTIONS CONTEMPORAINES – LA VILLE – FICHE 2
NT AN
essentiellement économiques, et que tout le monde, de fait, ne jouit pas du même degré de liberté. Plus encore, ne s’agit-il pas du fantasme d’une autarcie absolue, qui a pour prix l’isolement vis-à-vis du reste du monde ? Le caractère artificiel d’un tel projet a pour contrepartie la négation de tous les liens culturels, historiques, politiques, qui donnent aussi à une ville son identité et son unité. Le projet de Seasteading résume bien les contradictions inhérentes à toute utopie, en plus des difficultés réelles qu’il rencontre pour sa réalisation.
C ONCLUSION )l se pourrait néanmoins que l’utopie soit une manière très limitée de concevoir les villes, au sens où, en dehors du caractère purement fant...
Similar Free PDFs

Fiche Histoire et com 2
- 10 Pages

Fiche FTN et mondialisation
- 3 Pages

Entre enracinement et crise
- 6 Pages

Fiche ressource DN et DV
- 1 Pages
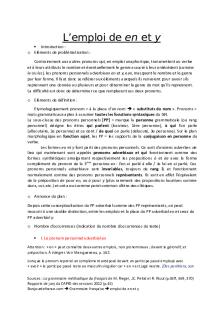
Fiche Grammaire En et Y
- 3 Pages

Difference entre micro et macro
- 4 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu