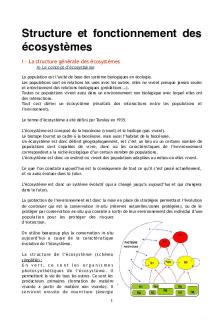La couverture des baies et des surfaces PDF

| Title | La couverture des baies et des surfaces |
|---|---|
| Course | Architecture |
| Institution | Université Clermont-Auvergne |
| Pages | 6 |
| File Size | 239.5 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 81 |
| Total Views | 155 |
Summary
Cours de filière archéologie/Architecture....
Description
VOCABULAIRE ET TECHNIQUES DE L'HISTOIRE DE L'ART: ARCHITECTURE LA COUVERTURE DES BAIES ET DES SURFACES
I. GÉNÉRALITÉS La couverture, qu'il faut bien distinguer du couvrement, est un ouvrage qui couvre et protège extérieurement une construction. On distingue quatre grands types de couvertures dans l'architecture ancienne: ➢ la terrasse, ou plus exactement la couverture en terrasse (la terrasse étant au sol) ➢ la voûte ou la coupole (dans certains cas): lorsque l'extrados est utilisé en couverture ➢ le toit: couverture à versants, reposant sur une charpente. L'ensemble des toits d'un bâtiment constitue sa toiture ➢ la flèche: couverture de plan centré, très développée en hauteur. 1. LA COUVERTURE EN TERRASSE (ou TERRASSE DE COUVERTURE) Depuis l'Antiquité, de nombreux bâtiments reçoivent une couverture horizontale. Le toit est parfaitement plat, ou légèrement incliné. Dans les régions pluvieuses, la toiture en terrasse doit être munie d'un système de captage et d'évacuation des eaux par des gouttières. Exemple: Penthouse apartment, résidence Meghna, Bengladesh (appartement de luxe au dernier étage d'un immeuble)
2. LA VOÛTE OU LA COUPOLE Ce sont normalement des ouvrages de couvrement, qui sont eux-mêmes couverts d'une terrasse, d'un toit à versants ou d'un toit en dôme. Mais dans certains, c'est l'extrados -soit la face supérieure et arquée de l'arc, ou de la coupole- qui est construit à l'air libre en forme de couverture. Ainsi couvrement et couverture ne sont alors qu'un seul et même ouvrage. Exemples: ✗ Coupole du Panthéon à Rome. La rotonde est couverte d'une coupole dont l'extrados sert de couverture. Le pronaos est couvert d'une charpente qui soutient un toit à deux versants. ✗ Coupole du temple de Mercure à Baïes (Campanie, près de Naples: architecture romaine) ✗ Coupole de pierre de la cathédrale de Périgueux 3. LE TOIT Le toit est une couverture de bâtiment (ou de corps de bâtiment) constituée d'un
ou plusieurs versant(s) qui repose(nt) sur une charpente. Le toit couvre un espace de comble qui peut être aménagé (étage de comble) ou inhabitable (on parle alors de comble-perdu). ATTENTION! Ne pas confondre le comble, la charpente et le toit. L'un des versants du toit peut être prolongé: c'est l' avant-toit (ou auvent), qui protège l'espace avant. Les toits peuvent être composés d'un, de deux, ou de plusieurs versant(s). Mais il existe des toits coniques (tours), de forme pyramidale, polygonale, ou encore arrondis: le dôme hémisphérique distinct de la coupole est un type de toit. L'ensemble des toits d'un bâtiment constitue sa toiture. Exemple: vue aérienne de la toiture du corps principal du château de Chambord. Le toit peut couvrir l'extrados d'une voûte ou d'une coupole (architecture religieuse). Exemple: toiture de la cathédrale de Strasbourg. Les croisées d'ogives de la nef et des bas-côtés sont couvertes par des toits de formes variées. 4. LA FLÈCHE C'est une couverture de plan centré et très développée en hauteur. Elle peut être de plan carré, polygonal, circulaire, etc, mais toujours symétrique par rapport à un point central. Certaines flèches sont même de forme rhomboïdale (les faces sont des losanges) ou torse. On distingue deux types de flèches: ➔ la flèche à charpente (de bois ou de métal), qui est un toit ➔ la flèche en pierre (de taille), éventuellement renforcée d'une armature métallique, qui est une voûte (couvrement maçonné, cf. voûte). Les flèches sont souvent disposées au-dessus d'un clocher ou d'une tour. 5. LES PETITES COUVERTURES EN SURPLOMB A. Le auvent C'est une couverture construite en surplomb devant une fenêtre, une porte, devant une façade, etc. Il protège à la fois la baie et son accès. B. La marquise C'est un auvent en charpente métallique vitrée. II. LA FORME DES TOITS 1. LE TOIT PLAT (OU PRESQUE...) Ce n'est pas une couverture en terrasse, mais un toit à pente très douce, qui est caché par les parties hautes des murs. Exemple: toits plats du château de Saint-Germain-en-Laye. 2. LE TOIT À UN SEUL VERSANT (OU APPENTIS) C'est un toit couvrant un bâtiment ou corps de bâtiment par un appentis. 3. LE TOIT À DEUX VERSANTS C'est un toit à deux versants, terminés à leurs extrémités par des murs-pignons. 4. LE TOIT À CROUPES C'est un toit à deux longs versants (appelés les LONGS-PANS), terminés par des croupes, c'est-à-dire des petits pans de toit qui effectuent une liaison.
Les toits à croupes sont très fréquents. 5. LE TOIT EN PAVILLON C'est un toit à quatre versants droits couvrant un pavillon (corps de bâtiment carré ou sensiblement carré). Le toit en pavillon est généralement pointu. Mais il peut former un court faîtage (être tronqué et présenté une ligne horizontale) ou parfois, une terrasse faîtière. Exemple: Pavillon de Flore au Louvre. FAÎTAGE: dans une charpente, pièce horizontale placée au sommet de la charpente sous le faîte du toit. 6. LE TOIT BOMBÉ C'est un toit à deux versants galbés ou quart-de-rond. Il faut le distinguer du toit en carène, dont les deux versants galbés en doucine (profil en S) évoquent la forme d'une carène de navire. 7. LE TOIT BRISÉ C'est un toit dont les versants présentent deux pentes différentes, séparés par une arête saillante. Préférez le terme toit brisé que comble brisé. On l'appelle souvent, un peu à tort, le toit mansardé, ou à la Mansart. L'architecte français François Mansart a simplement contribué à la diffusion de cette forme de toit, qui apparaît dans l'architecture française avec Pierre Lescot au château du Louvre. 8. LE TOIT À L'IMPÉRIALE C'est un toit de plan centré, galbé en doucine (profil en S) ou en talon renversé (concave en bas, convexe en haut). 9. LE TOIT CONIQUE C'est un toit en forme de cône que l'on trouve dans la couverture des tours et des tourelles, mais aussi des clochers. Il forme une flèche conique. 10. LE DÔME C'est une forme de toit, de plan centré, composé d'un ou de plusieurs versants qui sont de forme galbée en quart-de-rond ou légèrement ovoïde. Il est généralement de plan circulaire, mais peut aussi être carré, rectangulaire ou polygonal. Son volume est souvent hémisphérique, mais il peut aussi être surbaissé, ou surhaussé. D'autres sont composés de plusieurs versants galbés: par exemple, les dômes carrés ou rectangulaires à quatre pans. Exemple: dôme du pavillon de l'Horloge au Palais du Louvre (architecte Jacques Lemercier)
III. LES MATÉRIAUX DE COUVERTURE A. LA TUILE C'est un élément en céramique (c'est-à-dire en terre cuite au four), de forme plate ou concave, qui sert à recouvrir les toits. Les tuiles sont habituellement posées à recouvrement, c'est-à-dire que, disposées par rangs, elles se chevauchent légèrement à leurs extrémités, pour faciliter l'écoulement des eaux sans pénétrer dans le toit, mais aussi pour leur praticité de remplacement. Dans l'architecture ancienne, elles sont de formes variées: plates et rectangulaires, creuses, en écaille, etc... On emploie aujourd'hui des tuiles plates à rainures, que l'on assemble par emboîtement (« tuile mécanique »). La tuile peut être émaillée, c'est-à-dire recouverte d'une substance vitreuse et colorée (émail jaune, émail rouge, émail vert,...), que l'on va disposer selon une logique particulière (composition). ATTENTION! La tuile vernissée n'est pas nécessairement colorée. B. L'ARDOISE C'est une fine plaque de roche schisteuse (de couleur grise ou noire, légèrement bleutée) qui sert à recouvrir les toits. Comme les tuiles, les ardoises se posent à recouvrement. C. LE TRAITEMENT DU FAÎTE ET DES ARÊTES DU TOIT Quand le toit n'est pas monopente, ni en dôme, il présente au moins deux versants qui se rencontrent au sommet de la toiture sur une ligne horizontale: le « faîte » du toit. La toiture peut aussi présenter, sur les côtés, d'autres lignes de rencontre, celles-ci inclinées, que l'on appelle les « arêtes ». Faîte et arêtes doivent être recouverts: le faîtage est l'élément de couverture du faîte; l'arêtier, c'est l'élément de couverture de l'arête. Si on recouvre le toit par un couvrage de tuiles, il s'agit soit de tuiles arêtières (qui forment l'arêtier) ou de tuiles faîtières (qui forment le faîtière). Si on recouvre le toit par un ouvrage métallique, ce sont alors des faîtages et arêtiers en cuivre, en zinc ou en plomb. Ces deux types d'ouvrages sont très souvent ornés: ➢ Les épis de faîtage sont des ornements en métal ou en terre cuite que l'on trouve aux extrémités d'un faîtage ➢ Les crêtes, en métal ou en terre cuite, ornent le faîte d'un toit, et sont très souvent ajourées ➢ Les versants du toit peuvent aussi être ornés d'éléments métalliques , qui peuvent être peints ou dorés (ex: château de Versailles). D. LES COUVERTURES MÉTALLIQUES Ce sont des couvertures en tôle de cuivre (emploi limité car très coûteux), de zinc, d'acier ou d'un autre métal. Depuis le XIXe siècle, le zinc est souvent employé dans les bâtiments utilitaires, dans l'architecture industrielle, mais aussi pour couvrir les habitations et aujourd'hui dans tous les types de constructions. Le plomb est souvent utilisé en revêtement sur les parties découvertes des maçonneries (chéneaux, corniches, frontons et a-fortiori sur les couvertures de pierre): cela protège les maçonneries contre les effets de l'eau. Exemple: coursière portée par colonnade de la cour du donjon au château de Fontainebleau (couverture en terrasse protégée par un revêtement de plomb). IV. LES OUVRAGES SERVANT À L'ÉVACUATION DES EAUX DE PLUIE
Le CHÉNEAU est un canal de pierre ou de bois, souvent recouvert de métal, qui est construit à la base d'un versant de toit où il recueille l'eau de pluie. La GOUTTIÈRE a exactement la même fonction: ouvrage plus léger et généralement étroit, formé d'un demi-tuyau (en bois, en métal), qui reçoit et évacue les eaux de pluie. Les DESCENTES DE GOUTTIÈRES (ou TUYAUX DE DESCENTE) sont des tuyaux d'évacuation (en pierre, en terre cuite, en métal, en plastique...) qui évacuent les eaux de pluie, recueillies par le chéneau ou la gouttière, pour les conduire au niveau du sol. Ils peuvent être visibles ou au contraire intégrés à la construction. La GARGOUILLE est un conduit d'évacuation des eaux, percé dans une corniche; c'est un ouvrage court, de forme horizontale et souvent sculpté. La gargouille fonctionne avec un chéneau: elle avacue directement, sans les conduire jusqu'au sol, les eaux récoltées par le chéneau. V. LES CONSTRUCTIONS DU TOIT A. LA SOUCHE DE CHEMINÉE La souche de cheminée est la partie de la maçonnerie de la cheminée qui s'élève au-dessus du toit. De forme quadrangulaire, elle renferme le ou les conduits de la cheminée. Elle peut être très ouvragée (ex: en pierre de taille ); c'est un véritable ouvrage d'architecte. B. LE LANTERNON Le lanternon est une construction de plan centré (circulaire, carré, octogonal, etc.) dont la forme élancée, percée de nombreuses fenêtres, évoque celle d'une lanterne. Il peut constituer une pièce panoramique. Il donne de la lumière aux espaces situés sous le toit et termine la toiture de façon très élégante. C. LE CAMPANILE C'est un ouvrage très proche du lanternon: il est construit sur un toit, de plan centré et très ouvert, qui abrite un ensemble de cloches. Le campanile a souvent pour fonction de donner l'heure (cloches) ou le sens du vent (girouette). Il a aussi lui-même un lanternon qui porte la girouette. Exemple: campanile du château de Saint-Germain-en-Laye D. LE BELVÉDÈRE Le belvédère, dont l'apparence est assez proche de celle du lanternon, est cependant une pièce couverte, nécessairement accesible depuis les étages. Comme son nom l'indique, c'est un point élevé depuis lequel on contemple le paysage. Dans le médoc, les belvédères offrent un point de vue sur les Pyrénées. C'est aussi un marqueur de domination. Il est souvent de plan centré, mais pas toujours. Exemples: • Château Larose-Trintaudon, Pauillac, Médoc • Immeuble « Le Splendide », Pau E. LA (FENÊTRE DE) LUCARNE Les lucarnes sont de vériables ouvrages construits dans le toit et dont la fonction est d'éclairer le comble. Il existe de nombreux types de lucarnes, dont les principaux sont: ➔ la lucarne-attique ➔ la lucarne-pignon, caractérisée par une face verticale triangulaire ➔ la lucarne à ailerons ➔ la lucarne oeil-de-boeuf, caractérisée par une face circulaire ou ovale
ATTENTION! Ne pas confondre l'oeil-de-boeuf, qui est un type de lucarne, et l'oculus, qui est un jour circulaire (dans une voûte ou un mur).
➢ ➢ ➢ ➢ ➢
Les ornements de toiture sont nombreux et sont disposés: sur le faîtage ou les arêtiers (crètes, épis de faîtages, girouettes) sur les versants du toit (placages métalliques en plomb) autour des lucarnes à la base des versants du toit (garde-corps ajourés, balustrades, sculptures ornementales telles que des statues, des vases, des pots-à-feu, etc.) en bordure et sous le toit
Parmi les ornements qui appartiennent vraiment au toit, on distingue l'antéfixe et la bordure. ➔ ANTÉFIXE: ornement en terre cuite, placé au bas de versants du toit où il dissimule l'extrémité des tuiles. ➔ BORDURE: frise en bois ou en tôle découpée, qui souligne les bords du toit. Très fréquente dans l'architecture du XIXe siècle....
Similar Free PDFs

FM - Des ratios et des communes
- 2 Pages

Fiche Lecture DES JEUX ET DES Hommes
- 14 Pages

Parement exterieur et couverture
- 15 Pages

Droit des personnes et de la famille
- 75 Pages

Harry Potter Et La Chambre Des Secrets
- 211 Pages

Calcul et analyse des écarts
- 4 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu