La sociologie interactionniste des professions PDF

| Title | La sociologie interactionniste des professions |
|---|---|
| Author | Thomas Tolier |
| Course | Sociologie des professions |
| Institution | Université de Tours |
| Pages | 4 |
| File Size | 70.3 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 106 |
| Total Views | 148 |
Summary
Download La sociologie interactionniste des professions PDF
Description
Chapitre 4 La sociologie interactionniste des professions Cette sociologie est presque contemporaine de la sociologie fonctionnaliste. C’est juste des querelles d’écoles. La sociologie fonctionnaliste est autour de Parsons à NY alors que la sociologie interactionniste est à Chicago. Les fondateurs de l’école de Chicago vont se former en Allemagne. L’interactionniste est plus dans l’individualisme méthodologique. Cette école de Chicago est fondée par Thomas et Park. C’est une école de sociologie urbaine. On s’intéresse à la manière de comment la société bouge. Chicago est un laboratoire social. Il y a énormément de délinquance à Chicago. C’est une sociologie des processus. La sociologie fonctionnaliste s’intéresse à des structures alors que la sociologie interactionniste étudie des processus. Cette sociologie a sous le nez, une réalité changeante et inverse la logique où on voyait des grandes règles car on regarde comment ça change. C’est une sociologie qui pense que la stabilité sociale est une anomalie. C’est une sociologie adaptée à l’instabilité. C’est dans la lutte, qu’on se socialise, qu’on sait qui on est. On se structure dans l’adversité. L’école de Chicago accorde un primat à l’empirisme, il faut d’abord aller voir, d’abord le terrain. Ce n’est pas une sociologie théorique mais empirique. Parsons ne se réfère pas à l’empirisme. Thomas veut que ces élèves étudient tous les milieux sociaux. Dans cette première école de Chicago, on a aussi une sociologie des professions avec le travailleur migrant (hobo) qui fait des chantiers un peu partout. C’est une sociologie de ceux qui n’ont pas de maisons et c’est décrit par Anderson. Cressey fait une sociologie des entraineuses (prostitués). Les fonctionnalistes étudient les avocats, les médecins alors qu’à Chicago, les migrants, les prostitués. Sutherland raconte qu’il est un voleur professionnel et donc il décrit ce qui permet de devenir un professionnel du vol. La deuxième génération de l’école de Chicago, c’est avec Hughes. Il est à la charnière des deux écoles de Chicago. Hughes va former toute une série de sociologue, il laisse très peu d’écrit, c’est lui qui a formé Becker, Goffman. Hughes est connu pour les méthodes qu’il a enseigné à ses étudiants. Le père de Hughes est pasteur, Hughes fait sa thèse à Chicago sous Park et il étudie les québécois. Il revient à Chicago en 1938 et enseigne le travail de terrain à l’école de Chicago à partir de 1945. Dans ce rôle de professeur de méthodologie, il forme Becker, Goffman…. Hughes questionne la réalité des professions ; son approche n’est pas une théorie des professions mais une manière de les étudier. Il a une approche, une méthode mais pas une théorie. « Il n’y a rien de moins raffiné que les raffinements prématurés ». Ce ne sert à rien d’avoir des systèmes théoriques poussé trop tôt. Hughes va refuser d’envisager qu’il existe une différence de nature entre une occupation et une profession, ces différences ne seraient pas légitimes. Pour lui, tous les métiers se valent, tous les hommes sont égaux en humanité et c’est seulement dans ces conditions qu’est possible la sociologie. Les hypothèses de Hughes sont fondamentales. « Il faut nous débarrasser de toutes les notions qui nous empêchent de voir que les problèmes fondamentaux que les hommes rencontrent dans
leur travail sont les mêmes » et cela peu importe le métier. La méthode qu’il enseigne, c’est la comparaison irrévérencieuse. On rejette la frontière profession/occupation et il faut aller vers une approche du travail où le statut ne compte plus. La méthode Hughes est l’idée que pour étudier un métier (surtout s’il est noble), il faut étudier un petit métier qui lui ressemble et qui a des propriétés communes. On part des petits métiers pour comprendre les grands. Pour lui, on comprend mieux les médecins si on part des plombiers. Tous les métiers ont des difficultés communes. Ce qui fait la différence entre petits et grands métiers, c’est le fait que les professions dissimulent leurs problèmes. Il y a pour les professionnels un enjeu de garder une image. Dans les grands métiers, on a une façade. Les grands professionnels sont des grands acteurs. Un métier est noble car il a fait oublier ce qui n’est pas noble. Hughes rejette l’opposition profession/occupation. Les concepts de Hughes : Licence et mandat : tout métier possède une licence, un mandat. La licence au sens de Hughes est pour parler de licencieux (qui s’écarte de la norme, qui est dévient). La licence est le fait de s’écarter de manière légitime du comportement ordinaire. Dans un métier, on a le droit de faire des choses qui ne seraient pas interprétées correctement hors du corps professionnel. La licence est une autorisation d’avoir des comportements considérés défiants hors de son métier. Le mandat est la situation dans laquelle un groupe professionnel se trouvent dépositaire sur un problème donné. On fait confiance à un groupe professionnel pour gérer un problème collectif. Il y a un mandat légal, moral et intellectuel. Quand un métier a une licence et un mandat, on peut dire que la profession est établie.
Savoirs « coupables » : les professionnels ont tendance à manipuler des savoirs, des informations qui ne peuvent pas sortir du groupe professionnel. Une profession à la main sur des secret. Il y a de la confidentialité dans certains métiers. Il y a des secrets professionnels. Le deuxième sens est l’idée qu’il y a, entre membres d’un métier, la conscience commune que certaines choses peuvent être partagés entre professionnel mais qu’elles seraient insupportables à la clientèle. Il y a un rapport relativiste au métier. « Aucune profession établie ne peut s’exercer sans la licence de parler en terme choquant des clients et de leur problème ». A l’intérieur des métiers, il y a des conceptions communes entre professionnels qui seraient inaudibles en dehors.
Division morale du travail : c’est l’idée que tout métier doit être étudier dans ces relations avec les métiers environnant. Il y a souvent la délégation de tâches à d’autres groupes professionnels (moins valorisés). Par exemple, les médecins ont besoins des infirmiers pour faire les tâches qu’ils ne veulent pas faire. Dans tout métier, il faut chercher ce que les plus valorisés cherchent à refiler aux autres. Hughes parle de « sale boulot ».
Drame social du travail : pour Goffman, nous sommes des acteurs de théâtre. Pour Hughes, le monde du travail est un théâtre. Les professions établies ont la
face la plus établie, on n’accède peu aux coulisses. Dans tout métier, il y a des rôles. Pour les fonctionnalistes, un médecin est altruiste alors que pour Hughes,
cela s’accompagne d’ironie, de mise à distance…. Carrière : toute la sociologie interactionniste va être centrée sur la notion de carrière. Pour Hughes, il y a deux dimensions dans la carrière : objective et subjective. Dans sa dimension objective, une carrière se compose d’une série de statut et d’emploi clairement définie de suite typique de position, de réalisation, de responsabilité et même d’aventure. Dans sa dimension subjective, une carrière est faite de changements dans la perspective selon laquelle la personne perçoit son existence comme une totalité et interprète la signification de ces diverses caractéristiques et actions ainsi que tout ce qui lui arrive. Dubar parle d’identité narrative. Les gens sont constamment entrain de réinterpréter leur parcours social en fonction de l’angle qu’on a atteint selon Hughes.
Becker est un élève de Hughes. Il étudie les musiciens de jazz. Becker fait de l’observation participante, il fait du piano. Il est intéressé aux rapports entre les musiciens et leur clientèle. Il appelle les clients des caves (des victimes, des bolos). Il s’intéresse au sale boulot dans la musique ; c’est-à-dire faire de la musique commerciale, pour faire danser. Becker utilise ce prisme pour étudier ce métier. Il passe son temps à parler de carrière, de carrière défiante. Il montre que la carrière du jazzman le conduit à sortir du circuit commercial et à adhérer à un point de vue inédit. En 1961, Bucher et Strauss publient un article qui pose la question : « dans quelle mesure les professions sont unifiées ? ». Cet article propose un modèle, une interprétation des professions et un concept de segment professionnel. Ils s’inspirent de la médecine pour généraliser. Les professions postulent qu’elles sont unifiées mais eux mettent l’accent sur le contraire car il n’y a pas les mêmes méthodes, pas les mêmes outils… alors il faut étudier les professions sur leurs affrontements internes. Ils proposent de construire un modèle processuel. Ils disent que ce modèle est soit un complément soit une alternative au modèle fonctionnaliste dominant. Ce modèle a deux caractéristiques, il se focalise sur les conflits d’intérêt et sur les changements. Par exemple, à l’intérieur de la bulle de la médecine, il y a différents métiers et il y a des luttes ; toute profession est segmentée. Bucher et Strauss s’intéressent à la profession médicale et ils montrent qu’il y a des éléments qui vont diviser le groupe. Les médecins ne se reconnaissent pas dans le même segment. La revendication d’une mission spécifique crée des segments. Les urologues et les proctologues revendiquent un statut de chirurgien à part ; également pour les radiologues. Les activités de travail comme pour la journée de travail d’un médecin forment des segments. Un sociologue, par exemple, passe soit des journées devant des étudiants, soit on fait des recherches, soit on planifie. Les membres d’une profession ont des conceptions différentes de ce qui constitue le noyau, l’acte le pus caractéristique de leur vie professionnel. Les méthodes de travail forment des segments ; par exemple, les quantitativistes et les qualitativistes en sociologie. La clientèle crée des segments ; le cas le plus particulier c’est avec les enseignants. Autre
exemple avec les policiers. Bucher et Strauss font la remarque que les gens dans le même segment se définissent comme des collègues. Une association représentative ne représente pas tout le métier donc dans quelle mesure nous représente-t-on ? Bucher et Strauss insistent sur l’idée de regarder les codes éthiques. Les associations représentatives sont des affrontements des différents segments et pour régler cela il faut des codes étiques. Bucher et Strauss nous disent que les segments sont en changement constant, un segment n’est pas une institution. Un segment a une période de vie plus ou moins longue et définit une profession. Une profession est la réunion, l’amalgame, de segments en mouvements. Une profession définit ainsi ne doit pas être vu comme unifié mais en lutte car les segments sont en lutte pour associer une définition au métier, pour prendre la tête des associations....
Similar Free PDFs

Sociologie des institutions
- 61 Pages

Courant interactionniste
- 3 Pages

Sociologie des Médias de masse
- 12 Pages

Sociologie de la modernité
- 29 Pages

Sociologie DE LA Musique
- 9 Pages
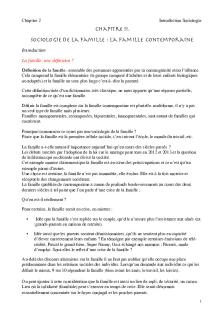
Sociologie de la famille
- 30 Pages

Sociologie de la famille
- 11 Pages

Domaines de la sociologie
- 45 Pages

Sociologie DE LA Deviance
- 18 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu






