Le rôle des firmes multinationales dans la nouvelle économie mondiale PDF

| Title | Le rôle des firmes multinationales dans la nouvelle économie mondiale |
|---|---|
| Course | Macro Économie |
| Institution | EM Lyon Business School |
| Pages | 13 |
| File Size | 358.5 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 32 |
| Total Views | 144 |
Summary
Economie...
Description
LE RÔLE DES FIRMES MULTINATIONALES DANS LA NOUVELLE ÉCONOMIE MONDIALE
Introduction Depuis 40 ans, montée en puissance des FMN dans commerce mondial : de 7000 en 1970 à 82 000 aujd. Elles comptent 810 000 filiales étrangères, chiffre d’affaire de 30 milliards $, emploient 77 millions de personnes en 2008 (x4 depuis 82). I. LES FMN : PRINCIPAL MOTEUR DE LA MONDIALISATION : 1°) Firme multinationale : définition, degré d’internationalisation et origine géographique : a) Qu’est-ce qu’une firme multinationale ? Firme multinationale = entreprise, à base nationale, qui possède au moins une filiale à l’étranger et qui produit ou commercialise hors de son territoire d’origine grâce à ses filiales. Ou FMN si réalise des IDE supérieurs à 10% du capital d’une entreprise étrangère. Cependant, entre 10 et 50% le contrôle est faible. Vrai contrôle au-dessus de 50% = majorité des cas (Ex : plus de 84% des emplois à l’étranger pour firmes américaine sont dans des filiales possédées à plus de 50%). Ici on dira que FMN = FTN (firme transnationale), terme préférée par la CNUCED, peut être plus juste car très peu de FMN sont à plus d’une nationalité de base (Ex : Royal Dutch/Shell =Royaume Uni/PaysBas) ENCADRE 2.1 : POURQUOI LES MULTINATIONALES ? Dans le modèle HOS, la spécialisation internationale se fait selon les dotations relatives en facteurs de production. Pb est que les facteurs de production sont immobiles internationalement A terme, la mobilité des produits n’a aucun intérêt puisqu'on assiste à une égalisation des prix des facteurs de prod. - Mundell suppose que facteurs sont mobiles. Il étudie ainsi les déterminants des mouvements de capitaux dans un cadre néoclassique. Fort mouvement de capitaux des PCD aux PED car la rémunération du capital y est plus forte. PED mieux dotés en K, investissements se substituent aux importations à destruction du commerce international. - Empiriquement, le constat est contraire à théorie de Mundell : développement des IDE et commerce international apparaissent complémentaires. Abandon des hypothèses de CPP. Les modèles de développement récents modélisent les comportements des FMN dans cadre d’une concurrence imparfaite. On étudie les acteurs et non les mouvements de capitaux. Comment une firme s’implantant à l’étranger et subissant des coûts de délocalisation de sa production peut rester compétitive face aux entreprises locales ? - Elles doivent posséder des avantages spécifiques transférables (R&D, nb chercheurs) basés sur la connaissance pour avoir des gains supérieurs aux coûts d’implantation. Barney 1991 explique l’avantage compétitif durable des entreprises grâce à leur aptitude à mobiliser en interne des ressources transversales spécifiques. Hamel et Prahalad 1990 : compétences fondamentales = faisceau d’aptitudes et de techniques fortement reliées et présentant un caractère systémique. - Helpman (et d’autres) 2004 : degré de profitabilité est un autre déterminant de l’internationalisation des entreprises. Les firmes les plus rentables s’installent à l’étranger, les moyennes exportent, les moins vendent localement. Synthèse : Dunning 1988 paradigme OLI = multinationalisation selon trois avantages : 1. l’avantage spécifique (Ownership advantages) 2. l’avantage à la localisation à l’étranger (Location advantages) 3. l’avantage à l’internalisation (Internalization advantages). L'IDE se produira seulement si les 3 avantages sont réunis, sinon exportation ou vente de licence.
b) Firme multinationale et degré d'internationalisation : Il importe de pouvoir mesurer le degré d'internationalisation d'une transnationale et de déterminer comment cet indicateur a évolué dans le temps. Cela permet de savoir quels sont les pays d'origine ou d'accueil et les secteurs d'activité où l'internationalisation des FTN est la plus marquée. Dans son rapport annuel sur l'investissement dans le monde (World Investment Report), la CNUCED propose une mesure du degré d'internationalisation (transnationality index, TNI), pour les 100 plus grandes FMN financières: celles ci représentent 9% des actifs, 16% des ventes et 11% de l'emploi à l'étranger de l'ensemble des FMN en 2008. → ces 100 plus grandes sont classées en fonction du montant des actifs qu'elles détiennent à l'étranger. Cet indicateur est obtenu à partir de 3 indicateurs: • La part des actifs possédés à l'étranger • La part des ventes à l'étranger • La part de l'emploi à l'étranger. En 2008, le degré moyen de transnationalité pour ces firmes était de 62,4%, soit un taux relativement stable sur les vingt dernières années, fluctuant entre 47 et 62%. Même si l'on pressent que le degré d'internationalisation s'est accru, selon cet indicateur, cela n'est pas visible. Les secteurs d'activité les plus transnationalisés sont l'industrie des télécommunications pour les pays développés et l'industrie agroalimentaire pour les PED. Exemple: Nestlé et Wal-Mart, respectivement 28eme et 29eme places mondiales affichent un taux de transnationalité de 76% et 31% en 2007. La taille du marché intérieur du pays d'origine est l'explication d'une telle disparité de cas: multinationales japonaises et américaines sont moins multinationalisées que leurs consoeurs européennes. En 2007, l'indice de transnationalité est plus élevé pour les entreprises dont le marché national est plus étroit. En effet, les multinationales dont le marché national est de petite taille ont besoin de se développer à l'étranger afin de bénéficier des économies d'échelle nécessaires à leur compétitivité. Classement de 1999 des 10 entreprises les plus internationalisées est révélateur de la place prise par les petits pays (4 multinationales suisses parmi les 10 premières). Depuis années 90, le TNI des cents plus grandes multinationales des PED a augmenté mais reste au dessous de celui des 100 plus grandes multinationales au niveau mondial. Écart entre les pays s'est réduit. Comment mesurer le degré de transnationalité de pays d'accueil? Depuis 1996, la CNUCED a développé un indice de transnationalité pour chaque pays d'accueil; qui se calcule comme la moyenne de 4 variables: flux entrants d'IDE en pourcentage de la FBCF, le stock d'IDE en pourcentage du PIB, la valeur ajoutée (PIB) des filiales étrangères en pourcentage du PIB. Le degré de transnationalité des pays d'accueil stagne tant pour les pays développés que pour les PED. Cela traduit le déclin des flux d'IDE au cours de la période 1996-2002. • Concernant les pays développés, les économies les plus multinationalisées sont la Belgique (77,1%), le Luxembourg (77,1%) et l'Irlande (69,3%). • Concernant les PED, Chine (81,6%) et Singapour (60,3%) sont les plus transnationalisées. Du point de vue de l'indice d'internationalisation: • Les pays d'accueil les plus plébiscités par les grandes firmes multinationales sont les Pays Bas, le RU et le Canada • Au sein des PED, ce sont le Brésil et la Chine qui accueillent le plus grand nombre de filiales des cent plus importantes firmes transnationales.
c) Les pays d'origine des FMN : Seulement 10% des FMN avaient leur siège social dans un PED en 1990, 20% sont désormais originaires de ces pays. Ainsi en 2007, les pays développés comprenaient 60 000 multinationales disposant de 370 000 filiales et les PED 20 000 multinationales avec 425 000 filiales. En 2006, les cent premières FMN originaires des PED représentent 20% des actifs et 40% des emplois des 100 premières FMN mondiales. En 2007, 90% des 100 premières multinationales ont leur siège social dans un pays de la Triade et seulement 7 dans un PED. Ecart notable entre les multinationales des pays développés et des PED. Cependant, recul marqué de la prépondérance des firmes américaines qui représentaient la moitié des grandes firmes au début des 80s contre 25% dans le début des 90s. Perte de l'hégémonie des FMN américaines et rééquilibrage au sein de la Triade au profit de l'UE et du Japon. En 2007, les 100 premières multinationales issues des PED totalisent 767 milliards de dollars d'actifs étrangers. Les 7 premières multinationales détiennent presque la moitié des actifs étrangers de l'ensemble des 50 premières multinationales. → Hutchison Whampoa Ltd, qui possède des actifs étrangers de l'ordre de 84 milliards de dollars, est en première position et possède le quart des actifs étrangers du « Top 50 » En 2003, les entreprises asiatiques demeurent dominantes avec 39 entreprises sur les 50. Les autres viennent d'Afrique du Sud (4), du Mexique (4) et du Brésil (3). HK et Singapour restent les plus importants pays d'origine avec 10 et 9 entreprises dans la liste. Taïwan en 3eme position avec 8 entreprises (essentiellement dans l'électronique). → secteurs les plus importants sont l'équipement électrique et électronique et l'informatique, suivi de l'agroalimentaire. 2°) Le poids croissant des multinationales dans le commerce mondial : Poids croissant de ce type d’entreprises, chiffre d’affaires toujours plus important et les ventes des filiales étrangères des firmes multinationales dépassent désormais largement la valeur du commerce mondial de marchandises et de services. Volume croissant des flux et des stocks d’investissements directs à l’étranger qui témoigne de l’intensité de leur activité d’implantation à l’étranger. a) Les firmes multinationales: le vecteur majeur de la mondialisation des économies : Au cours des 30 dernières années, on a assisté à une montée en puissance des firmes transnationales au sein du commerce mondial. Les ventes des 810 000 filiales étrangères des firmes multinationales dépassent désormais largement la valeur du commerce mondial de marchandises et de services. Réalisent un chiffre d’affaires de 32 000 milliards de $ et sont à l’origine d’un stock d’IDE estimé à 16 000 milliards en 2007 comme en 2008. On s’aperçoit que la montée en puissance des firmes multinationales a lieu au cours des 90s. Cependant, la production des firmes multinationales effectuée à l’extérieur de leur territoire d’origine reste relativement limitée. Ainsi, la production à l’étranger des firmes multinationales américaines ne représente que 6% du PNB américain. Parmi l’ensemble des 80 000 multinationales, on assiste à une forte concentration de l’activité au sein des cent premières multinationales (non financières) qui représentent 9% des actifs, 16% des ventes et 11% de l’emploi à l’étranger de l’ensemble des firmes multinationales en 2007. En retenant comme critère le montant d’actifs étrangers, en 2003, General Electric (EU): plus grande entreprise transnationale non financière; puis Vodafone (RU). Selon le SESSI, les 500 plus grands groupes mondiaux contrôleraient 70% du commerce mondial (inter-firme et intrafirme) et 90% des IDE. Au sein des 100 premières firmes transnationales, en 2003, les trois industries les plus représentées sont le secteur automobile, l’industrie pétrolière et l’industrie électrique et électronique. Entreprises de services prennent de l’importance.
b) L’essor des IDE comme indicateur du dvp croissant des firmes multinationales : L’IDE est un des vecteurs d’action des firmes multinationales dans la mise en œuvre de leurs stratégies internationales. L’IDE est un des phénomènes qui participe fortement à la mondialisation de l’économie avec l’expansion du commerce international, l’intensification des flux de capitaux financiers et les transferts technologiques. IDE consiste en une participation au capital d’une entreprise étrangère de plus de 10%. Un IDE peut se faire selon deux modalités: • Construction d’un site de production ex nihilo: on parle d’investissement «Greenfield» = choix d’une croissance interne. • Rachat d’un site existant: «fusion et acquisition internationale» qui témoigne du choix d’une croissance externe. L’IDE permet la mise en œuvre de la stratégie décidée par l’état-major de la firme multinationale: une stratégie de croissance horizontale qui consiste à dvp le même métier dans d’autres pays (multinationale dite horizontale), une stratégie de croissance verticale qui consiste à dvp en amont ou en aval les activités productives de l’entreprise (multinationale dite verticale), une stratégie de diversification dans d’autres métiers (multinationale dite diversifiée). Définition de l’IDE: «opération effectuée par un investisseur afin d’acquérir, d’accroître ou de liquider un intérêt durable dans une entreprise (quelle qu’en soit la forme juridique) et de détenir (ou de liquider) une influence dans sa gestion ou la capacité de l’exercer». L’IDE a lieu entre entreprises apparentées, c’est-à-dire soit entre la maison-mère («investisseur direct») et une ou plusieurs entreprises «investies» (succursales, filiales, entreprises affiliées) ou entre sociétés investies (sociétés «sœurs»). Par opposition, un investissement de portefeuille s’inscrit dans une logique financière de court terme. L’objectif n’est pas de contrôler une entreprise et d’influer sur sa gestion, mais d’effectuer une plusvalue financière, dans un délai raisonnable. Les caractéristiques récentes des IDE. En 1914, 55% du stock des IDE se trouvait dans le secteur primaire, 20% dans les chemins de fer, 15% dans les produits manufacturés, 10% dans les services, la distribution et les banques. Au début des années 2000, la structure est très différente. Secteur primaire: 6%, secteur des services: 60%, produits manufacturés 34%. Au cours de la période 1986-1990, l’IDE constitue le phénomène le plus dynamique dans un processus de mondialisation en forte progression. En revanche, les années 2000 ont vu un renversement de tendance avec une forte baisse des flux d’investissements étrangers au cours de la période 20012003. Sur cette période, le taux de croissance annuel des exportations a été largement supérieur à celui des IDE qui ont diminué en valeur absolue. Les investissements internationaux font l’objet de flux croisés entre les pays, tout particulièrement pour les pays dvp. Cela signifie que ces pays sont à la fois pays d’accueil et pays d’origine de ces investissements étrangers. Depuis le début des 90s, la France et le RU ont vu leurs investissements sortants se dvp par rapport aux investissements entrants pour atteindre, actuellement, un ratio de flux d’investissement croisés de 2,11 et 1,93 respectivement. Alors que l’on résume encore trop souvent les investissements directs à l’étranger à des investissements industriels, les IDE dans les services représentent en 2002 60% du stock total d’IDE alors qu’ils n’en représentent que 25% en 1970.
c) Qu’en est-il des multinationales financières ? La libéralisation des services financiers et les innovations technologiques ont conduit à la création de conglomérats financiers, en particulier au cours des 90s. En 1989 : les entreprises de services financiers ne se classaient pas dans les 50 + grandes multinationales. Aujourd’hui, 14 en font partie. L’augmentation des actifs détenus provient des opérations de croissance externe : fusions/acquisitions, présentes dans les PD, mais aussi dans les pays émergents (Amérique Latine, pays d’Europe centrale…) Quelques grands groupes dominent le secteur des services financiers au niveau mondial. Les transnationales financières sont originaires en majeure partie de France, d’Allemagne, du Japon et des US. Elles représentent 70% entreprises du classement, et 74% des actifs. Indice d’internationalisation : 44% des filiales de ces multinationales sont à l’étranger, et chacune dispose de filiales dans environ 25 pays. Corrélation entre taille d’une multinationale et son degré de transnationalisation : 10 plus grandes multinationales financières possèdent 58% de leurs filiales dans 43 pays étrangers. 50 plus grandes multinationales : 44% de leurs filiales dans 25 pays étrangers. Les multinationales financières sont plus grandes que les non financières. Transnationales financières sont moins internationalisées que les non financières : 44% de leurs filiales à l’étranger dans 25 pays contre 66% dans 39 pays pour les multinationales non financières. La crise financière a conduit à des changements dans le système bancaire et donc a affecté les multinationales. II. FIRMES MULTINATIONALES : ORGANISATION DU PROCESSUS PRODUCTIF ET DELOCALISATIONS : Les échanges intrafirmes sont de plus en plus importants. Ceci modifie la compréhension de l’interdépendance entre pays, du mode d’organisation et du mode de production. Le commerce extérieur dépend de plus en plus de décisions stratégiques et organisationnelles de la multinationale. 2 modes de production : • fragmentation (décomposition ou segmentation) • intégration verticale : activités réparties sur un réseau international de sites, chaque site étant spécialisé dans la production d’un bien intermédiaire Les multinationales sont cependant plutôt de type ‘horizontal’ : les produits sont faits pour être revendus sur les marchés locaux plutôt qu’exportés. • •
La DIPP conduit à une destruction d’emplois dans les PD ? Les politiques publiques essayant d’améliorer l’attractivité des territoires sont-elles efficaces ?
1°) Firmes multinationales, commerce intrafirme et décomposition du processus productif : a) Le commerce intrafirme : un trait saillant du commerce international actuel : Les échanges intragroupes représentent une part importante du commerce international. En 1999 les échanges intragroupes représentaient 1/3 des exportations de marché du Japon et des US. Il en est de même pour les importations et pour la France : même niveau que les US. Aujourd’hui entre 1/3 et 1/5 des échanges internationaux des PD est intrafirme. Ce type d’échange est particulièrement concentré pour les produits de haute technologie et complexes La nature et l’intensité des échanges intra-groupe sont reliées au niveau de développement des partenaires commerciaux. -> Dans les PD : échanges portent sur des produits finis destinés à des filiales s’occupant de commercialisation et de distribution (pas de transformation supplémentaire). -> Aux US, 2/3 des importations intra-groupe réalisées par des multinationales sont destinées à des filiales de commercialisation. De plus, même lorsque la filiale qui reçoit les marchandises pour la transformation, une grande partie de la production est destinée aux marchés locaux. 95% des ventes
des filiales japonaises installées aux US sont réalisées sur place. -> Dans les pays à revenu intermédiaire (Corée, Chine, Taiwan, le Mexique) les échanges intra-groupes avec les pays riches sont une part importante des échanges bilatéraux. Les filiales dans ces pays fabriquent produits destinés à d’autres marchés. En 2000, 2/3 des importations américaines en provenance du Mexique ont été intra-groupe, et ce à cause des maquiladoras. L’importance de ce type d’échange, résultat de l’internationalisation du processus de production s’est accru depuis 1990. b) Quel cadre théorique pour la DIPP – multinationale « verticale »- et pour l'entreprise multinationale « horizontale » multi-usines ? Théorie : les activités productives des entreprises sont réparties sur un réseau international de sites de production selon leurs avantages comparatifs (cf : HOS) dans les différentes phases du processus productif -> Phases de production intensive en travail : pays à bas coût du travail -> Phases intensives en capital (R&D) : pays d'origine de la multinationale (pays développé). Les produits sont décomposés en sous-ensembles pouvant être fabriqués indépendamment les uns des autres et dans des pays différents => DIPP (décomposition internationale du processus productif) donnant lieu à un échange intrafirme entre filiales et à des flux d'échange avec des sous traitants. Le produit final sera recomposé lors de l'assemblage où il fera l'objet d'une différenciation retardée (permet des économies d'échelle grâce à la fabrication en grande quantité de composants standardisés). Théorie de la fragmentation : les IDE et les échanges qu'ils impliquent sont mutuellement avantageux (un pays peut avoir un avantage comparatif dans un segment de la production). La part de la P qui fera l'objet d'une DIPP est une fonction décroissante des coûts de transaction internationaux (installation, coordination des sites de P = coûts d'organisation interne des échanges, acheminement des biens intermédiaires). Les firmes "verticales" organisent leur production à l'échelle du monde entier (délocalisation : arbitrage entre des coûts salariaux plus faibles et de coûts de tran...
Similar Free PDFs

Le cinéma dans la mondialisation
- 3 Pages

La personnalité dans le recrutement
- 19 Pages

Le nouvelle recette du Commensal
- 3 Pages
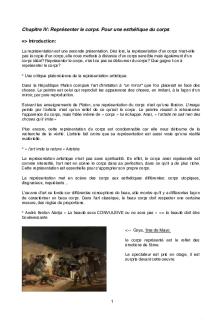
Le corps dans l\'art
- 6 Pages

La Nouvelle Vague
- 5 Pages

Les stéroïdes dans le sport
- 1 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu









