Les glaneuses PDF

| Title | Les glaneuses |
|---|---|
| Author | Malika ALAOUI |
| Course | Analyse des arts |
| Institution | Université Toulouse-Jean-Jaurès |
| Pages | 4 |
| File Size | 230.8 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 98 |
| Total Views | 158 |
Summary
glaneuses
histoire de l'art
TD
notes...
Description
Jean François Millet, Les Glaneuses 1857, h/t, 83x111 cm, Musée d’Orsay (Paris)
Introduction : 3 grands mouvements du réalisme : Damier, Millet, Courbet. Il se prolonge à travers un autre mouvement, le naturalisme (Manet). Il a pour but de représenter le monde objectivement, tel qu’il est. Ce mouvement se rattache au courant républicain. Jean François Millet est né en 1815 et est mort en 1875. C’est lui qui a peint le tableau le plus cher de tout le 19ème siècle. Description : Dans une vaste plaine, sous un soleil de plomb, parmi la poussière (dans le ciel), on voit 3 paysannes (premier plan, vêtues de vêtements pauvres avec sur la tête un fichu, et portant autour de la taille une besace ; leur peau est tannée par le soleil, le travail et la sueur) qui ramassent quelques épis de blé ; elles sont courbées vers le sol. A l’arrière plan, le long de la ligne d’horizon, se déroule une ample moisson. On voit une charrette pleine de foin avec quelqu’un qui stabilise les bottes. On voit aussi des petits tas de foin= on voit la décomposition de la moisson. Elle suppose beaucoup de travailleurs que l’on voit dans le fond, surveillés par le contremaitre (en haut à droite) sur son cheval. Il y a une ferme composée de plusieurs maisons devant les arbres (en haut à droite). Puis vient le ciel gris à cause de la poussière qui vient altérer la visibilité. Impression générale : le travail est pénible. Iconographie : C’est une scène de genre mettant en scène un épisode rural, c’est le thème de la moisson. Mais beaucoup d’artistes avant lui ont traité ce thème comme La Moisson de Breughel peint vers 1565. On retrouve le paysage de la moisson, les moissonneurs mais l’impression de labeur que l’on a avec Millet n’est pas la même, la vision de Breughel est positive (les hommes travaillent la terre et la terre nourrit les hommes). Ici, on a une vision sociale. Droit de glane : les pauvres dans la société rurale ont le droit de ramasser les épis oubliés par les moissonneurs, c’est la « part du pauvre ». C’est une vieille tradition rurale qui remonte à longtemps (illustration dans la bible). C’est pour éviter la révolte des plus pauvres, « les jacqueries ».
Pieter Brueghel l’Ancien, La Moisson 1565, h/bois, 119x162 cm, Metropolitan Museum of Art (New-York) Signification : Comment le tableau propose une antithèse entre paysannerie riche et paysannerie pauvre ? C’est le contraste du blé, le contraste de quantité : elles ont quelques épis et ils ont des meules en abondance, elles sont trois paysannes, ils sont beaucoup d’ouvriers, elles sont courbées, ils sont debout, la modernité est aussi différente, ils ont des animaux elles n’ont que leurs mains. Il y a aussi un contraste de lumière. Cette image reflète la paupérisation, il y a une critique du régime économique de Napoléon 3. Analyse plastique de l’œuvre : A/ La composition La lisibilité de cette composition est possible grâce au premier plan qui bascule directement a l’arrière plan, la suppression des plans intérieurs est novateur, c’est l’originalité du tableau. La plupart des informations sont dans les deux tiers du tableau. Les 3 glaneuses sont sous la ligne d’horizon et sont rabattues vers le sol, elles appartiennent à la terre : ne dépassant pas la ligne d’horizon, elles n’ont pas d’avenir. Avec une critique fataliste, Millet dit que les paysannes appartiennent au monde de la terre. Il va faire une analogie plastique entre le 1er et le dernier plan. Il joue avec les masses du premier et du dernier plan, les femmes sont chosifiées et sont ramenées à un État de nature avec la comparaison qu’il fait d’elles et des meules qui ont la même forme. La composition est efficace mais aussi subtile. L’Eurythmie (suggère un mouvement à venir) du tableau suggère que la femme presque debout se baisse, elle complète la courbe que forment les deux autres femmes. Ces deux dernières sont soudées à la terre mais l’autre va aussi se visser au sol. Cela renforce l’idée que ces trois femmes appartiennent à la terre car même la femme debout ne dépasse pas la ligne d’horizon. La terre estelle si nourricière que ça ? C’est une vision sociale plutôt pessimiste de la paysannerie française et se veut critique envers la politique agricole de Napoléon 3. B/ Les dessins De nombreuses esquisses préparatoires existent ; elles confirment nos hypothèses de distance ainsi que la chosification des femmes. Au fur et à mesure des esquisses il agrandit la distance des riches et des pauvres pour apporter encore plus de sens et de critique à sa peinture. Il a choisit de ne pas montrer le visage des glaneuses pour les faire paraître comme des sculptures, il y a donc une référence à la statuaire antique. Il aime les paysans, c’est un fils de paysan et a été élevé dans les campagnes françaises. Il a donc un rapport de respect et non critique face à la
paysannerie, il veut donner de la dignité à ces représentations en leur conférant le poids de la statuaire antique. Il réhabilite donc les paysans. C/ Couleurs, lumière, touche La palette de couleur est restreinte avec des rehauts de couleurs vives. Les zones plus vives dans le tableau sont les fichus des glaneuses mais la toile n’est pas vraiment colorée. le tableau a une tonalité claire, dorée. La lumière est éclatante mais qui décolore vers des gris. Ici, Millet retrouve une touche plus classique, c’est une facture léchée, lisse qui s’oppose à la facture libre ou l’on voit les coups de pinceau. Situation : A/ Dans la carrière de l’artiste Millet s’est intéressé pour la paysannerie et va donc gagner un surnom dans le milieu des arts « le peintre des paysans ». En 1848 lors de l’installation de la seconde république, Millet va peindre beaucoup d’œuvres, entre autre la nouvelle allégorie de la Marianne, beaucoup demandés par les républicains. Il peint aussi Le vanneur en 1848, Le sommeil de l’enfant, Le repas des moissonneurs, Le greffeur (vision de paysannerie associé à la vie naturelle), La fileuse, Les deux bêcheurs de 1855 (hommes animalisés). Peu de temps après, il peint l’Angélus de 1857/1859 (huile sur toile, 55 hauteur 56 largeur au musée d’Osay) qui est une prière faite pour les défunts.
Jean-François Millet, L’Angélus 1857-1859, h/t, 555x66 cm, Musée d’Osay (Paris) L’église derrière sonne l’Angélus 3x/jours, il rythme la vie des paysans, c’est son horloge, on se lève à l’Angélus, on mange à l’Angélus, on arrête le travail à l’Angélus : c’est une importance dans la vie paysanne. Ici, c’est la fin de la journée de travail indiqué par la lumière ou la charrette pleine. Par rapport au travail, on voit ici la répartition des rôles entre l’homme et la femme : elle est entourée du panier et de la charrette, il est entouré de la fourche plantée dans la terre : répartition traditionnelle des rôles dans les campagnes, à l’homme les travaux de force, à la femme les travaux de cueillette. Par rapport à la religion, la femme est la plus croyante car elle est courbée vers le sol, les yeux fermés et les mains jointes. L’homme est droit et ses mains sont dans son chapeau. Au milieu du 19ème les femmes sont plus marquées par le catholicisme que les hommes. C’est une présentation scientifique de la ruralité. Derrière l’homme, le soleil se couche et éclaire la femme : la lumière est religieuse et symbolique. La différence entre ce tableau et Les glaneuses est l’avenir que les paysans ont. B/ Dans l’histoire de l’art
Dans ce tableau, le buste des deux dépasse de l’horizon, c’est ce qui a rendu célèbre ce tableau qui délivre un message d’espoir. Il y a une ref de Jacques Chirac à la foire agricole qui touche les vaches. La paysannerie et la religion catholique sont des fondamentaux de la France. Ainsi, il va devenir une icône obsessionnelle qui sera gravé sur les assiettes, camemberts, etc. C’est le tableau le plus cher du 19ème siècle (800 000francs, vendu à la base 1000francs)....
Similar Free PDFs

Les glaneuses
- 4 Pages

Les rhodobiontes : les rhodophycées
- 10 Pages

Les protides et les protéines
- 6 Pages

Les 1 - eerste les beknopt
- 3 Pages

LES 5 - notities les 5
- 6 Pages

Les mycètes
- 13 Pages

Les successions
- 8 Pages
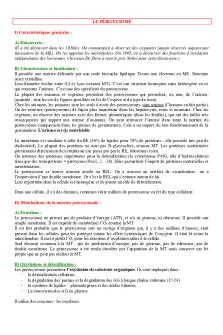
Les péroxysomes
- 5 Pages

Samenvatting LES PER LES Duits II OM
- 49 Pages

Les Microtubules
- 7 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu





