Les rhodobiontes : les rhodophycées PDF

| Title | Les rhodobiontes : les rhodophycées |
|---|---|
| Course | Biologie |
| Institution | Université Catholique de Lille |
| Pages | 10 |
| File Size | 740.2 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 59 |
| Total Views | 166 |
Summary
Cours de Licence physiologie, biologie et écologie....
Description
Les rhodobiontes!: les rhodophycées Ils sont environ 5000 espèces, marines ou dulcicoles, jamais flagellés. Ils se répartissent en Florideophycées et Bangiophycées. Quelques espèces sont unicellulaires, d’autres filamenteuses simples (nématothalles) ou filamenteuses complexes / en lame (cladomothalle). La reproduction est sexuée et se fait par trichogamie. La gamie est la fusion des gamètes puis des noyaux. Si les gamètes sont identiques, on parle d’isogamie, sinon d’anisogamie. Dans le cas d’anisogamie chez les rhodophycées, si les gamètes femelles sont des oosphères, on parle d’oogamie. Comme chez les rhodophycées cette oosphère possède un prolongement filamenteux appelé trichogyne (qui permet de capter les gamètes mâles), on parle de trichogamie. De plus, chez les rhodophycées, les gamètes sont immobiles!: on parle d’aplanogamie (contraire de planogamie).
I - Cytologie et caractéristiques biochimiques A) Pigments et phycobilisomes Les rhodophycées contiennent des chlorophylles a et b, des caroténoïdes (comme les xanthophylles), des phycobilliprotéines (phycocyanine, allophycocyanine, phycoérythrine, phycoérythrobiline). Comme ces pigments sont présents chez les algues rouges, on parle de r-phycobilliprotéines... L’appareil photosynthétique des rhodophycées est semblable à ceux des cyanobactéries, avec des thylakoïdes et des phycobilisomes.
B) Structure des chloroplastes Les chloroplastes peuvent être discoïdaux, sphériques, ou lobés. Les pyrénoïdes sont des masses peu colorées qui proviennent des corps polyédriques des cyanobactéries, aussi appelées carboxysomes (car ils contiennent la Rubisco). Les thylakoïdes ne sont pas superposés comme chez les végétaux supérieurs.
C) Substances de réserve Ils ne possèdent pas d’amidon vrai, mais du rhodamylon (amidon floridéen), une réserve carbonée issue de la photosynthèse qui peut former des granules dans le cytoplasme (chaine de glucose!: glucane). Selon les genres d’algues, on peut retrouver des floridosides (glycérol et galactose) ou des digénéasides (mannose et acide glycérique).
On peut aussi retrouver des composés halogénés!: chlore, iode, brome, composés halogènes volatils (CHV), qui se stockent parfois dans des cellules réfringentes comme des ioduques ou des bromuques (cellules spécialisées qui stockent les composés halogénés et qui réfléchissent la lumière).
D) Parois cellulaires La paroi cellulaire des rhodophycées est constituée de polysaccharides (chaines glucidiques) de nature variable. •
Squelette pariétal!: une partie constitue le squelette de la paroi. Elle est formée de microfibrilles de cellulose. Chez les algues rouges, la proportion de cellulose est relativement faible par rapport au reste de la paroi (5 à 10% de la masse sèche de la paroi).
•
Matrice!: autour des microfibrilles, des polysaccharides matriciels forment une gelée qui enrobe les microfibrilles de cellulose. Cette gelée est formée de galactane (chaînes de galactose) plus ou moins sulfatés. Chez les algues rouges, on retrouve les carraghénophytes et agarophytes, selon la nature des galactanes. Pour les carraghénophytes, les chaines de galactose sont formées de monomères constitués de deux molécules de D-galactose. Pour les agarophytes, les chaines de galactoses sont formées de monomères constitués d’une molécule de D-galactose et d’une molécule de L-galactose.
Les polysaccharides matriciels se distinguent par leur quantité en groupement sulfates (OSO3-) et de ponts 3,6-anhydrogalactose. Moins ces polysaccharides sont sulfatés et plus ils possèdent de ponts, plus la molécule est gélifiante. Chez les végétaux supérieurs, ce sont les pectines qui jouent le rôle de gélifiant entre les fibrilles de cellulose. Chez les algues brunes, c’est un réseau d’alginate. Les polysaccharides matriciels permettent la cohésion cellulaire et la souplesse de la paroi (si elle n’était constituée que de cellulose, la paroi serait complètement rigide). Les propriétés rhéologiques (comportement en solution) particulières des algues sont utilisés par l’homme pour former des gélifiants!: Chondrus crispus, Mastocarpus stellatus, Eucheuma sp., Gracilaria sp., Gelidium sp. Ce sont des composés chargés négativement, ce qui permet la capture d’un certain nombre de cations (sodium, potassium, calcium, magnésium), ce qui permet de garder des ions autour de la cellule pour résister à la dessalure (dilution de l’eau de mer par apport naturel d’eau douce). Ces composés ont aussi la capacité de fixer l’eau pour former une barrière hydrique autour de la cellule. Ils peuvent aussi entrer dans des mécanismes de défense.
Certaines espèces ont des parois calcifiées!: la matrice est imprégnée de calcite (CaCO3) ce qui rend la paroi rigide. On retrouve des algues rouges calcaires encroûtantes ou dressées et articulées (Corallina sp., maërl formé d’une accumulation d’algues calcaires comme Lithothamnion coralloides). Chez les Floridées, contrairement aux Bangiées, on retrouve des connections appelés synapses entre les cellules au niveau des plasmodesmes. Les synapses distinguent une discontinuité dans la paroi au niveau de laquelle s’établissent des échanges entre cellules contiguës.
II - Structure du thalle A) Archéthalles C’est le genre de thalle que l’on retrouve chez les cyanobactéries. C’est un thalle très simple formé de cellules isolées (type dissocié) ou de cellules en colonies (type palmelloïde). Ex!: Rhodella sp., Rhodosorus marina.
B) Nématothalles Ce sont des thalles représentés par des filaments simples (une file de cellule dressée ou rampante), des lames aplaties (lames foliacées) ou des tubes creux (entourés d’une ou plusieurs couches de cellules). Il n’y pas de différenciation entre les parties du thalle!: la croissance et la reproduction se fait dans toutes les cellules. Chez les algues rouges, ils sont présents chez Rhodothamniella floridula, Porphyra dioica...
C) Cladomothalles Dans les cladomothalles, on retrouve une différenciation entre deux types d’axes!: les axes principaux (cladomiens) et les ramifications (pleuridies).
Les axes cladomiens possèdent une croissance indéfinie, contrairement aux pleuridies. La reproduction se fait uniquement sur les pleuridies. Quand l’axe principal est constitué d’une file de cellules, on parle de cladome uniaxial. Quand il est constitué de plusieurs files de cellules, on parle de cladome pluri ou multiaxial. Quand on a des cladomes pluriaxiaux, les files des cellules peuvent fusionner pour former un tissu appelé médulla. Les pleuridies peuvent aussi fusionner pour donner le cortex. Différents types de thalles cladomothalles chez les algues rouges, selon les espèces!:
A la base des thalles se trouve un système de fixation formé soit d’un disque simple (uni ou pluricellulaire), soit d’un système de filaments rampants (protonéma) ou de crampons (chez les algues de grande taille).
III - Cycle de vie des Rhodophycées A) Généralités sur le cycle de developpement Les cellules reproductrices peuvent être soit des gamètes mâles ou femelles qui fusionnent pour obtenir un zygote, soit des spores (cellules reproductives asexuées qui génèrent directement des individus). Si le thalle produit des gamètes, on parle de gamétophyte (Gp). S’il produit des spores, on parle de sporophyte (Sp). Les gamètes sont haploïdes (un exemplaire de l’information génétique!: 1n), et vont donner un zygote diploïde (deux exemplaires de l’information génétique!: 2n). Les spores peuvent être soit haploïdes soit diploïdes (en fonction de la présence d’une méiose ou non). Le cycle de vie se fait en plusieurs étapes appelées générations!: il existe des cycles monogénétiques, digénétiques, trigénétiques, etc. Le cycle de développement des rhodophycées est trigénétique haplo-diplophasique. Pendant la phase haplophasique (haplophase), un gamétophyte mâle (qui contient un gamétocyste) va venir à la rencontre d’un gamétophyte femelle et ces derniers vont fusionner pour donner un carposporophyte diploïde (tissu formant des carpospores et dérivant du zygote, qui se développe sur la femelle). Le carposporophyte va donner des carpospores diploïdes qui vont former des tétrasporophytes par germination. Ces tétrasporophytes vont former des tétraspores haploïdes après une phase de méiose.
B) Organes reproducteurs des Floridées Les cellules reproductrices peuvent être des gamètes ou des spores. La formation d’une cellule reproductrice se fait à partir d’une cellule mère végétative qui va se transformer et se diviser. Cette cellule mère va former un sac qui libère des cellules reproductrices à maturité. Chez les algues, ce sac, appelé gamétocyste (gamétange) ou sporocyste (sporange) est simplement entouré par la paroi cellulaire.
Chez le mâle, la cellule mère va se diviser pour former des petites cellules sphériques dépourvues de pigment et sans flagelles qui forment des zones blanchâtres dans les tissus!: les spermaties. Ces spermaties sont contenues dans le gamétocyste / sporocyste mâle, appelé spermatocyste, spermatange ou anthéridie, qui peuvent être externes ou dans le cortex du thalle. Chez la femelle, l’organe reproducteur est le procarpe, qui contient un gamétocyste femelle!: le carpogone. Ce carpogone, aussi appelé oogone ou oocyste, est un sac avec une partie sphérique, le ventre de l’oogone, qui contient le gamète femelle (oosphère) et une partie allongée, le trichogyne. Le carpogone s’associe parfois à des cellules associées du thalle, formant un rameau carpogonial, qui peut être libre ou protégé par le cortex. Il peut aussi s’associer à des cellules auxiliaires nourricières!: le gonophore. La spermatie va se fixer sur le trichogyne, les parois et les membranes vont fusionner. Le noyau mâle arrive au niveau de l'oosphère et la caryogamie se produit pour former un zygote diploïde. Le zygote va former des filaments qui constitueront un carposporophyte. Le carposporophyte est un tissu qui se développe sur la femelle par la formation de filaments (gonimoblastes). A maturité, il formera des sacs (carposporophytes ou carposporanges) qui contiendront chacun un carpospore. Chez les algues rouges les plus évoluées qui possèdent un cortex, le carposporophyte peut être entouré par le cortex pour former un organe!: le cystocarpe. Les carpospores diploïdes se fixent sur un substrat et donnent naissance à un tétrasporophyte qui formera des sacs (tétrasporophytes ou tétrasporanges), qui peuvent se regrouper dans le cortex pour former un sore. A maturité, ce sac contient 4 spores issus de la méiose de la cellule mère!: on parle de tétraspore. Les tétraspores vont être libérés par déchirement de l’enveloppe du tétrasporocyste. Les spores vont se fixer sur le substrat pour germer et donner des gamétophytes haploïdes.
C) Cycles de vie des Floridées Les Floridées sont généralement des espèces dioïques!: les sexes sont séparés (contrairement aux monoïques). •
Cycles isomorphes!: Polysiphonia spp.
Le cycle est isomorphe!: toutes les générations sont identiques (gamétophyte mâle, femelle et tétrasporophyte).
•
Cycles hétéromorphes!: Asparagopsis armata Le gamétophyte mâle est du même aspect que le gamétophyte femelle, mais ils sont différents du tétrasporophyte. Ce tétrasporophyte forme des petites boules filamenteuses qui peuvent se détacher du substrat et flotter dans la masse d’eau. Ils étaient avant décrits comme une espèce différente!: Falkenbergia rufolanosa. Les tétraspores vont donner des thalles dressés fixés avec des crampons.
•
Cycle hétéromorphe!: Mastocarpus stellatus Le gamétophyte mâle ressemble au gamétophyte femelle, mais ils sont différents du tétrasporophyte. Le tétrasporophyte forme un thalle encroûtant sur la roche, qui était avant décrit comme une autre espèce!: Petrocelis cruenta.
•
Cycle de vie hétéromorphe!: Palmaria palmata
Le gamétophyte mâle est différent du gamétophyte femelle, mais il a le même aspect que le tétrasporophyte. Le mâle est un grand thalle fixé, alors que la femelle est microscopique et ne dépasse pas les 100 µm. La fécondation se fait sur la femelle. Le zygote va se comporter comme un carposporophyte!: il se différencie directement en carpospore sans passer par le stade filamenteux du carposporophyte. Ce carpospore se différencie lui aussi directement en tétrasporophyte formé d’un grand thalle fixé. Les tétrasporocystes vont se regrouper en sores qui libèrent des tétraspores qui iront se fixer pour donner soit des gamétophytes femelles microscopiques soit des gamétophytes mâles dressés.
D) Reproduction chez les Bangiées Les Bangiées ont une structure simple, le thalle est soit un archéthalle soit un nématothalle. Le cycle de vie est hétéromorphe. Les espèces sont dioïques ou monoïques. L’appareil femelle est simplifié!: le trichogyne est absent, et remplacé par une petite protubérance appelée papille. Le zygote se transforme directement en carposporocystes, sans passer par le stade filamenteux. Cycle de vie de Porphyra sp. :
La reproduction se fait sur le bord du thalle. Sur le thalle mâle ou sur la partie mâle du thalle, les cellules végétatives vont devenir des cellules mères des spermaties qui vont perdre leurs chloroplastes et se diviser par mitose. On aura 64 spermaties par sac. Le thalle va se déchirer et les spermaties seront libérées dans la masse d’eau. Sur le thalle femelle ou sur la partie femelle du thalle, les cellules végétatives se transforment, avec l’apparition de la papille. La gamie se fait au niveau de la gamie, pour former 8 à 32 carpospores. Les carposporophytes vont germer sous forme de filaments appelés conchocelis (qui remplacent le tétrasporophyte). Souvent, la germination se fait dans des coquilles vides de bivalves ou sur un support calcaire. Le conchocelis va donner 4 à 10 conchospores qui vont donner des gamétophytes.
E) Reproduction végétative Même si la reproduction est généralement sexuée, on retrouve des formes de reproduction végétatives!: −
les spores directs (Porphyra sp.), cellules qui s’individualisent : monospores, paraspores (groupements de spores), séirospores (files de spores).
−
les stolons!: axes rampants qui vont générer des thalles dressés.
−
la fragmentation (bouturage)!: le thalle se casse et se refixe sur la roche (Gracilaria sp., Eucheuma sp., Chondrus sp.)
−
les propagules ou ramules!: ramifications latérales qui se détachent pour redonner des thalles entiers (Solieria sp., harpons d’Asparagopsis armata)....
Similar Free PDFs

Les rhodobiontes : les rhodophycées
- 10 Pages

Les protides et les protéines
- 6 Pages

Les 1 - eerste les beknopt
- 3 Pages

LES 5 - notities les 5
- 6 Pages

Les glaneuses
- 4 Pages

Les mycètes
- 13 Pages

Les successions
- 8 Pages
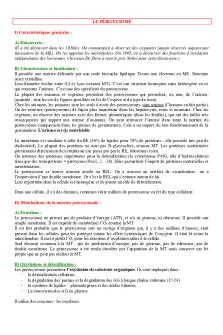
Les péroxysomes
- 5 Pages

Samenvatting LES PER LES Duits II OM
- 49 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu






