Les mycètes PDF

| Title | Les mycètes |
|---|---|
| Course | Biologie / Microbiologie / Physiologie |
| Institution | Université de Caen-Normandie |
| Pages | 13 |
| File Size | 511.3 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 41 |
| Total Views | 143 |
Summary
Cours sur les Mycètes...
Description
Chapitre I Les mycètes, les champignons Les champignons (mycètes) ne sont plus placés parmi les végétaux. Les champignons constituent un règne autonome : le règne fongique. Les champignons sont des eucaryotes non chlorophylliens, ils sont donc hétérotrophes par absorption. Les champignons représentent une grande diversité (morphologie, couleur, mode de vie ...).
I. Biologie caractéristique des mycètes A) Cytologie et biochimie Paroi : La chitine (polymère de N-acétyl-glucosamine), polysaccharide dont l'unité de base azotée dérive du glucose (polymère équivalent à la carapace des insectes, crabes...) Attention, il y a de la cellulose chez les Peronosporomycètes (pseudomycètes) ! Réserves : glycogène, principal polysaccharide de réserve comme chez les animaux et inclusions lipidiques. Membrane plasmique : un stérol caractéristique, l'ergostérol. Noyau : de petite taille. Le déroulement de la division nucléaire diffère de celui des plantes et des animaux. La mitose et la méiose dites fermées se traduisent par une persistance de l'enveloppe nucléaire lors de la division, la partition entre les deux noyaux-fils se fait par étranglement médian de l'enveloppe nucléaire. Le fuseau se forme dans le noyau, sauf chez quelques Basidiomycètes où il se forme à l'extérieur et pénètre dans l'enveloppe. Les champignons sont dépourvus de centriole mais possèdent des corpuscules polaires aux pôles du fuseau. Exception : les chytridiomycètes.
B) Organisation de l'appareil végétatif Thalle : unicellulaire chez les levures, mais pluricellulaire filamenteux le plus souvent. Les filaments fongiques sont appelés des hyphes (une hyphe). L'ensemble des hyphes est appelé mycélium. Les filaments peuvent s'associer pour former une pseudo-tissu, le plectenchyme. Couramment, le champignon correspond à la fructification appelée sporophore (appareil portant les spores) mais en biologie végétale, le champignon est l'équivalent du mycélium. Il existe deux types de filaments : Hyphes non-cloisonnées hyphes coenocytiques multinucléées
Hyphes cloisonnées
Hyphes cloisonnées : le septum (cloison) est traversé par un pore central (dolipore) chez les Basidiomycètes.
!1 sur ! 13
C) Mode de croissance Dépend de la nature et de l'exploitation du substrat : Le champignon rayonne autour de sa semence, Formation d'un thalle plus ou moins circulaire, Croissance apicale.
1) Croissance apicale Les filaments des mycéliums croissent par leur apex. L'élongation résulte d'un flux cytoplasmique qui oriente des vésicules sécrétrices (avec précurseurs de la paroi) vers l'apex. Exocytose : les précurseurs se déversent à l'extérieur de la membrane plasmique. Extension de la paroi plus fine à l'extrémité du filament. La paroi passe progressivement d'un état visco-élastique à un état rigide. 2) La formation des ramifications Elles s'établissent tardivement au niveau de la paroi rigidifiée, il y a dégradation de cette paroi par excrétion localisée d'enzymes lytiques.
II. La reproduction des mycètes Les mycètes se reproduisent par des spores, cellules spécifiques dont la germination produit un nouveau mycélium. Ces spores résultent :
- d'une multiplication asexuée - d'une reproduction sexuée
Les spores sont : - non-mobiles (exception chez les Chytridiomycètes) - présentent des formes de résistance aux conditions défavorables - produites en grande quantité donc ont une importante capacité de prolifération pour les champignons. Certains champignons se reproduisent par multiplication végétative (fragmentation de leurs hyphes).
A) Multiplication asexuée Deux types de spores :
Endospores
Exospores (conidies)
Produites à l’intérieur du sporocyste
Générées en continue l’extrémité de cellules d’hyphes spécialisées = cellules conidiogènes (phialides)
!2 sur ! 13
B)Reproduction sexuée (trois étapes) 1) Plasmogamie : fusion des cytoplasmes ! 2) Caryogamie : fusion des noyaux. La caryogamie peut s'effectuer immédiatement et aboutir à un zygote (2n), mais elle peut également différer dans le temps : - deux noyaux haploïdes forment un dicaryon (n+n) - les noyaux se divisent, production d'un filament dicaryotique puis fusion des noyaux (zygote 2n) ! 3) Méiose
La reproduction sexuée aboutit à la formation de spores
C) Cycle de développement d'un champignon
Alternance des deux générations en général (n / n+n / 2n)
La phase 2n n'est représentée que par le zygote (méiose zygotique)
!3 sur ! 13
D. La fécondation La fécondation se déroule selon diverses modalités, elles sont différentes d'un groupe à l'autre et entre deux espèces. Les gamètes sont produits par les organes de reproduction, les gamétocystes. Dans certains cas, les gamètes sont réduits au noyau.
Homothallisme : phénomène autorisant la fécondation entre les organes reproducteurs produits par un même thalle, espèce autofertile. Hétérothallisme : la fécondation s'effectue entre deux thalles sexuellement compatibles + et -. Ces thalles sont issus de la germination de deux spores de potentialité sexuelle différente + et -.
III. Le mode de vie des champignons Ne pouvant pas photosynthétiser car étant dépourvus de chlorophylle, les champignons sont hétérotrophes pour la carbone. Ils vivent : - en saprophytes : ils exploitent la matière organique morte, ils décomposent végétaux et animaux. Parfois ce rôle de décomposeur peut s'avérer très nuisible comme la Mérule (Serpula lacrymans, champignons qui s’attaque au bois de construction).! - en parasites : Ils exploitent de la matière organique vivante, ils sont souvent pathogènes et provoquent des mycoses chez les animaux et de nombreuses maladies chez les plantes. Chez les plantes, ces champignons parasites sont des agents de mildious, des rouilles et des charbons.! Le thalle des champignons parasites s'introduit dans les tissus de l'hôte, il atteint les cellules dont il détourne à son profit les produits du métabolisme. La pénétration se fait : ‣ par les stomates ‣ par des suçoirs intracellulaires (haustories) Formation d'un suçoir (haustorium) : Le filament digère complètement la paroi de la cellule hôte en sécrétant des enzymes lytiques (cellulases et hemicellulases). Par le trou réalisé, il pénètre dans la cellule parasitée en repoussant la membrane plasmique et le cytoplasme. Les suçoirs assurent une large surface d'absorption. Champignons parasites des végétaux : - Puccinia graminis (Basidiomycète) Rouille de blé - Claviceps purpurea (Ascomycète) Ergot de seigle, sclérote de résistance - Taphrina deformans (Ascomycète) Cloque du pêcher - Polypore du Bouleau (Basidiomycète) - en symbiose : association à bénéfices réciproques entre un champignon hétérotrophe et un végétal autotrophe. Avec les végétaux vasculaires, les symbioses sont réalisées au niveau des racines, ce sont des mycorhizes. L'association de ces champignons avec des algues vertes ou des cyanobactéries donne les lichens. Usnea arizonica, lichen affectionnant les zones arides
!4 sur ! 13
IV. Rôle des champignons dans la Biosphère Les champignons sont écologiquement importants car ils sont les principaux agents de décomposition de la matière organique au même titre que les bactéries. Ils constituent un maillon du cycle de la matière et participent aux équilibres biocénotiques. Ils absorbent leur nourriture en sécrétant des enzymes digestives qui catalysent la décomposition de grosses molécules suffisamment petites pour être absorbées par la cellule du champignon.
V. Classification des mycètes -Les coenomycètes (hyphes coenotypiques) : - Zygomycètes - Gloméromycètes - Chytridiomycètes Les dicaryomycètes : - Ascomycètes - Basidiomycètes Les Eumycètes :
CLASSE
Spores flagellées
Chytridiomycètes + (un flagelle) Zygomycètes Gloméromycètes Ascomycètes
-
Basidiomycètes
-
Spores non flagellées
Hyphes cœnocytiques
Hyphes cloisonnées
+ + + ascospores (dans asque) + basidiospores (portées par baside)
+ + +
-
-
+ (dicaryotiques)
-
+ (dicaryotiques)
Les Pseudomycètes : Peronosporomycètes (Oomycètes)
Spores flagellées (hétérokontées) Hyphes coenocytiques
Environ 100 000 espèces de mycètes ont été décrites mais on estime leur nombre à un million.
Mycètes
Champignon de Paris
Domaine
Eucaryote
Eucaryote
Ordre
-ales
Agaricales
Règne
Fungi
Fungi
Famille
-aceae
Agaricaceae
Phylum
-mycota
Basidiomycota
Genre
--
Agaricus
Classe
-mycètes
Basidiomycètes
Espèce
--
bisporus
!5 sur ! 13
VI.Les Eumycètes A) Les chytridiomycètes ou chytrides Les chytrides sont considérés par la phylogénie comme la forme la plus primitive des champignons. Ils : - sont aquatiques, présents surtout dans les eaux douces - sont saprophytes ou parasites, dégradent la chitine et la kératine - possèdent des spores à un seul flagelle - ont un thalle cœnocytique Quelques espèces de chytrides sont connues pour occasionner la mort des grenouilles en bloquant leurs organes respiratoires, d'autres peuvent s'attaquer au maïs ou à la luzerne. Les chytridiomycètes ne sont pas pathogènes pour l'Homme. Exemples : Allomyces
B) Les zygomycètes Champignons microscopiques, typiquement des moisissures. Leur mycélium est coenotypique. Leurs spores sont dépourvues de flagelles. Principaux ordres des zygomycètes : • Les Mucorales : parfois parasites de l'Homme (mycoses). Le plus souvent saprophytes (moisissures), auxiliaires de l'industrie chimique et pharmaceutique.! Ex : Mucor, Rhizopus, Pilobolus. • Les Endogonales : abondants dans le sol, vivent en symbiose avec de nombreuses plantes supérieures. • Les Entomophthorales : parasites des plantes et animaux! Ex : Entomophthora muscae, tueur de mouche.
1) Multiplication asexuée Sur le mycélium se dressent des filaments au bout desquels se trouvent de petites boules noires, les sporocystes, portées par les sporocystophores. Le sporocystophore se prolonge dans le sporocyste par une columelle. Le contenu du sporocyste se fragmente en un grand nombre de spores (sans flagelle) qui germent en redonnant un mycélium haploïde.
2) Reproduction sexuée Les gamétocystes se forment à partir d'un mycélium haploïde. Ils s'individualisent à l'extrémité de ramifications qui se renflent (= progamétocystes). Ils se séparent du filament porteur (ou suspenseur) par un cloisonnement. Les gamétocystes sont attirés l'un par l'autre et fusionnent en donnant un zygote : c'est la plasmogamie. Le zygote s'entoure d'une paroi épaisse et contient plusieurs noyaux (zygospore). Dans un premier temps, les noyaux se multiplient et fusionnent (+ et -) : c'est la caryogamie. Puis tous les noyaux 2n dégénèrent sauf un qui subit la méiose au moment de la germination de la zygospore en sporocyste de germination. La fécondation est une cystogamie. Il faut que ces gamétocystes soient compatibles : hétérothallisme.
!6 sur ! 13
3) Cycle de reproduction (haplophasique) Voir poly
C) Les ascomycètes Groupe le plus important des mycètes, le plus diversifié avec des grandes variétés d'appareils reproducteurs, de modes de vie et de dissémination Grande importance économique. Très recherchés pour leur valeur gastronomique (Morilles, Truffes). Quelques-uns sont de redoutables parasites des végétaux, animaux et de l'Homme. A l'exception des levures unicellulaires, l'appareil végétatif (le thalle) est formé d'hyphes cloisonnées. Les ascomycètes sont caractérisés au cours de la reproduction sexuée par leur sporocyste : l'asque libérant des ascospores (spores endogènes) et leur mycélium dicaryotique, stade séparant la plasmogamie de la caryogamie. La multiplication asexuée implique des conidies. Les ascomycètes sont des saprophytes, parasites des plantes et des animaux, ou symbiotiques dans des mycorhizes ou des lichens. Ils sont responsables d’un grand nombre de maladies chez les végétaux et l'Homme (Aspergillus flavus produit des mycotoxines responsables du cancer du foie) Certains sont valorisés par l'Homme : • ex. Les Penicilliums servent à la fabrication de fromages (P. roqueforti / P. camemberti) • Aspergillus oryzae : saké Produisent de nombreux antibiotiques. Le premier fut découvert par Flemming à partir d’une souche de pénicillium : la penicilline.
1) Multiplication asexuée Prédominante chez les ascomycètes. Elle est réalisée par les conidies provenant du bourgeonnement de cellules conidiogènes : les phialides. Pour faciliter la dispersion des conidies, les phialides sont groupées à l'extrémité de conidiophores. 2) Reproduction sexuée Les deux filaments mycéliens sont sexués (+ et -) et monocaryotiques (ou primaires). L'un forme un ascogone (gamétocyste femelle) et l'autre une anthéridie (gamétocyste mâle). L'ascogone, grâce à un filament capteur appelé trichogyne, fusionne avec l'anthéridie. Les noyaux passent dans l'ascogone. C'est la plasmogamie. Les noyaux s'apparient dans l'ascogone et donnent le mycélium dicaryotique (ou secondaire) qui élabore le sporophore (fructification). La fécondation est une trichogamie.
!7 sur ! 13
3) Le mode d'allongement du mycélium dicaryotique L'article terminal de l'hyphe dicaryotique émet un crochet tandis que le noyau subissent une division conjuguée. Deux cloisons délimitent trois cellules. Une cellule est binucléée, alors que la cellule du crochet (uninucléée), va fusionner avec la cellule-pied également uninucléée. Le crochet se résorbe, c'est le phénomène de la "dangeardie". 4) Formation de l'asque L'article terminal subit la caryogamie. Les deux noyaux dicaryotiques fusionnent pour former un noyau diploïde qui est le seul noyau 2n du cycle. La caryogamie est différée dans le temps par rapport à la plasmogamie. L'article terminal 2n s'allonge pour former l'asque. Le noyau 2n subit une méiose généralement suivie d'une mitose. L'asque contient 8 noyaux. Les noyaux s'entourent de cytoplasme et s'individualisent en ascospores (4+ et 4-). L'asque devient turgescent à maturité et les ascospores sont expulsées à l'extérieur via un opercule. Des hyphes mycéliennes haploïdes se multiplient et forment des paraphyses. L'ensemble des asques et paraphyses forme l'hyménium. Selon les genres, les asques sont regroupées au sein de structures : ascocarpes (sporophores) de complexité variable. Trois types : - le cléistothèce, sans ouverture - le périthèce, qui présente le plus souvent une ouverture : l'ostiole - l'apothécie, se présentant sous la forme d'une coupe largement ouverte (Peziza) Morchella (morille) 5) Cycle de développement Voir poly 6) Les levures Ascomycètes unicellulaires, exploitées pour leur capacité de fermentation alcoolique des sucres. Genre = saccharomyces Agents de fermentation : • saccharomyces cerevisiae : fermentation de la bière • saccharomyces apiculatus : fermentation du cidre • saccharomyces minor : fermentation du pain La multiplication asexuée se fait par bourgeonnement :
Qui finit par former des chaînettes !8 sur ! 13
La reproduction sexuée : - fusion de deux levures - puis méiose : formation de 4 ascospores haploïdes
D) Les Basidiomycètes Groupe le plus familier car il comporte des espèces dont la fructification, le carpophore (sporophore), est typique (Agaricomycotina). Attention ! Tous les basidiomycètes n'élaborent pas de carpophore. Ce sont des parasites appelés : rouilles et charbons, agents pathogènes pour les plantes (Pucciniomycotina et Ustilaginomycotina). Phallus impudicus et hypholome en touffe : Thalle avec hyphes cloisonnées Les basidiomycètes sont caractérisés au cours de la reproduction sexuée par leur sporocyste : la baside, portant les basidiospores et leur mycélium dicaryotique, stade séparant la plasmogamie de la caryogamie. La multiplication asexuée est limitée, elle se réalise par la formation de conidies. 1) Reproduction sexuée Le mycélium primaire ne différencie plus d'organes de reproduction, il y a simple fusion entre 2 articles appartenant à 2 filaments (n) de potentialités sexuelles différentes (+ et -). C'est la plasmogamie.
!9 sur ! 13
La plasmogamie conduit à la formation d'un mycélium secondaire qui élabore le carpophore (quand il existe).
2) Mode d'allongement des hyphes Se fait par la formation de connexions à boucles (voir poly)
3) Formation de la baside L'article terminal subit la caryogamie. La méiose se produit et l'article terminal se transforme en baside portant à l'extrémité de stérigmates, 4 basidiospores. Sous le carpophore, l'hyménium est producteur de basides. Cet hyménium peut être disposé en lamelles ou sous forme de tubes (ex. Bolet).
4) Cycle de développement d'un basidiospore à carpophore Ex. Le Coprin (voir poly)
5) Développement du carpophore d'une amanite Voir poly
6) Basidiomycètes mortels Amanite phalloïde (Amanita phalloïdes), Entolome livide (Entoloma lividum), Hypholome en touffe (Hypholoma fasciculare)
7) Basidiomycètes toxiques Amanite panthère (Amanita pantherina).
8) Basidiomycètes hallucinogènes Certains champignons du groupe Psilocybe produisent de la psilocybine qui provoque des hallucinations, le plus courant est le Psilocybe semilanceata ou psilo ou «Liberty Cap» ou champignon magique. Amanite Tue Mouches (Amanita muscaria)
9) Basidiomycètes comestibles Amanite rubescens ou vineuse, Cèpe de Bordeaux (Boletus edulis), Chanterelle (Cantharellus cibarius), Trompette de la Mort (Craterellus cornucopioides), Agarie campestris, Pied de mouton qui a des aiguillons (Hydnum repandum), Lepiote élevée (Lepiota procera).
!10 sur 13 !
VII. Les Pseudomycètes A)Les péronosporomycètes (anciennement Oomycètes) 1) Présentation Ils présentent un mycélium cœnocytique. La RAS est caractérisée par la formation de cellules reproductrices à deux flagelles inégaux un lisse et une plumeux (comparables à ceux de certaines algues brunes). La paroi est constituée de microfibrilles de cellulose.! La RS se fait par oogamie. Beaucoup d'espèces saprophytes mais aussi parasites d'animaux et de végétaux. Deux ordres principaux : • Les saprolegniales dont l'habitat est aquatique. Saprolegnia parasitica s’attaque aux poissons et aux animaux aquatiques. Le mycélium prolifère sur les téguments jusqu’à envahir complètement l’animal. • Les péronosporales sont adaptés à la vie terrestre et ne comportent que des parasites des végétaux. Responsable de maladies chez les végétaux. Plasmopara viticola Plasmopara infestans Plasmopara tabacina
sont agents des mildious
de la vigne de la pomme de terre du tabac
2) Cycle de Plasmopara viticola Originaire d’Amérique, attaque la vigne. Il est arrivé accidentellement en Europe à la fin des années 1870 en introduisant des plants de vignes américains résistants à un puceron qui ravageait alors les vignes en France. C’est un parasite de la vigne qui se trouve sur les feuilles et les grappes. Dans les tissus, il développe un mycélium diploïde qui envoie des suçoirs dans les cellules hôtes. Multiplication asexuée : sur la face inférieure des feuilles se développe des taches translucides jaunes ("taches d'huile") qui se couvrent d'un feutrage blanchâtre à grisâtre et se nécrosent par la suite. Le mycélium (2n) de la face inférieure de la feuille fait sortir par les stomates des filaments, les sporocystophores portant des bouquets de sporocystes. Chaque sporocyste est porté par un stérigmate. La dissémination de la maladie se fait par les sporocystes qui, entraînés par le vent et l'eau, se déposent sur les différents organes de la vigne et libèrent les zoospores (spores flagellées, besoin d...
Similar Free PDFs

Les rhodobiontes : les rhodophycées
- 10 Pages

Les protides et les protéines
- 6 Pages

Les 1 - eerste les beknopt
- 3 Pages

LES 5 - notities les 5
- 6 Pages

Les glaneuses
- 4 Pages

Les mycètes
- 13 Pages

Les successions
- 8 Pages
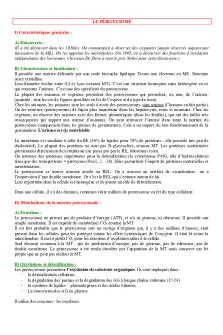
Les péroxysomes
- 5 Pages

Samenvatting LES PER LES Duits II OM
- 49 Pages

Les Microtubules
- 7 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu





