Les modèles de la mémoire PDF

| Title | Les modèles de la mémoire |
|---|---|
| Course | Licence 1 |
| Institution | Université de Strasbourg |
| Pages | 6 |
| File Size | 134.3 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 61 |
| Total Views | 136 |
Summary
cours sur les modèles de la mémoire...
Description
Les modèles de mémoire
Intro : mémoire : capacité à stocker une info et à la restituer en l’absence du message originel. Elle a été la première fonction cognitive étudiée de façon systématique en laboratoire. Les scientifiques vont essayer d’isoler les processus fondamentaux dans la mémoire, pour les étudier séparément : caractéristiques de la mémoire ? Cmt stocke-t-on? Cmt récupère-t-on ?
I. La démarche de la psycho cognitive : l’expérimentation L’objectif est d’isoler les différents processus cognitifs nécessaires à la réalisation d’une tâche, pour pouvoir les étudier spécifiquement. Pour cela, les psychologues vont mettre en place des processus expérimentaux en laboratoire, où ils vont manipuler la structure de l’envt de la tâche, et voir les effets de ces manipulations sur le cmpt des sujets. Ils vont contrôler les situations expérimentales pour étudier la fonction qui les intéresse. Les conséquences des manipulations vont servir de base aux inférences des psychologues mises en œuvre pour la réalisation de la tâche. Il faut mettre au point des tâches qui présentent une double caractéristique : - elles peuvent être analysées sans ambigüité, càd qu’elles concernent une fonction cognitive spécifique. - on doit pouvoir généraliser les résultats hors du labo, càd qu’ils doivent pouvoir être appliqués à la cognition au quotidien (des tâches qui utilisent des processus cognitifs familiers) Processus expérimental : à partir d’une hypothèse, on met en place une expérimentation qui validera ou invalidera l’hypothèse. On arrive alors à l’élaboration d’un modèle de mémoire, qui fait naître de nouvelles hypothèses, qui entrainent de nouvelles expérimentations, qui aboutissent à de nouveaux modèles, etc…
II. Théories et modèles en psychologie cognitive Il existe plsr niveaux de théorisation, nous en verrons trois : - niveau des cadres conceptuels : ensemble de résultats, d’idées et de postulats dans un domaine spécifique, considéré ni comme vrai, ni comme faux. Ils vont guider la recherche. C’est le niveau le plus général.
- niveau des théories : ensemble de postulats expliquant un phénomène. Peut être vrai ou faux, et est testable. Ce niveau est à l’intérieur du 1er niveau. - niveau des modèles : décrit précisément la manière dont on effectue une tâche cognitive, avec les différentes étapes nécessaires. Un modèle est plus précis qu’une théorie. Les modèles peuvent être computationnels ou non. Computationnel veut dire qu’ils ont été testé par expérimentation, mais aussi par simulation sur un ordinateur.
III. la nécessaire collaboration de différentes approches et de différentes disciplines au sein de la psycho cognitive. Il y a deux types de contraintes en cognitive, qui donnent lieu à deux approches différentes : - les contraintes structurelles (mémoire en deux parties : MCT et MLT), qui donnent lieu à une approche structuraliste - les contraintes fonctionnelles, qui sont les caractéristiques des processus cognitifs et des représentations mentales (rapidité, précision du déclenchement et de la réalisation d’un processus mnésique), qui donne lieu à l’approche fonctionnaliste. Plusieurs disciplines s’intéressent aux mêmes points, il leur faut donc un voc et des méthodes communes, pour pouvoir utiliser chacun les découvertes faites par les autres, pour pouvoir comparer.
Chap 1. Les méthodes d’étude de la mémoire I. Le paradigme d'étude de la mémoire 3 phases dans le paradigme d’étude de la mémoire : - encodage : phase durant laquelle une info d(origine perceptive va être transformée en une représentation mentale plus ou moins stable et plus ou moins associée à d’autres représentations. - stockage : stockage de l’info ac formation d’un engramme (trace mnésique) - récupération/réactivation : interaction d’indices externes (ex : demande de rappel des trois mots dits précédemment) avec l’info stockée. Cette interaction, ou « ecphorie » réactive les représentations mentales telles qu’elles avaient été formées lors de l’encodage A partir de ce paradigme, on peut faire varier les trois phases pour les étudier :
- Faire varier les conditions d’encodage, en jouant sur les modalités perceptives utilisée (ouïe, vue..), sur les contraintes temporelles, sur l’état émotionnel.. - Faire varier les conditions de stockage faisant des interférences, pour perturber cette étape. Faire varier les conditions de récupération, en donnant au sujet des clés d’accès, des indices pour récupérer l’info ; ou en veillant à ce que les conditions d’encodage correspondent aux conditions de récupération. Ce paradigme entraine deux types de méthodes : directe et indirecte 1. Méthode directe Les sci placent le sujet dans une condition exp. où il doit se rappeler intentionellement d’un épisode antérieur de son existence. Cet épisode est clairement défini dans l’espace et le temps. On distingue deux méthodes : • Le rappel : le sujet doit restituer et se souvenir d’une info à laquelle il a été confronté dans le passé, mais qui n’est plus perceptivement disponible. Deux méthodes de rappel : - rappel libre : quantité d’indices fournis minimale - rappel indicé : fournir un certain nombre d’indices pour aider le sujet • la reconnaissance : le matériel qui a été mémorisé est à nouveau présenté au sujet, mais mélangé à un autre matériel de la même classe. Attention : on ne compare pas des performances obtenues avec des méthodes différentes. 2. Méthode indirecte Le sujet ne sera pas interrogé explicitement, on ne fera aucune référence à un évt antérieur vécu par le sujet. On entraine le sujet dans des tâches cognitives, et on mesure par après sa facilitation (en terme de rapidité, précision…). La mesure de facilitation est une mesure indirecte de la mémoire. Ex : on mesure en quoi la réalisation d’un premier exercice facilite la réalisation d’un deuxième exercice, en terme de rapidité, de précision, de nombre de bonnes rép… On apprend à lire en typographie inversée à des sujets. Un an plus tard, on appelle ces mêmes sujets et on leur présente des phrases à lire, certaines qu’ils avaient déjà lues lors de leur entrainement, d’autres pas. On constate moins d’erreur dans les phrases connues que dans les inconnues Différentes sortes de méthodes indirectes : - le conditionnement, pour les animaux
- méthode d’économie au réapprentissage, d’Ebbinghaus. - méthode d’amorçage (priming) : on va présenter au sujet un matériel à identifier (un mot). Dans une condition de contrôle, la tâche du sujet est d’identifier le mot lors de sa présentation (temps de présentation très court). Dans la condition expérimentale, on va présenter au sujet un mot amorce, de façon subliminale ou non. On va mesurer le temps de réaction (temps mis pour identifier le mot cible) dans chaque condition, et la probabilité d’apparition de la bonne réponse. On dit qu’il y a un effet d’amorçage qd la proba d’apparition bonne rep ds condition exp est sup à celui dans la condition de contrôle, et si le tps de réaction est inférieur ds cond exp. Deux classes principales d’amorçage (différents en ce qui concerne le mot-amorce) : - de répétition : on présente en amorce la même info que celle présentée après. On pense que cela facilitera le traitement ultérieur de la deuxième info. - sémantique : on présente une info associée au mot cible, pour faciliter le traitement ultérieur du mot cible. La mémoire est vue comme un ensemble de boites, où l’information passe de manière linéaire, d’une boite à l’autre. La MCT et la MLT sont des modèles à boite/dualistes.
II. Modèle de Waugh et Norman Schéma :
Tout stimulus auquel le sujet prête attention entre en mémoire primaire. La capacité de celle-ci est limitée. Donc, si de nouveaux items entrent en mémoire primaire, ils vont remplacer les items déjà existants en mémoire primaire. Les items remplacés seront oubliés. Si un item est répété, son passage en mémoire secondaire est facilité. Le passage en mémoire secondaire le rend insensible aux nouveaux stimuli. Expérience pour illustrer la notion d’interférence : On présente à des sujets une série de 16 chiffres, présentés à vitesse constante, soit à raison de 1 chiffre/sec, soit à raison de 4 chiffres/sec. Le dernier chiffre présenté est le chiffre
indice. Le sujet doit retrouver ce chiffre dans la série, et indiquer le chiffre le précédent. Celui-ci est appelé chiffre-cible. Ex : 1 3 6 7 5 3 4 9 8 5 6 7 4 3 6 9 Le 9 est le chiffre indice, le 4 est le chiffre cible. Le nombre de chiffre entre cible et indice varie (càd que le nombre de stimuli interférents est plus ou moins important). Résultats : - le pourcentage de rappel correct est plus élevé lorsque le nombre de stimuli interférents est plus faible - le pourcentage de rappel correct est plus élevé lorsque la vitesse de présentation est plus élevée. Comme il n’y a pas de notion de déclin passif en MCT, la seule explication au fait que le rappel correct est moindre lorsque les deux stimuli sont plus éloignés est le rôle joué par les stimuli interférents entre cible et indice.
III. Le modèle d’Atkinson et Shiffrin C’est le modèle le plus élaboré, et le plus cité. Il distingue les caractéristiques structurales des processus de contrôle. - caractéristiques structurales : ce sont les registres de base : registre sensoriel, registre à court terme, registre à long terme. Ils sont invariants quelque soit la situation. - processus de contrôle : ils concernent le codage de l’information, l’autorépétition et la recherche dans la mémoire. Ils varient selon la situation, et peuvent être élaborés et modifiés par le sujet. Le choix du processus est lié à la tâche, aux consignes données, et au sujet en tant que tel. Schéma :
Ici, la MCT est considérée comme la MT du sujet. Le processus clé du stockage de l’info en MLT est l’autorépétition mentale. Son rôle est de maintenir les informations dans le registre à court terme, et donc d’augmenter la probabilité de transfert de ces infos dans le registre à long terme.
1. Le registre sensoriel L’information est stockée selon sa propre dimension (càd sous forme tactile, visuelle, auditive…), et pour une durée très brève (inférieur à 1s) Exp de Sperling : on va présenter au sujet, durant une durée très brève (environ 50 mls, grâce à un tachistoscope), un pattern de 4 lettre sur 3 : A G D V d BKRT d M P QV
1ère condition : report complet : les sujets doivent rappeler le maximum de lettres présentées. 2ème condition : report partiel : l’expérimentateur associe, avant l’expérience, un son à chaque ligne, faible pour la première, plus fort pour la deuxième, et encore plus pour la troisième. Les sujets apprennent l’association ligne/son avant l’expérience. Juste après la présentation, un son se fait entendre, correspondant à une des trois lignes, et les sujets doivent rappeler le max de lettres correspondant à cette ligne. Résultats : -cond° 1 : 4 à 5 lettres sur 12, soit entre 32 et 42% des lettres. - cond° 2 : 3 lettres sur 4, soit 75% des lettres. Il y a donc proportionnellement plus de lettres rappelées dans le report partiel. Explication : le sujet aurait pendant une durée très brève, une trace mnésique visuelle, disparaissant très rapidement. Le sujet va lire cette trace visuelle pour restituer des lettres. Mais le seul temps de rappel des premières lettres suffit à faire disparaitre l’image. La même chose se produit dans la seconde condition, mais dans la seconde, le sujet sait immédiatement quelle ligne il doit lire. Hyp : la mesure observée en report partiel est une estimation de la quantité d’info disponible dans la mémoire visuelle transitoire. Neisser a proposé d’appeler cette mémoire la mémoire iconique. Comment déterminer la durée de la mémoire iconique ?...
Similar Free PDFs

Les effets de la demande
- 1 Pages

Les bases de la couleur
- 7 Pages

Les propriétés de la lumière
- 3 Pages

Les modèles de la mémoire
- 6 Pages

Les enjeux de la parentalité
- 2 Pages

LES Raisins DE LA Colere
- 11 Pages
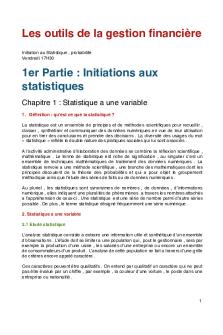
Les outils de la gestion financière
- 51 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu








