Sociologie de l\'action publique PDF

| Title | Sociologie de l\'action publique |
|---|---|
| Course | Sociologie des organisations |
| Institution | Université Toulouse I Capitole |
| Pages | 17 |
| File Size | 457.4 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 5 |
| Total Views | 139 |
Summary
Download Sociologie de l'action publique PDF
Description
Sociologie de l’action publique Chapitre introductif : Qu’est-ce que l’Action publique ? I.
Qu’est ce que l’action publique ? lments de dfinition
Les politiques publiques font partie pleinement de notre vie quotidienne. Tous nos comportements politiques, individuels, societaux sont influencés et déterminés par des politiques publiques. L’alimentation dépend des politiques agricoles & environnementales, sanitaires… Nos loisirs qui dépendent des politiques culturelles, territoriales, touristiques… Nos activités professionnelles s’inscrivent dans les politiques publiques, que ce soit en tant qu’acteur de la politique publique (magistrat, enseignant…) mais également en tant que ressortissant de l’action publique (étudiant par exemple). Tout acteur social quel qu’il soit est en permanence confronté à l’action publique, le plus généralement comme destinateur mais quelque fois comme producteur également. A quoi sert l’analyse des politiques publiques ? Constitue un apport décisif à la compréhension de l’État et ses mutations contemporaines. L’analyse permet l’appréhension de l’État au concret, de l’État en action. C’est une discipline qui est profondement pluri-disciplinaire (économie, sociologie des organisations, gestion, histoire, droit…). Permet de porter un regard approfondi sur un grand nombre d’enjeux politiques actuels. Élements de définition : polity (pouvoir politique qui s’exerce sur les individus), policy (ensemble des actions menées par les gouverments et partis politiques, ONG etc pour mettre en œuvre des actions publiques), politics (lutte des acteurs pour la conquête du pouvoir). Polity & policy essentiellement dans l’action publique c’est-à-dire que les politiques publiques forment des programmes d’action suivis par les autorités étatiques autrement dit les policies/la polity. Jean-Claude Thoenig nous dit qu’une politique publique se présente sous la forme d’un programme d’action propre à une ou plusieurs autorités publiques ou gouvernementales, qui soulignent la place centrale de l’État dans la formation de l’action publique. Même si c’est encore central dans la définition, l’action publique est aujourd’hui le produit d’une multiplicité d’acteurs et les États ne sont plus les seuls détenteurs et sont concurrencés en permanence. Acteurs privés comme les grandes entreprises (GAFA, FTN) « firmisation de l’action publique ». Les acteurs internationaux « la transnationalisation de l’action publique », l’Union Européenne… ainsi que les grandes ONG (Green Peace…), le FMI, l’Organisation Internationale du Travail…. Les citoyens font également partis de ces nouveaux acteurs, dans quelle mesure les citoyens se réapproprient-ils l’action publique ? (Gilets jaunes…) Multiplications d’outils mis à disposition afin de donner la main aux citoyens pour peser sur l’action publique. Complexification extrême de l’action publique donc. De quoi se compose une action publique ? On cherche à répondre à trois grandes questions fondamentales lorsqu’on fait de l’analyse publique. - La première, pourquoi les politiques publiques sont-elles mises en place ? Fondements - La seconde, comment les acteurs de l’action publique agissent-ils ? Outils & instruments de l’action - La troisième, quels sont les effets de l’action publique ? Mise en œuvre concrète Ces trois questions correspondent aux trois composantes principales d’une action publique. Toute politique publique : la poursuite d’objectifs, le choix d’instruments et les ressortissants sur lesquels les politiques publiques s’appliquent. On va pouvoir définir des types de politiques publiques à partir des ces éléments. Dans les années 70-80, des typologies se sont effectuées. 4 grands types de politiques publiques : - Règlementaires : une contrainte individuelle et directe sur les individus - Distributives : autorise à percevoir des prestations particulières (prestations sociales, permis de construire etc…) distributives car facultatives. - Redistributives : contraintes collectives. La puissance publique va fixer des règles concernant un groupe. Toutes les politiques fiscales sont censées être redistributives - Constitutives : Pierre Lascoumes nous dit que ce sont des autorités publiques qui vont editées des règles sur les règles ou sur le pouvoir. Elles vont fixer un cadre général pour ensuite avoir une mise en place plus précise. L’Union Européenne se sert beaucoup de ces politiques. « La dimension procédurale de l’action publique ». (Décentralisation) Il y a cependant des limites à ce type de typologie : 1) ne pas tenir compte de situations dans lesquelles le rapport entre celui qui ordonne l’action publique et son destinataire ne relève pas de la contrainte. Les politiques incitatives en matière de santé publique par exemple (campagne de prévention). Le symbolique a des effets sur l’action des individus. Cette dimension symbolique est aujourd’hui particulièrement 1
étudiée : parfois il y a des politiques publiques qui ne reposent sur aucun programme mais qui ont pourtant des effets sur l’action publique (communication, story telling) « la dimension performative de l’action publique ». 2) La typologie assimile une politique publique à un type de politique publique. Or, très souvent pour un même enjeu, plusieurs formes/types d’actions publiques peuvent coexister. 3) La typologie présuppose que l’action publique est facilement repérable. Or, l’action publique est de moins en moins lisible et identifiable. II.
Historicit(s) de l’action publique a) Les transformations historiques de l’action publique
Pierre Rosanvallon décline 5 grandes temporalités : - Emergence de l’État régalien : Armée, Justice, Education - Emergence d’un État nation (début 19e- fin 19e) : multiplication politiques publiques & donc intervention dans l’espace social Charles Tilly. Politiques d’enseignement ; Unification de la culture nationale - Emergence de l’État Providence (debut 20e) : « émergence d’une société assurantielle » François Ewald. Protection sociale. - Emergence d’un État Producteur (fin SGM) : c’est un super État providence car il intervient aussi dans l’économie émergence du plan (grandes innovations & investissements d’un point de vue économique). - Emergence d’un État « plus faible » : rupture. Politiques de désengagement de l’État b) Sociogen0se des catgories d’action publique L’action publique dans le cadre de leur mise en œuvre opère une mise en sens du réel. Elles vont former des catégories de pensée, elles vont catégoriser les activités sociales et créer des assujetis, des groupes. Les politiques publiques vont créer des taxinomies, des cadres, des cases qui vont générer des façons de se représenter le monde. Il n’y a rien d’innée ni de naturel. Christian Topalov dans « Naissance du ch!meur (1880-1910) » montre que la catégorie chômeur en 1900-1910 ne veut rien dire. C’est grâce au processus d’objectivation économique et social, politique du chômage que cette catégorie va naitre et donc faire l’objet de politique publique. Grard Moiriel va montrer que la construction juridique et administrative de la catégorie immigrée du 19e obeit à des débats et confrontations politiques intenses. Produit d’une construction sociale d’une réalité par les acteurs qui font la politique. Vincent Dubois « La politique culturelle Gen(se d’une catégorie d’intervention publique » montre que cette politique culturelle est le produit d’un État interventionniste, d’une volonté de faire de la culture un levier d’émancipation essentiel des individus, il appelle cela la « dimension populicultrice » de la culture.
III.
Analyser l’action publique. Bref retour sur l’histoire d’une « discipline »
Trois grands moments qui permettent de comprendre l’histoire de cette discipline. Premièrement le « moment américain » à la fin des années 30 à travers le courant des « policy sciences » : les universités américaines sont solicitées pour aider le gouvernement fédéral américain à améliorer leurs politiques publiques. Deuxièmement le « moment français » avec le courant de la sociologie des organisations (Crozier…) : les décisions en matière d’action publique ne sont pas rationnelles (contradictions entre acteurs, conflits individuels perturbent en permanence la mise en œuvre des actions publiques). Troisièmement, la sociologie de l’action publique : attentive aux interractions entre tous les acteurs de l’action publique.
2
Chapitre 1: L’État et l’action publique I.
Retour sur les policy sciences : le modèle de l’analyse séquentiel, ses critiques et ses remises en cause
L’analyse des politiques publiques s’est développée avec le courant des policy sciences : rationaliser l’action étatique pour la rendre plus pertinente. On va développer un modèle spécifique : le modèle séquentiel qui permet de comprendre, de saisir et de lire le début, le milieu et la fin d’une politique publique. Modèle développé dans les années 50 par une série d’auteurs : Laswell, The Decision Process. Seven Categories of Functionnal Analysis… Jones, Anderson… Laswell identifie une politique publique selon 7 séquences/étapes : - La compréhension « intelligent » : étape d’accumulation et de circulation d’informations auprès des décideurs - La promotion d’options par les décideurs - Le choix d’une façon de faire par les décideurs : privilégier une option - La contrainte qui va correspondre à l’établissement de sanctions pour adopter les mesures prescrites - L’application des mesures par l’administration, la justice, tribunaux, institutions en charge d’appliquer l’action publique - L’achèvement d’une politique publique - L’évaluation de l’action publique : délaissée pendant longtemps par l’action publique Modèle très rigide fortement orienté vers la question de la décision et un modèle qui réduit considérablement la complexité même des politiques publiques. Ce modèle a été ensuite retravaillé par des « enfants » de Laswell comme Jones et Anderson (passage de 7 à 5 séquences) : identification du problème, développement d’un programme de politique publique, mise en œuvre de ce programme, évaluation, achèvement. C’est un modèle demeure encore en 2019 utilisé notamment dans le domaine de l’action publique. On retrouve de nombreuses critiques de ce modèle : - Mod0le rigide qui donne une lisibilité à priori de l’action publique alors que l’on sait très bien maintenant que l’action publique est beaucoup plus complexe que ça. Ex : pas de prise en compte de l’espace de « non-décision ». Les « non-décisions récurrentes » Hacker la non mise en place de système de sécurité sociale aux États-Unis, cette non-décision a des effets extrêmement importants sur le système de santé public américain. Cette non-décision initiale d’abandon a des conséquences jusqu’aujourd’hui. Il est très difficile de revenir sur une accumulation de pratiques (Clinton, Obama opposition du Congrès, lobby médicaux…) - Aujourd’hui l’achèvement d’une politique publique pose le plus de problèmes : quand ? Avec l’extrême complexification des politiques publiques, il y a une multiplication d’actions publiques qui ne permettent pas de saisir de façon précise l’achèvement d’une politique publique. - Ce modèle occulte totalement la dimension « symbolique » de l’action publique : une action publique n’est pas simplement composée d’actions effectives mais possède une dimension symbolique extrêmement puissante : les processus d’action publique utilisent de plus en plus des mécanismes de symbolisation et l’action publique est aussi parfois une action sur des symboles. Mettre sur l’accent sur la dimension symbolique c’est montrer que le signifiant, le sens donné à une action est aussi une action aussi importante voire plus importante que le signifié (l’action en tant que telle). Murray Edelman, Political Language appelle cela la « construction des gestes comme solution » c’est-à-dire le fait d’accomplir des actes qui promettent plus qu’ils ne font. Ex : élection de Ronald Reagan, dans sa campagne des années 80 martèle un discours « le président du 0 impôt ». Conformément à sa promesse, commence à mener une politique de réduction des impôts banale, classique des républicains. Le discours a tellement été intériorisé par les américains que dans les deux premières années du mandat, les consommateurs américains vont agir en fonction du fonction du discours du président : le discours a plus d’importance que l’acte surconsommation des américains qui entrainera de lourds endettements… Exemple français : La politique des villes, des quartiers émeutes dans les années 80. Mitterrand commence son deuxième mandat avec Roccard comme 1er ministre met en place les « assises des banlieues » en 1989 et décide de nommer un ministre attribué à cette crise « un ministre de la ville » : effet d’affichage. Michel Delebarre est nommé ministre mais en tant qu’expert, il a du mal à 3
s’exprimer en public. Viré, il est remplacé par Bernard Tapie qui développe un plan dense en 1991 « effet Tapie ».
II.
L’tat : un acteur central dans la définition et la conduite de l’action publique ?
Dans les années 70,80 les travaux vont montrer que l’État est tout sauf un acteur rationnel de l’action publique, l’État est un acteur concurrencé en son sein par des points de vue extrêmement différents ; il n’y a pas de caractère unitaire et monolitique de l’État, l’État doit avancer avec des injonctions contradictoires. Graham ALLISON, The Essence of Decision : s’interesse à une crise politique célèbre : la crise des missiles de Cuba en 1962. Dans cet ouvrage, l’auteur va montrer qu’en analysant les processus de décision du gouvernement fédéral américain sont tout sauf des décisions rationnelles, tout sauf conformes à l’intérêt national américain. Les décisions sont le fruit de conflits extrêmement denses entre plusieurs administrations américaines : d’un côté le gouvernement fédéral, entre la maison blanche et ensuite entre la NAVY qui a aussi une position différente. La décision qui va être prise dans cette crise va résulter d’un jeu de négociation entre ces différents acteurs, routines bureaucratiques. Allison appelle cela « le mod0le du comportement organisationnel ». Arbitrages particulièrement éloignés de toute dimension rationnelle ou logique : des enjeux de pouvoirs et des enjeux bureaucratiques dominent. Les grandes réformes de la décentralisation permettent de comprendre les logiques : conception divergente entre différents services et ministères du gouverment (jacobin, décentralisateur…). L’État est un acteur qui est tiraillé entre d’un côté une conception très jacobine de l’action publique et de l’autre plutôt girondine, décentralisatrice et donc ne parvient jamais à choisir une conception claire. L’ensemble des réformes depuis 1982 montre une hésitation permanente entre ces deux options. Les acteurs en charge de ces réformes sont des acteurs qui sont à la fois d’un côté des défenseurs de l’État mais aussi des élus locaux : cela rend très difficile de privilégier une voie par rapport à une autre. Il faut comprendre ces grandes réformes à travers ces oppositions, ces conflits internes… MATHIOT, Acteurs et politiques de l’emploi en France (1981-1993)
III.
Un tat dépassé ? Gouvernance multi-niveaux et fabrique transnationale des politiques publiques A. L’europanisation des politiques publiques
Les politiques publiques européennes sont le résultat d’un processus d’approfondissement de l’Union Européenne depuis 50 ans. L’Europe compte y compris dans des secteurs qui sont restés à priori de l’ordre de l’État national. Les politiques publiques européennes existent aujourd’hui à tous les niveaux : à la fois des politiques « constitutives » c’est-à-dire qui vont définir les règles du jeu et vont formaliser des processus d’intégration de l’action publique, politiques également distributives/allocatives à l’échelle européenne (formation pro, recherche), politiques redistributives comme la politique régionale européenne et puis la politique agricole commune et enfin les politiques règlementaires qui sont les plus développées au niveau eruopéen : mise en conformité de leur action publique des décisions prises au niveau européen. Ces politiques publiques européennes ont envahi le paysage de l’action publique des États de l’Union Européenne : primauté du droit de l’Union sur le droit national des États membres. On le voit grâce au rôle que joue la CJE « recours en manquement ». Au dela de la contrainte exercée par les insitutions, il y a une contrainte « morale » non contraignante mais qui va avoir des effets sur l’action publique dans les États Membres. Bruno Palier et Yves Surel ont défini l’européanisation « l’ensemble des processus d’ajustements institutionnels, stratégiques et normatifs induits par la construction européenne ». La notion de contrainte n’est pas centrale ici mais les États de l’Union Européenne vont très souvent se mettre en conformité avec des pratiques menées dans d’autres États européens. Comment peut-il y avoir des influences réciproques ? Il existerait une sorte de pression adaptative continue de l’Union Européenne sur les acteurs nationaux. Les primes nationaux sont perpétuellement mis en concurrence. B. Les politiques publiques internationales : que signifie la transnationalisation de l’action publique ? 4
Avant le milieu des années 2000, on ne parlait pas de politiques publiques internationales. C’est notamment grâce aux chercheurs français que l’on a esquissé une définition. Smith et Petiteville les définissent comme « L’ensemble des programmes d’actions revendiqué par des autorités publiques ayant pour objet de produire des effets dépassant le cadre d’un territoire stato-national » On distingue deux types de politiques publiques internationales : l’une relève d’une autorité politique centrale (les États ou même l’Union Européenne) appelée « foreign policy » et de l’autre côté toutes les politiques publiques multilatérales produites par et dans le cadre des organisations internationales situées au-delà et par delà les Etats : ce deuxième type vient remettre en cause le rôle et la place de l’État dans les politiques publiques. Pendant très longtemps, l’État était considéré comme le principal acteur des politiques publiques. A la fin des années 2000, le contexte international a progressivement changé remettant ainsi en cause les perspectives d’un État tout puissant dans la fabrication des poltiiques publiques. En effet, le contexte de globalisation s’est imposé avec un développement considérable des échanges et des communications ainsi qu’en filigrane une interdpendance croissante des économies. Dans ce contexte, de nouveaux acteurs transnationaux très puissants tels que les FTN mais également les ONG, les grandes organisations internationales exercent une influence très importante. Il y a de plus un nouveau référentiel de marché : ce tournant néolibéral des politiques publiques participe très largement à la remise en cause de l’État. (Bruno Jobert et Pierre Muller ). Certaines politiques publiques demandent un accès certain à la scène internationale : les politiques publiques environnementales nécessitent des prises en charge internationales. Afin de donner des exemples, reprenons la grille de Lowi : - Politiques constitutives internationales : toutes les politiques définies par les grandes organisations internationales qui vont servir de cadre à l’élaboration des grands traités internationaux, à la création d’organisations connexes ou subsidiaires, à des régimes spécifiques… - Politiques règlementaires internationales : les politiques qui vont prescrire le comportement des États dans de multiples domaines. Par exemple la gestion des conflits au sein du Conseil de Sécurité, la régulation du commerce mondiale (politique menée par l’OMC), la politique de stabilisation financière ordonnée par certains États… - Politiques distributives internationales : toutes les politiques concernant les biens publics mondiaux (enjeu de juridicité) en matière de ressources naturelles communes notamment : débat sur l’espace maritime international… - Politiques redistributives internationales : concernent les aides au développement (Banque Mondiale, Programme spécifique des Nations Unies…) On peut noter une sur-reprsentation des polit...
Similar Free PDFs

Sociologie de l\'action publique
- 17 Pages

Séance 6 PP Laction civile
- 9 Pages

Cours de Santé publique Ostéo
- 74 Pages

Cours de sociologie
- 34 Pages

Sociologie de la modernité
- 29 Pages

CM Sociologie de l\'éducation
- 16 Pages

Sociologie DE LA Musique
- 9 Pages

CM1 introduction de sociologie
- 1 Pages
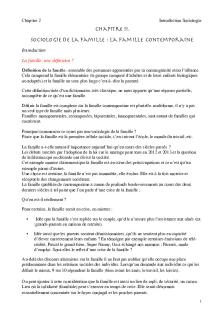
Sociologie de la famille
- 30 Pages

Sociologie de l\'identité
- 3 Pages

Sociologie de la famille
- 11 Pages

Domaines de la sociologie
- 45 Pages

Objet d\'étude de sociologie
- 11 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu


