Sociologie de l\'identité PDF

| Title | Sociologie de l\'identité |
|---|---|
| Author | Candice Lagauche |
| Course | Sociologie |
| Institution | SKEMA Business School |
| Pages | 3 |
| File Size | 67.6 KB |
| File Type | |
| Total Downloads | 34 |
| Total Views | 136 |
Summary
Sociologie de l'identité...
Description
TD5 : Sociologie de l’identité Quand on fabrique un bien/un service, on met à l’œuvre notre ingéniosité = épreuve du réel. On se construit soi-même. - Identité personnelle : qualité intrinsèque. Individu unique, elle reste stable toute notre vie (les expériences professionnelles modifient un peu ce que l’on est) - Identité sociale : quelle est ma place dans la société ? Quel rôle je joue ? On peut avoir plusieurs rôles ? On se fait des idées des attentes d’un rôle On n’existe que si les autres nous remarque On doit développer une intelligence sociale pour comprendre les normes et les codes d’un groupe. On interprète les attentes GOFFMAN : quand on est différent comment on se conforme aux attentes des groupes auxquels on aimerait appartenir ? On essaye de cacher ses différences mais les autres continuent à les voir. Jeu d’ajustement pour se valoriser. Régulation du travail de l’identité : on appartient à un groupe que si on se conforme aux critères du groupe. Les rôles sociaux sont multiples : intersectionalité et conflit de rôle GOFFMAN : dans chacune de nos sphères (entreprise, famille, association, amis etc), nous jouons des rôles et nous portons des identités différentes Les rôles sociaux structurels (image sociale : être une femme en France en 2014) Conflit de rôle : attentes sociales sur : (bonne mère de famille, une bonne salariée etc). Exemple : mère de famille qui est chef d’une entreprise. Situation complexe dans lesquels on doit faire des arbitrages. Plus on est impliqué dans des rôles, plus il y aura de conflit de rôle. Processus de socialisation : Aligner son comportement sur les attentes du groupe dans lequel on veut rentrer. Comment on apprend les règles pour se socialiser ? Comment arrive-t-on à s’intégrer ? Développer une intelligence sociale Erwing GOFFMAN Goffman : comment parvenir à établir une régulation égalitaire avec quelqu’un de différent ? Paradoxe de nos sociétés démocratiques, on est sensé être tous égaux. Alors que dans ce cadre, on expérimente tous les jours des personnes différentes. On associe ca au stigmate (différence)
Le stigmatisé : l’individu que quelque chose disqualifie et empêche d’être pleinement accepté par la société. Processus de catégorisation. Le stigmate n’existe que lorsqu’il y a un désaccord entre une identité sociale virtuelle et une identité sociale réelle, entre ce que l’on suppose que l’autre est et ce qu’il est réellement. Enjeu clef : comment conduire l’interaction entre stigmatisé et normal ? Plus une société est ouverte, plus la déviance va être tolérée Conséquence : perte de confiance en soi. Quand on rappelle à une population son stigmate, la population va reproduire son comportement de manière consciente ou subconsciente. La façon dont on prédispose les gens va influencer le comportement. Cas de la maladie : Il a le cancer (un attribut dans ce qu’il est) Il est schizophrène (l’attribut prend la place de la personne, ca gomme tous les autres attributs)
Identité sociale virtuelle : ce que la société attend d’un individu Identité sociale réelle : ce que l’individu pense être son identité sociale
Identité personnelle : l’idée que l’individu se fait de lui-même, ce qu’il veut être pour les autres L’identité se développe au cours des interactions avec les autres. Interactionnisme symbolique : courant de GOFFMAN, le sens des choses (se serrer la main : interprétation de la force, des mains moites pb biologique mais que l’on ne controle pas) Les individus agissent à l’égard des choses en fonction du sens qu’ils attribuent à ces choses Identité pour soi : ce que l’individu ressent à l’égard de son stigmate et ce qu’il en fait. Identité sociale : résulte du regard à l’égard des autres et de la place qu’ils accordent à un individu compte tenu de l’idée qu’ils s’en font. L’identité est le fruit des interactions. Enjeu clef : comment mener l’interaction.
Malcom GADWELL Anthony GUIDENS La société de consommation -
Pourquoi consommons-nous ? Pourquoi autant ? Nous sommes ce que nous consommons
Jean Baudrillard (1928-2007) Dans les sociétés occidentales, au niveau de l’individu, la société de consommation n’est plus un moyen de satisfaire les besoins mais plutôt un moyen de se différencier. - Une logique de signe et de symboles à travers la possession et la consommation d’objets - On ne consomme jamais l’objet en soi, on manipule toujours les objets comme signes qui vous distinguent soit en vous affiliant à votre groupe pris comme référence idéale, soit en vous démarquant de votre groupe par référence à un groupe de statut supérieur. (Ex : Iphone ou la wii, les enfants ne veulent pas jouer avec un autre enfant qui n’en a pas car il ne sait pas y jouer) SELIGNAM - apprendre à être heureux Comment devenir un … contagieux Hapiness report depuis 2012 -
Le niveau de bonheur n’est pas corréler à ce qu’on achète o Le bonheur hédonique (recherche de satisfaction de plaisir instantané) o Le bonheur eudémonique (recherche d’une satisfaction plus longue car le travail est plus long : satisfaction personnelle, ambition etc)
On en gagne en estime en fonction de ce que l’on consomme et de comment on l’affiche Objet : - ustensile répondant à une fonction (chaussure, si on en a déjà…) - un élément de confort - un symbole de prestige promettant d’exister socialement (Iphone, maison de campagne, lit de telle marque), fait nous différencier d’un certain groupe de référence pour en appartenir à un autre. Une vision critique de la société de consommation - le caractère produit des besoins (le besoin est produit par le système de consommation) - la consommation comme un élément de contrôle social (encadrer les comportements)
-
Réflexion sur le corps comme objet de consommation (tatouage) Les mythes du plaisir, de la jeunesse… (secteur de la chirurgie esthétique) Injonction de la beauté à la santé (téléachat) A travers le corps comme objet de consommation : un signe ou un vecteur de distinction sociale (ex : pratique comme la tatouage)
Différents types de consommateur : - consommateur engagé - consommation collaborative - appels à la slow consommation - sensibilisation au gaspillage et à la protection de l’environnement...
Similar Free PDFs

Cours de sociologie
- 34 Pages

Sociologie de la modernité
- 29 Pages

Sociologie de l\'action publique
- 17 Pages

CM Sociologie de l\'éducation
- 16 Pages

Sociologie DE LA Musique
- 9 Pages

CM1 introduction de sociologie
- 1 Pages
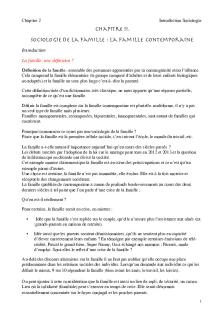
Sociologie de la famille
- 30 Pages

Sociologie de l\'identité
- 3 Pages

Sociologie de la famille
- 11 Pages

Domaines de la sociologie
- 45 Pages

Objet d\'étude de sociologie
- 11 Pages

Sociologie DE LA Deviance
- 18 Pages

Synthèse de sociologie
- 12 Pages

Sociologie de la culture
- 40 Pages
Popular Institutions
- Tinajero National High School - Annex
- Politeknik Caltex Riau
- Yokohama City University
- SGT University
- University of Al-Qadisiyah
- Divine Word College of Vigan
- Techniek College Rotterdam
- Universidade de Santiago
- Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang
- Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Baguio City National High School
- Colegio san marcos
- preparatoria uno
- Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 107
- Dalian Maritime University
- Quang Trung Secondary School
- Colegio Tecnológico en Informática
- Corporación Regional de Educación Superior
- Grupo CEDVA
- Dar Al Uloom University
- Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería
- 上智大学
- Aakash International School, Nuna Majara
- San Felipe Neri Catholic School
- Kang Chiao International School - New Taipei City
- Misamis Occidental National High School
- Institución Educativa Escuela Normal Juan Ladrilleros
- Kolehiyo ng Pantukan
- Batanes State College
- Instituto Continental
- Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kaltara (Tarakan)
- Colegio de La Inmaculada Concepcion - Cebu

